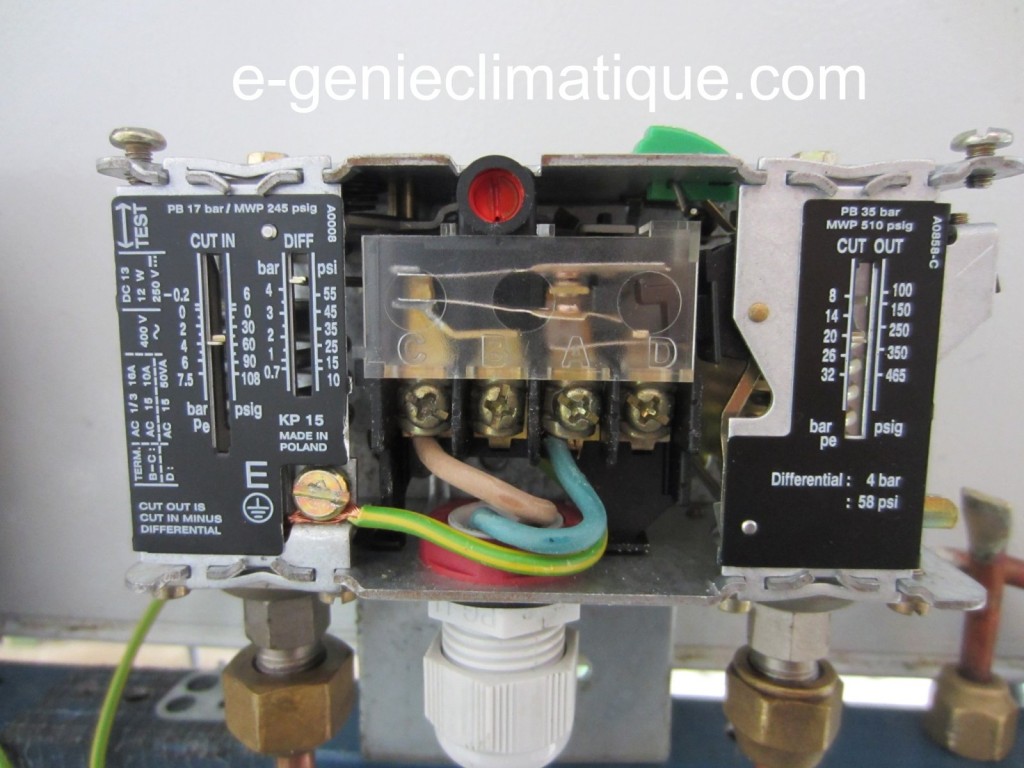**
« C’est donc un amoureux qui parle et qui dit : »Roland Barthes, Fragments du discours amoureux. « Je vis, je meurs ». Ce syntagme poétique est porteur d’une forme de lyrisme universel qui innerve les paroles tourmentée de Phèdre : « je sentis tout mon corps et transir et brûler » (Racine, Phèdre, Acte I, sc. 3, v. 277), jusqu’aux chansons d’amour de Consuelo Velazquez. Dans son évidente simplicité se manifeste toute la puissance des oppositions résidant dans le fait d’amour ; toutes les voies que peut emprunter le sujet lyrique conscient, avant toute chose, du fait de vivre l’amour en progressant dans la connaissance de soi. Comment l’amour fait-il écrire cependant ? Pétrarquiser ne conduit qu’à cette question. L’humanisme, y compris en amour, se vit par un travail constant de soi avec les sources, par une innutrition qui œuvre à la dynamique de découverte de soi. Dans le corpus des Œuvres de Louise Labé1, on fait l’amour en l’interrogeant dans sa possibilité d’être vécu, car le fait d’amour se manifeste notamment par la célébration du sentiment de vivre. D’après l’adresse à Clémence de Bourges, aimer est un acte parmi d’autres, il accompagne ainsi nécessairement une certaine « façon de vivre » (p. 64) parmi tant d’autres à laquelle l’art poétique peut donner une grande variété de contours. Parce que l’amour est avant tout une expérience de vie non exclusivement intellectuelle, il confronte Amour et Folie qui trouvent ensuite leur expression la plus raffinée dans l’art lyrique et l’art du verbe en général comme s’applique à le démontrer Apollon. Ce dernier exprime en effet que « le plus grand plaisir qui soit après amour, c’est d’en parler » (p. 109) ; aussi vivre l’amour est-il inextricablement lié au plaisir d’écrire : « c’est qu’incontinent que les hommes commencent d’aimer, ils écrivent des vers » (p. 110). Labé ne cesse ainsi de transformer le discours amoureux par un effet dynamique de réécriture – dynamique qui consisterait à parler d’amour en le transformant inconstamment de la prose au vers. On ne souligne pas assez la dimension opérative du titre choisi par Labé, du latin opera : l’« ouvrage, acte, travail ». Il s’agit bien de mettre en mouvement, par la diversité des sections, le fait de vivre l’amour, de « faire l’amour » au sens du poïen grec. L’amour est action, loin du pur débat spéculatif éthéré, ou d’une dissertation néoplatonicienne ; cette action s’accompagne ainsi d’une métamorphose intense des registres et des formes. En scénarisant l↧