Antoine Vitez, le devoir de traduire Georges Banu, François Rey, Alain Girault, Antoine Vitez Collectif Date de parution : 28/06/2017 Editeur : Actes Sud-Papiers Collection : Apprendre ISBN : 978-2-330-07910-9 EAN : 9782330079109 Nb. de pages : 192 p. En juillet 1994, le Festival d'Avignon rendit hommage à l'oeuvre d'Antoine Vitez. Une demi-journée d'étude (l'après-midi du 18 juillet) fut consacrée à sa pratique traductive. Il s'agissait à la fois d'évoquer l'importance que Vitez accordait à la traduction, son goût et sa passion des langues, son intérêt spécifique pour les domaines russe, hellénique et allemand. La qualité des communications présentées ce jour-là - interventions, témoignages, analyses - fit alors l'objet d'une publication. Vingt ans plus tard, la pensée du grand metteur en scène continue de résonner : dans cette édition revue et augmentée, la traduction de théâtre s'interroge, se scrute, s'analyse, et son enjeu, saisir le geste qui institue l'oeuvre et commande la parole théâtrale, s'impose. Comme disait alors Antoine Vitez : "Traduire, c'est mettre en scène".
↧
Antoine Vitez. Le devoir de traduire
↧
2 nd Symposium on Nineteenth-Century Literature : Family Plots (Lisbonne)
After a first meeting dedicated to Brazilian author Machado de Assis, the second “Symposium on Nineteenth-Century Literature” will be focusing on family as one of the most preeminent topics of nineteenth-century fiction, across different nationalities, cultures and authorial aesthetics. This broader scope will allow us to inquire into the role of family as a site of convergence and tension, where the concepts of individual and community, intimate and social, familiar and foreign are brought together both to meet and to challenge each other. Thus, we propose to look at “family plots” in two ways: on the one hand, trying to understand how the idea of family became a central object of narrative in literary works of the 1800s, and, on the other hand, analyzing the means through which fictional families are not only based on fundamental plotting devices, but also deploy those same devices – in the manner of planning, intrigue, or artifice – to construe and interpret themselves and the social world they purport to represent. Topics may include, but are not limited to:Testaments, inheritance and legacy;Family curses and family ties;Marriage, divorce, widowhood, adultery;Gender and family roles;Bildungsroman;Childhood, adolescence and old age;Retelling, rewriting and remediating family;Domesticity and material culture;Orphanhood and adoption;Family, the state and the law;Family history, tradition and rituals;Funeral practices, grieving and mourning;Film, photography and representations of family across visual media. Scholars and researchers from all related academic fields wishing to submit a proposal for a paper presentation of 20 minutes (max.) are required to provide their name and affiliation, title, short abstract (250-300 words) and short biography (100-150 words) to the following email address: rialcec@gmail.com . The symposium will be held in English. Submission deadline : Tuesday 31 October 2017 Participants will be notified by Monday 6 November 2017 Registration fee for participants: 20€ Certificate of attendance: 10€ Open to the public. Confirmed keynote speakers: Maia McAleavey (Boston College) Sophie Gilmartin (University of London) Organization: Amândio Reis (Universidade de Lisboa) Inês Robalo (Universidade de Lisboa) Project RIAL; CEC – Centre for Comparative Studies Scientific committee: Ângela Fernandes (Universidade de Lisboa) Fernanda Mota Alves (Universidade de Lisboa) Fernando Guerreiro (Universidade de Lisboa) Gabriel Magalhães (Universidade da Beira Interior)
↧
↧
L’engagement littéraire au tournant des XX e et XXI e siècles - 12-13 avril 2018
Le paradigme de l’engagement littéraire au tournant des XX e et XXI e siècles est un champ de réflexion qui se situe à l’intersection de quatre déterminations intellectuelles décisives. Première détermination, le moment sartrien fondateur Depuis la publication de Qu’est-ce que la littérature? (1948), par lequel J.-P. Sartre fonde un nouveau modèle théorique permettant de penser «l’articulation entre littérature et politique», et plus largement entre esthétique et valeurs, la notion de «littérature engagée [1] » renvoie à «des enjeux complexes, tant esthétiques qu’idéologiques». (H. Baty-Delalande) Deuxième détermination, le Nouveau Roman et le formalisme Dans les années 1950-60, les textes-manifestes du Nouveau Roman ( L’Ère du soupçon , N.Sarraute, 1956), ( Pour un Nouveau Roman , A. Robbe-Grillet, 1961), ( Théorie d’ensemble , Tel Quel, 1968) proclament la mort de l’engagement littéraire, devenu «une notion périmée». «Au lieu d’être de nature politique, l’engagement, c’est, pour l’écrivain, la pleine conscience des problèmes actuels de son propre langage, la conviction de leur extrême importance, la volonté de les résoudre de l’intérieur.» (A. Robbe-Grillet) La littérature «n’a d’autre sujet qu’elle-même». (C. Simon). Le formalisme essentialise l’écart entre la littérature et la politique. Il s’emploie non seulement à substituer au paradigme de l’engagement «une conception autoréférentielle du langage» (D. Sallenave), mais à prescrire une «idée de la littérature absurdement restreinte et appauvrie», dans laquelle «le monde extérieur, le monde commun au moi et aux autres […] est nié ou déprécié». (T. Todorov) Troisième détermination, la formation discursive dite «post-moderne» Selon le discours dit «post-moderne» (devenu idéologiquement dominant), l’Homme serait rentré dans « l’ère des fins ». «Fin des métas-récits», (J.-F. Lyotard), «fin de l’Histoire», «fin de l’Homme» (F. Fukuyama), «fin de la littérature». (D. Viart, L. Demanze) «L’ère de l’engagement a fait son temps. Elle a disparu avec Sartre, Foucault et les autres. Il faut y substituer désormais celle du dégagement». (D. Floscheid) Évidemment, ce discours désenchanté de la fin est de nature à frapper «d’obsolescence l’engagement en général et, plus particulièrement, l’engagement littéraire». (S. Syrvoise-Vicherat) Quatrième détermination, le renouvellement du paradigme de l’engagement S’il l’on peut se féliciter de l’impossibilité des formes d’engagement soumises à une logique manichéenne / partisane, ou du Roman à thèse «inféodé à des doctrines idéologiques» (D. Viart), il n’en reste pas moins que les romanciers ne se tiennent pas «à l’écart des questions politiques ou sociales. Leur implication est d’une autre nature : loin des formules sartriennes (ou malruciennes ou aragoniennes…) les nouvelles formes de l’engagement tiennent désormais plus de l’écriture critique que du discours fictionnalisé. Elles ne passent pas par l’esprit de système ni par l’ambition didactique. Elles mettent en évidence une réalité que le corps social connaît sans vouloir la réfléchir.» [2] Les écrivains qui prennent le relais dans les années 1980 adoptent une voie-voix de renouvellement du paradigme de l’engagement. Dans ce même contexte, J. Derrida souligne la «nécessité impérative de garder le mot "engagement", un beau mot encore tout neuf (gage, gageure et langage, « situation », responsabilité infinie, liberté critique au regard de tous les appareils, etc.) en le tirant peut être un peu ailleurs : tourné du côté où nous nous trouvons chercher à nous trouver, « nous», aujourd’hui. Garder ou réactiver les formes de cet "engagement"en en changeant le contenu et les stratégies.» [3] Des observateurs avertis de l’évolution de la scène littéraire française tels que C. Prévost, J.-C. Lebrun, D. Viart, L. Ruffel, B. Blanckeman, A. Mura-Brunel, et M. Dambre, Ph. Forest, G. Scarpetta, J. Kampfer, S. Florey et J. Meizoz notent que la fin du XX e et le début du XXI e siècles sont marqués, dans le domaine littéraire, par un renouveau de l’engagement. Ce qui nous conduit à penser que la «fin de l’engagement» est plus une problématique de la critique littéraire qu’une donnée intrinsèque de la littérature. Donc, au lieu de parler de «disparition» puis de «retour» de l’engagement, il serait plus pertinent de distinguer des formes de cristallisation différentes de l’engagement, référant à des projets d’écriture romanesque différents dans leurs rapports à eux-mêmes et à l’Histoire. Pour multiplier les questions, croiser les entrées possibles, remodeler les approches dans la perspective d’un renouvellement du paradigme de l’engagement littéraire, l’approche méthodologique retenue pour les travaux de ce colloque se situe au confluent de trois référentiels conceptuels. Le premier est celui des « fictions critiques ». Au sens de ces «entreprises critiques à double raison: parce qu’elles se saisissent de questions critiques – celles de l’homme dans le monde, de l’Histoire et de ses discours déformants, de la mémoire et de ses parasitages incertains…– et parce qu’elles exercent sur leur propre manière, sur leur mise en œuvre littéraire un regard sans complaisance». [4] Le second est celui de la pensée complexe / reliante . Telle que définie par E. Morin, la pensée complexe/reliante rend «compte des articulations entre des [des aspects] qui sont brisés par la pensée disjonctive». Dans ce sens, l’écrivain et philosophe Etienne Barilier met «au principe de la littérature, voire du langage lui-même, ces deux forces, ou ces deux dispositions, ou ces deux dimensions très élémentaires que sont l’éloge d’une part, et la critique d’autre part. L’éloge et la critique, où [il voit] un couple heureux et indissoluble, et qui dans une certaine mesure recouvre la dimension esthétique et la préoccupation éthique de l’écriture.» [5] Le couple «éloge-critique» comme dimension essentielle de toute littérature, nous situe en deçà ou bien au-delà de deux perceptions réductricessi dommageables : celle qui confond la littérature avec la politique et celle qui l’enferme dans la problématique formelle. Le troisième est fourni par les réflexions sur l’articulation entre esthétique et éthique . Le questionnement éthique revient fréquemment dans le titre des ouvrages collectifs [6] et des études [7] entièrement consacrés à la question des rapports entre l’éthique et la littérature. Certains poussent la réflexion et pensent que «davantage que d’engagement politique, il faudrait parler d’engagement pour des valeurs». ( T. Jacques Laurent) Tous ces appareils conceptuels peuvent être associés en effet, non seulement pour que la réflexion ne soit prise au piège des jugements stéréotypés sur l’engagement littéraire mais, plus fondamentalement, pour participer à une entreprise de refondation du questionnement. Celle-ci vise à affranchir le savoir de paradigmes simplificateurs, qu’ils soient issus de l’héritage sartrien, ou construits et reconstruits selon les stratégies propres au «point de vue «textualiste» ou «littéraliste». (J. Bouveresse) Donc, on s’attachera à mettre en lumière , par la lecture des œuvres de Pierre Bergounioux, François Bon, Jean-Yves Cendrey, Annie Ernaux, Aurélie Filippetti, Jean-Paul Goux, Leslie Kaplan, Milan Kundera, Abdellatif Lâabi, Franck Magloire, Laurent Mauvignier, Gilbert Naccache, Philippe Raulet, Christiane Rochefort, Danièle Sallenave, Gorge Semprun, Jacques Serena, Frédéric Valabrègue – et la liste n’est pas close – des données textuelles distinctives permettant de montrer en quoi ces œuvres s’ajointent à leur propre monde fictionnel, une porte par où la politique, l’éthique, le social, l’existentiel communiquent du dedans avec la littérature. En inscrivant la question du renouvellement de l’engagement littéraire en tête de son programme scientifique, ce colloque affronte un ensemble de questions ouvertes. Cet argumentaire n’a donc pas pour ambition de formuler desthèses, mais de poser des questions, d’avancer des pistes de lecture pour contribuer à restituer à la notion d’engagement littéraire «ses nuances et sa complexité». (S. Florey) Dans cette perspective, nous avons fixé les éléments du questionnement suivant: Le cliché d’une littérature «de l’abstention ou du repli» (B. Denis) n’est-il pas une idée- reçue idéologique? Entre littérature, politique, idéologie et éthique, comment l’écrivain se positionne-t-il au tournant des XX e et XXI e siècles ? Comment combine-t-il l’Histoire et la fiction ? Comment lui-même se situe-t-il par rapport à l’Histoire ? Comment l’écriture traduit-elle «le réel de l’histoire indirectement, triangulairement, par la réfraction de l’Histoire sur le personnage, sur le romancier et sur le lecteur »? (H. Mitterand) Quelles représentations duréel, l’écriture met-elle en forme après la mise en question radicale du langage ? Quelle image du sujet donne-t-il ? S’agit-il d’un «sujet maître de son destin» ou d’un «sujet en crise»? Faut-il privilégier «l’idée d’engagement au sens plus existentiel que strictement politique»? (Eric Marty)Qu’est-ce que vraiment le réel? On n’est-on pas «rentré dans une ère de l’Image et du Virtuel»? (Irène Salas) Si l’on peut admettre que«la littérature est beaucoup plus porteuse d’espoir, de réflexion, de changement dans l’attitude du lecteur qu’un quelconque énoncé politique, si argumenté qu’il puisse être» (G. Naccache), peut-on alors penser que «l’art du roman reviendrait à explorer le non-dit des autres discours (scientifiques, philosophiques, religieux, politiques, sociologiques, idéologiques, psychologiques), - et même, dans la plupart des cas, à faire surgir ce que ces discours ne peuvent que méconnaître»? (G. Scarpetta) Faut-il parler de post-modernité ou de modernité? Ne convient-il pas de s’employer plutôt à révéler «l’inconséquence par l’absurde» du discours «désenchanté de la fin» en montrant la présence forte, «dans le renouvellement des idées, de la préoccupation historique, de la dimension politique, et plus généralement des grands thèmes de la modernité, transformés et actualisés » (L. Ruffel) par le roman contemporain? À propos de «la fin de l’Histoire», s’agit-il objectivement d’une «fin de l’Histoire» ou d’une «reconnaissance deson ouverture» sur une pluralité de possiblescontradictoires ? Enfin, quelle est la portée subversive d’une démarche d’écriture «destinée à affranchir la littérature du corset d’une moralité restrictive, au nom d’un impératif éthique plus élevé»? (L. Korthals Altes) Date limite d’envoi des propositions : Les propositions de contribution (350 mots environ), accompagnées d’une courte notice bio-bibliographique, sont à envoyer avant le 31 janvier 2018 à l’adresse électronique suivante: Issht2018@yahoo.com RESPONSABLE : DEPARTEMENT DE FRANÇAIS MASTER DE LINGUISTIQUE ET DE LITTÉRATURE FRANÇAISE UNTE DE RECHERCHE EN INTERMEDIALITE, LETTRES ET LANGAGE (INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES HUMAINES DE TUNIS, UNIVERSITÉ TUNIS EL MANAR ) ADRESSE 26 Avenue Darghouth Pacha -1007- TUNIS [1] «Littérature d’engagement», «littérature engagée». Deux notions proches et pourtant différentes par leur référent. Tout en considérant que «toute œuvre littéraire est à quelque degré engagée, au sens où elle propose une certaine vision du monde et qu’elle donne forme et sens au réel» , Benoît Denis introduit une subtile distinction conceptuelle.La littérature engagéecorrespond à la période qui s’étend de l’Affaire Dreyfus à Sartre. « C’est en effet durant cette période que cette problématique s’est développée et formulée précisément, qu’elle a pris cette appellation et qu’elle est devenue l’un des axes majeurs du débat littéraire.» Par contre, « puisqu’il a toujours existé une littérature de combat et de controverse, et que certains de ses représentants ont parfois servi de modèles ou de caution aux écrivains engagés de ce siècle », c’est à la notion de « littérature d’engagement » qu’il recourt pour «désigner ce vaste ensemble transhistorique de la littérature à portée politique ». (Cf. Benoît Denis, Littérature et engagement. De Pascal à Sartre , Paris, Seuil, 2000, p.10-12). La notion de l’engagement littéraire est plus souple que celle de littérature engagée. Mais incontestablement, «littérature engagée» ou «littérature d’engagement» différencient «la littérature de l’engagement». «Elles distinguent le travail sur les mots du travail sur les idées, la création dans la fiction de l’action dans le réel.» (E. Barilier, «Changer de monde, ou changer le monde?», in Formes de l’engagement littéraire, XV e -XXI e siècles , ss. la dir. de J. Kaempfer, S. Florey et J. Meizoz, Editions Antipodes, Lausanne, 2006, p.269.) [2] Dominique Viart, « Ecrire avec le soupçon », in Michel Braudeau, Lakis Proguidis, Jean-Pierre Salgas, Dominique Viart, Le roman français contemporain , Paris, ADPF, 2002, p. 155-156. [3] J. Derrida, «“Il courait mort”: Salut, salut. Notes pour un courrier aux Temps modernes »,in Les Temps modernes. 50 ans , mars-avril-mai 1996, n°587, p.40. [4] Dominique Viart, «Fictions critiques: la littérature contemporaine et la question du politique», in Formes de l’engagement littéraire, XV e -XXI e siècles , ss. la dir. de J. Kaempfer, S. Florey et J. Meizoz, Editions Antipodes, Lausanne, 2006, p.192. [5] Etienne Barilier, «Changer de monde, ou changer le monde?», in Formes de l’engagement littéraire, XV e -XXI e siècles , op.cit ., p.270. [6] E.Roy-Reverdy et G. Séginger (dirs.), Ethique et littérature : xix e- xx e siècles , Actes du Colloque de Strasbourg, 10-11 décembre 1998, Presses universitaires de Strasbourg, 2000 ; Sandra Laugier (dir.), Ethique, littérature, vie humaine , Paris, Puf, 2006 ; F. Quinche et A. Rodriguez (dirs.), Quelle éthique pour la littérature ? Pratiques et déontologies , Genève, Labor et Fides, 2007. [7] P. Poiana, Ethique et littérature , Lyon, aldrui, 2000, A. Stanguennec, La morale des lettres. Six études philosophiques sur éthique et littérature , Paris, Vrin, 2005.
↧
Érotisme et pornographie dans l'œuvre de Louis Aragon
Aragon érotique? Le 9 décembre 2017 à l’ENS Ulm Séminaire de l’Équipe Aragon (dir. Luc Vigier) de l’Institut des textes et manuscrits modernes Louis Aragon a accordé une place de choix dans son œuvre à l’écriture du désir et de la sexualité, allant parfois jusqu’à faire d’Éros la pierre de touche poétique d’un grand nombre de textes dans lesquels le corps et le plaisir ne cessent de circuler. Pourtant, rares sont les études s’intéressant en profondeur à la figure d’un Aragon érotique, voire pornographe, peut-être trop souvent occultée par celle de l’intellectuel communiste et du fou d’Elsa. C’est donc tout un pan de l’œuvre d’Aragon, du Libertinage à Théâtre / roman , en passant par La Défense de l’infini ou Henri Matisse, roman , qui appelle à être analysé aujourd’hui sous le signe d’une érotique singulière, dont il faudra cerner les contours mais aussi les contradictions, celles-ci se trouvant peut-être à l’origine de cette étonnante mise à l’écart. Nous ne pourrons ignorer la posture paradoxale de l’auteur vis-à-vis de la sexualité et plus spécifiquement de son écriture: Aragon n’a-t-il pas en effet nié jusqu’à sa mort la paternité de son texte le plus explicitement érotique, «Le Con d’Irène»? Son écriture ne cesse-t-elle pas d’osciller entre rejet et fascination pour la geste des corps, tour à tour déplorant le profond «limité de l’expérience érotique [1] » puis louant dans Le Paysan de Paris «cette furie physique», «le mépris de l’interdiction et le goût du saccage [2] » qu’elle suscite ? Malgré cette ambivalence, le texte aragonien retourne sans cesse au désir, comme si le langage, et donc la littérature, devenaient des instruments nécessaires au poète pour approcher les corps et leurs jouissances. Les propositions de communication pourront ainsi se concentrer sur le lien établi par Aragon entre langage et sexualité, mais aussi sur les paramètres stylistiques et thématiques constitutifs de l’érotique aragonienne, tels que l’esquive de toute représentation directe de la jouissance, le recentrement du texte sur la naissance intérieure du désir chez les personnages, ou encore la valorisation de la jouissance féminine et l’éviction partielle du modèle phallique. Outre la totalité de l’œuvre littéraire de notre poète, les interventions pourront aussi s’appuyer sur tout un ensemble de documents à l’intérêt indéniable dans lesquels Aragon témoigne de sa propre sexualité (voir par exemple le numéro des Archives du surréalisme consacré à la surréalité, ou l’entretien d’Aragon paru chez Lui en avril 1974). Il s’agira aussi de s’interroger sur l’éventuelle distinction opérée par le corpus entre érotisme et pornographie, en s’intéressant notamment à l’usage politique que semble faire Aragon de cette dernière: si la sexualité bourgeoise est grotesque, parce que toujours préoccupée d’en finir le plus vite possible, le «vagabondage des sens [3] » défendu par Aragon se fait à l’inverse le support d’une transgression et d’une révolte qui se veut être celle de l’infini sur le fini. Dès lors, quelle est cette idée de la sexualité qui soutient l’érotisme aragonien et vient l’arracher aux bras infâmes de l’obscénité? Quelles en sont les réussites et les limites? Pour répondre à cette question, un détour par la relecture aragonienne de la dialectique et du concret hégéliens pourra se révéler nécessaire afin de dégager l’investissement philosophique, et par là même existentiel, dont le désir et la sexualité font l’objet dans l’ensemble de l’œuvre d’Aragon. Les communications prendront la forme d’un exposé oral de 45 minutes et seront suivies d’une discussion. Vous pouvez envoyer un bref résumé de votre proposition d’intervention avant le 9 novembre 2017 à l’adresse suivante: louise.mai@ens.fr Sites de l’ITEM et de l’ É quipe Aragon: http://www.item.ens.fr http://louis-aragon-item.org [1] Louis Aragon, La Défense de l’infini [1986], édition renouvelée et augmentée par Lionel Follet, Paris, Gallimard, coll. Les Cahiers de la NRF, 1997, p. 267. [2] Louis Aragon, «Le Paysan de Paris» [1926], Œuvres poétiques complètes I, Paris, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 2007, p. 180-181. [3] Louis Aragon, La Défense de l’infini , op.cit., p. 69.
↧
Early Modern Book Project
The Early Modern Book Project vise à mettre en relation des jeunes chercheurs travaillant de près ou de loin sur le livre à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne. Les chercheurs confirmés et les professionnels des métiers du livre sont bien sûr les bienvenus dans le projet. Prenant acte des frontières disciplinaires souvent très rigides et, parfois, de l’absence de communication, ce projet cherche à favoriser la circulation de l’information et le partage des compétences scientifiques et techniques dans le domaine du livre manuscrit et imprimé à un niveau international. Pour ce faire, un site a été créé, https://embookproject.org/ , qui s’articule autour de plusieurs axes:D’abord un « Who’s who » des jeunes chercheurs travaillant sur ce domaine. Le Member Directory est un moyen de retrouver facilement les personnes s’intéressant à un aspect spécifique du sujet.Le calendrier , ouvert à tous, permet de repérer les conférences, les appels à contribution et les offres de postes liés à l’histoire du livre.Le forum, réservé aux inscrits, est un espace d’échange informel, où il est possible de se tenir informé des nouvelles publications et de demander des conseils d’aide à la recherche: renseignements bibliographiques, traductions, transcriptions, identifications de provenances, d’éditions, de textes, d’images (entre autres).Un glossaire multilingue des termes liés à l’histoire du livre est également en cours de constitution. Outre cette plate-forme en ligne, nous souhaitons organiser des rencontres et ateliers ouverts aux membres ainsi qu’aux autres chercheurs, où chacun pourra intervenir en fonction de ses centres d’intérêt.Des ateliers thématiques seront l’occasion pour les jeunes chercheurs de se former à des méthodes issues de toutes les disciplines liées à l’étude du livre ancien, qui peuvent leur être utiles dans leur recherche: par exemple la codicologie, la bibliographie matérielle, le catalogage, les instruments de recherche, l’analyse des textes et des images…Sur le long terme, des journées d’études et stages auprès de spécialistes du domaine sont également envisagées. *** The Early Modern Book Project aims to put young scholars working on Late Medieval and Early Modern manuscripts and printed books in contact with each other. Senior scholars interested in the subject are of course welcome to join. To bypass the disciplinary boundaries within the Humanities and the lack of communication among institutions, we want to encourage the sharing of information and technical skills related to the study of manuscript and printed books at an international scale. To that end, a website has been created, https://embookproject.org/ , consisting of four parts:As a " who's who " of young scholars working on the subject, the Member Directory is a mean to get in touch with people working on a specific aspect of the subject.A calendar , accessible to all, was designed to isolate information about the conferences, call for papers, and job offers related to book history.A forum , which is all about informal exchanges between the members – its access is therefore restricted. Here members can keep themselves up to date with recent publications and seek assistance from other members (bibliographical advices, translating or transcribing texts, identifying the past owners of copies, identifying editions, texts, images).A multilingual glossary is currently being developed. Aside from this online platform, we wish to organize meetings and workshops open to members and other scholars, where people will be able to take part depending on their research interests.Thematic workshops will be set up to allow young scholars to learn more about the various methods used to study rare books. These skills would definitely be an asset to their research. For example codicology, material bibliography, cataloging, research tools, analyzing texts and images.In the future, we also wish to organize conferences and summer schools , with the help of experts in the field of book history.
↧
↧
Humanités numériques et science du texte
Humanités Numériques et Science du Texte (Annonce du Colloque) Le colloque« HUMANITÉS NUMÉRIQUES ET SCIENCES DU TEXTE » organisé: à la Maison de l'Amérique Latine 217, boulevard Saint-Germain, à Paris par le DIMé « Sciences du texte et connaissances nouvelles », en collaboration avec le DIM « Matériaux anciens et patrimoniaux » et le DIM « Islam en France : histoire, culture et société » aura lieu les 18, 19 et 20 octobre 2017 Mercredi 18 octobre 2017 8h30 Accueil des participants 9h00 Ouverture par les représentants de la Région Île-de-France et de son Conseil scientifique Présentation du colloque par Pierre Glaudes (CELLF, OBVIL, Paris 4 - DIMé STCN) 9h45 Conférence: Jean-Gabriel Ganascia (LIP6, OBVIL, Paris 6 - DIMé STDN), « Vers une stylistique numérique?» 10H15 Discussion et pause 10h45 PANEL LITTÉRATURE Modérateur: Didier Alexandre (CELLF, OBVIL, Paris 4) Andrea Del Lunga (ALITILHA, Lille 3), Jean-Gabriel Ganascia (LIP6, OBVIL, Paris 6 - DIMé STCN), « Balzac, à l'épreuve des softwares : le projet Phoebus» Alexandre Guilbaud et Irène Passeron (AMIA - A. Guilbaud, M. LecaTsiomis, 1. Passeron et A. Cernuschi, Paris 6), « L'édition critique de corpus : l'exemple de l'Encyclopédie de Diderot et D'Alembert» Didier Alexandre, Paule Desmoulière et Krystelle Denis (OBVIL, Paris 4), « Beautiful data: la plateforme Apollinaire, ses enjeux scientifiques, patrimoniaux, pédagogiques» 12h15 Pause 14h00 Conférence: Didier Guével (IRDA, Paris 13): « L'aide à la décision juridictionnelle, du récolement préalable des décisions des juridictions et des données juridictionnelles ouvertes» 14h30 Conférence: Franck Rebillard (lrmeccen, Paris 3), « Les méthodes numériques au service de la triangulation méthodologique : exemple de travaux sur l'information en ligne» 15h00 Discussion 15h15 PANEL COMMUNICATION Modérateur: Fanny Georges (ISCC, lrmeccen, UP3) Josiane Jouët (CARISM, Paris 2), « Que nous disent et ne nous disent pas les traces communicationnelles » Étienne Candel (GRIPIC, (ELSA et PRU Lyon 3), « L'écriture de la médiation dans les textes du Web contemporain» 16h45 Pause 17h00 PANEL SCIENCES JURIDIQUES Modérateur: Didier Guével (IRDA, Paris 13) Guilhem Julia (IRDA, Paris 13), « Les enjeux numériques pour le droit» Vann-Arzel Durelle-Marc (CERAL, Paris 13), « La numérisation des sources de l'histoire d'un droit: base BAUDOIN et base LEXDIR » 18h00 Discussion 18h15 Table ronde:« Humanités numériques/ humanités médicales - Humanités numériques/ sciences et technologies» Modérateur: Élisabeth Belmas (IRIS, Paris 13) Nicolas Bacaër (UPMC, UMMISCO), « Histoires de mathématiques et de populations » Aurélia Chevalier (Bologne, DIM Matériaux anciens et patrimoniaux), « La recherche en conservation-restauration du patrimoine» Cécilia Bobée (LIED, Paris 7), « Géomatique et Histoire des énergies renouvelables. Le cas des moulins à eau et à vent en région parisienne» Jeudi 19 octobre 2017 9h00 Conférence : Frédéric Duval et Vincent Jolivet (École des Chartes), « L'École des Chartes et les humanités numériques: projets en cours et perspectives» 9h30 Discussion 9h45 PANEL HISTOIRE, HISTOIRE DE L'ART, ARCHÉOLOGIE Modérateur: Pierre Chastang (DVPAC, PATRIMA, UVSQ, DIM Matériaux anciens et patrimoniaux) Maroun Aouad et Jawdath Jabbour (Centre Jean Pépin, CNRS, DIM Islam en Île-de-France, histoire, culture et société),« Le projet sur le patrimoine philosophique manuscrit de langue arabe et son utilisation de la base ABJAD » Laurent Hab lot et Matteo Ferrari (EPHE, SAPRAT), « La base ARMMA » 11h15 Pause 11h30 Conférence: Giuseppe Celano (OH, Leipzig),« Digital Humanities and ancient Greek: how ta automatically parse a twenty-two million token corpus» 12h00 Discussion et pause 13h45 Conférence: Mathieu Arnoux (Géographie-cités, LIED, Paris 7), « Humanités numériques et énergie. Un domaine interdisciplinaire pour un thème de recherche interdisciplinaire» 14h15 Conférence: Jean-Guy Meunier (UQAM), « Humanités numériques et modélisation scientifique» 14h45 PANEL GÉOGRAPHIE, SOCIOLOGIE Modérateur: Catherine Mering (LIED, Paris 7) Gérald Branner (LIED, Paris 7), « À la recherche de nouvelles traces sociales: l'exemple des conspirationnistes » Julien Thorez (Mondes iranien et indien, Paris 3), « Créer un atlas numérique du monde iranien : la naissance de CARTORIENT » Frédéric Alexandre (Pléiade, Paris 13), «Sahel» 16h15 Pause 16h30 PANEL LINGUISTIQUE Modérateur: Franck Neveu (STIH, ILF, Cnrs) • André Salem (ILPGA, Paris 3), « Textométrie : apports, limites et perspectives » • Julien Longhi (AGORA, Cergy-Pontoise),« Humanités numériques: corpus et informatisation» Vendredi 20 octobre 2017 9h00 PANEL SCIENCES POLITIQUES ET SOCIOLOGIE Modérateur: Dominique Cardon (Medialab, IEP Paris) • Sylvain Parasie (LISIS, Paris-Est/ Marne-la-Vallée),« Ce que les nouvelles méthodes font à l'analyse de corpus textuels en sociologie» • Jean-Philippe Cointet (Medialab, IEP Paris) 10h30 Pause 10h45 Conférence: Hughes-Jehan Vibert (Ministère de la Justice, Réseau Francophone de Diffusion du Droit, JurisPedia), « La grande bibliothèque du droit pour le réseau francophone de diffusion du droit» 11h15 Conférence: Dominique Cardon (Medialab, IEP Paris),« La politique des algorithmes» 11h45 Discussion et pause 14h00 Conférence : Robert J. Morrissey (Chicago) et Glenn Roe (Australian National University),« Effets d'optique textuelle: les grandes bases de données et les humanités numériques» 14h30 Discussion 14h45 Table-ronde : « Archives et enquêtes à l'heure des Humanités numériques» Modérateur: Lucien Castex (lrmeccen, Paris 3, DIMé STCN) • Emmanuelle Bermès (BnF) • Thomas Drugeon et Éléonore Alquier (INA) • Jessica Nelson (Éditions des Saints-Pères) • Alexis Poulin (le Monde Moderne) 16h00 Clôture, par Xavier-Laurent Salvador (Paris 13, DIMé STCN)
↧
Puissances esthétiques du virtuel: dispositif, forme, pensée.The Aesthetic Potential of the Virtual: Device, Form, Idea.
Appel à contribution Colloque International, Université Paris-3 Sorbonne Nouvelle, IRCAV Du 28 au 30 mars 2018 (INHA, Paris) Date limite d’envoi des propositions: vendredi 10 novembre 2017 English version below Qu’est-ce que le virtuel et qu’est-ce que l’esthétique du virtuel, au-delà même de leur manifestation à travers l’innovation technologique et de leur incarnation par le biais des nouveaux médias ? Quelle est leur généalogie et quelle est cette pensée du réel et de l’art qui s’incarne au juste avec les avancées technologiques, quels sont leurs enjeux aussi bien esthétiques, qu’éthiques, politiques, médiatiques et plus profondément philosophiques? L’intégration massive des dispositifs virtuels dans tous les domaines de la société ou le «mouvement général de virtualisation» (Pierre Lévy) affecte non seulement son fonctionnement mais aussi la pensée même de son organisation, reconfigure les rapports entre les médias et la politique (post-truth politics), entre les procédés de création et ceux de communication, réinvente l’idée même de l’enseignement et de la transmission du savoir («l’intelligence inventive se mesure selon la distance au savoir», Michel Serres, Petite poucette ) et influe directement sur le domaine de l’industrie et de l’esthétique cinématographique et celui des arts de façon plus générale. Si toute rupture dans la manière de faire de l’art nécessite une rupture dans la manière de le penser(Jacques Rancière, Malaise dans l’esthétique ), pourrait-on alors essayer de concevoir l’impact du virtuel avec sa juste part de virtualité, en définissant le double mouvement d’interdépendance entre la technologie et le concept même en tant qu’idée philosophique forte: une pensée à l’origine de la technique, une technique au service de l’établissement et de la mutation de la pensée? Il semble donc nécessaire de définir et d’historiciser aujourd’hui cette notion esthétique complexe qui s’étend au-delà ou en-deçà de son attachement direct aux nouvelles technologies. Le but de ce colloque est de mieux cerner le concept de virtuel, notion très riche et pour cette raison encore très incertaine, afin de tracer une cartographie conceptuelle de ses problématiques philosophiques et théoriques pour mieux s’orienter dans l’esthétique, les technologies et les arts contemporains. Le premier axe de réflexion concerne donc la question de l’origine philosophique du virtuel. La notion de virtuel, qui dérive du latin virtus , la vertu et la force, est originellement associé en philosophie au terme de puissance. La tradition classique se base sur la conception du terme Dynamis d’après Aristote, qui désigne toute forme de pouvoir, de force. Telle puissance, passive ( pathètikè ) ou active ( poiètikè ) est toujours liée à l’acte ( energeia ), le passage d’un état potentiel à un état actuel. La puissance est du côté de la matière, tandis que l’acte se réalise dans la forme - l’essence qui précède la puissance, l’idée de forme étant déjà inscrite dans cette dernière (doctrine du «premier moteur immobile», origine comme acte pur). Deleuze, et avant lui Bergson, renverse la position classique et remplace "puissance" par "virtuel", en proposant la double opposition célèbre: «si le réel s’oppose au possible, le virtuel, quant à lui, s’oppose à l’actuel» ( Différence et Répétition ). Deleuze dote ainsi le virtuel «de pleine réalité, en tant que virtuel» et propose de considérer tout objet comme ayant «une de ces parties dans le virtuel», qui loin d’être indéterminé constituerait plutôt une dimension objective à l’origine du procédé d’actualisation. Plus récemment, Pierre Lévy oriente la réflexion sur la définition du mouvement concomitant, celui de virtualisation et le définit en tant que problématisation c’est-à-dire qu’«au lieu de se définir par son actualité (une "solution"), l’entité trouve désormais sa consistance essentielle dans un champ problématique. » (Pierre Lévy, Sur les chemins du virtuel ) Le virtuel est donc tour à tour puissance , pleine réalité , problématisation . Ainsi nous voudrions retracer une généalogiedu concept de virtuel à travers la définition des problématiques philosophiques qui le composent et auxquelles il se rapporte. Le deuxième axe propose de réfléchir sur la définition de l’esthétique du virtuel de manière générale et sur l’esthétique virtuelle cinématographique de manière plus particulière. Trois questions esthétiques majeures attirent notre attention: le thème de la fiction, la préexistence du virtuel dans le cinéma argentique (et, de manière plus large, dans les arts plastiques) et la nécessité d’une meilleure définition des formes filmiques contemporaines ainsi que de formulation d’un nouveau vocabulaire cinématographique lié au développement des nouvelles technologies. La question de la fiction se pose comme un des vecteurs principaux de virtualisation. De quelle manière les dispositifs virtuels, en tant que moyens de productivité autonome, redéfinissent le concept de fiction au niveau esthétique? Comment la fiction audiovisuelle de nos jours manifeste une ouverture d’espaces de liberté encore inexplorés par le récit traditionnel ? La généalogie de l’esthétique du virtuel se pose aussi dans le cinéma argentique ou, de manière plus large, dans l’art objectal. Suite à des travaux de Lev Manovich, par exemple, qui considère Vertov comme «un important cinéaste de bases de données», mais aussi à partir de réflexions plus abstraites autour de la définition même de l’image cinématographique, nous aimerions réfléchir sur les prémices des manifestations techniques, plastiques et conceptuelles du virtuel au cinéma avant même l’apparition des nouvelles technologies. Enfin, on observe aujourd’hui l’insuffisance du vocabulaire d’analyse filmique, l’extrême malléabilité de l’image modifiant la notion même du plan, refusant son autorité en tant qu’unité fondamentale du cinéma. Peut-on encore évoquer les termes de «travelling», de «point de vue», de «plan-séquence» en rapport aux images générées par l’ordinateur? Quelle est l’instance énonciatrice de ces images? Quel type de définitions pour de nouvelles formes filmiques virtuelles ou les formes qui leur sont apparentées? Le troisième axe concerne plus directement les dispositifs virtuels de production, de diffusion et de conservation, cette dernière constituant une des préoccupations actuelles d'une importance primordiale tant du côté institutionnel qu'artistique, tandis que la toute récente polémique créée au Festival de Cannes autour du film Okja de Bong Joon-ho financé par la plate-forme américaine de vidéo à la demande Netflix, pose directement la question de la réorganisation de la filière cinématographique dans son ensemble et confirme la nécessité de revoir la définition du dispositif cinématographique (Gaudreault, Marion, Soulez), de l’industrie cinématographique et de son économie. Quels sont donc les enjeux aussi bien esthétiques, éthiques que politiques d’une nouvelle économie virtuelle? Ce travail de réflexion commune sera finalisé par une publication des actes du colloque. Les propositions de communication en français ou en anglais ( de 500 à 800 mots maximum ) sont à envoyer à l’adresse suivante colloquevirtuel@gmail.com et doivent s’inscrire dans une des catégories théoriques proposées, sans pour autant être tenues de respecter les sous-catégories, présentées à titre indicatif. Merci de bien vouloir indiquer la catégorie choisie ainsi que de nous faire parvenir un bref cv de 10 lignes. Catégories de réflexion du colloque: I. Histoire, archéologie et politique du concept de virtuel. - Proposition d’historisation et de définition du concept de virtuelen philosophie depuis ses origines, recherche des concepts apparentés qui contribuent à sa constitution et à sa diffusion. - Retour sur la notion de virtuel à partir de la réflexion de la philosophie contemporaine (Kierkegaard, Bergson, Bloch, Deleuze, Serres, Lévy, Souriau, Simondon, Châtelet, etc.) II. Vers une esthétique du virtuel. - Théories et analyse de la dimension esthétique du virtuel. - Problèmes du vocabulaire esthétique du virtuel (qu’est-ce qu’une forme virtuelle, etc.) - Définition de l’art virtuel, question de la perméabilité des frontières (réalité virtuelle et augmentée, créations numériques, GIF, site internet évolutif Gorgomancy de Chris Marker, cinéma 4 D, etc.) - Virtualité de la fiction dans les médias et les arts. Le concept de post-vérité. III. La virtualisation des formes filmiques. Esthétique du virtuel au cinéma. - Histoire esthétique et technique de l’évolution du virtuel au cinéma (cinéma virtuel, motion capture) versus esthétique du virtuel (présence du virtuel dans le cinéma argentique). - Redéfinition des formes filmiques contemporaines à partir de la notion et des innovations techniques et conceptuelles du virtuel. - Evolution technique et son influence sur l’esthétique du film. - Repenser le vocabulaire de l’analyse filmique à l’aune du virtuel: problèmes de vocabulaire (notions de plan, de plan-séquence, de montage, de mixage d’images, de l’instance qui «filme» ou génère des images, etc.) IV. La virtualisation de l’objet film, de son dispositif et de l’institution cinématographique. 1. Théories d’éclatement des dispositifs, problèmes d’exploitation et de diffusion. - «Cinéma éclaté» comme virtualisation du dispositif. - Recherche de la définition-limite pour penser la distance entre le dispositif «d’accueil» et celui faisant partie intégrante de l’œuvre. - Recherche autour des problèmes éthiques que pose le procédé de virtualisation de l’objet film et de la filière cinématographique. 2. Problèmes de conservation. - Déterminer les enjeux et les problèmes liés à la conservation des archivescinématographiques et audiovisuelles numériques (INA, La Cinémathèque Française, Centre Pompidou, BnF, etc.) et des œuvres numériques. Bibliographie indicative, non exhaustive. Aristote , Métaphysique , présentation et traduction par Marie-Paul Duminil et Annick Jaulin, Paris, Flammarion, 2008. Henri Bergson, La Pensée et le mouvant , Paris, PUF, coll. «Quadrige», 2005 (1934). Etienne Souriau, Les différents modes d’existence , Paris, PUF, coll. «MétaphysiqueS», 2009 (1943). Gilles Deleuze, Différence et répétition , Paris, PUF, coll. «Épiméthée», Paris, 2003 (1968). Michel Serres, Atlas , Paris, Julliard, 1994. Pierre Lévy, Qu’est-ce que le virtuel? , Paris, La Découverte, 1995. Lev Manovich, Le langage des nouveaux médias , Dijon, Les Presses du réel, 2010 (2001). David Rodowick, The Virtual life of Film , Harvard University Press, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007. Angel Quintana, Virtuel?, à l'ère du numérique, le cinéma est toujours le plus réaliste des arts , Paris, Cahiers du cinéma, 2008. André Gaudreault et Philippe Marion, La Fin du cinéma ? Un média en crise à l’ère du numérique, Paris, Armand Colin, 2013. Jacques Aumont, Limites de la fiction, Considérations actuelles sur l’état du cinéma , Paris, Bayard, 2014. Notices «Virtuel» de Aurélie Ledoux, et «Fiction» de Serge Chauvin, dans le Dictionnaire de la pensée du cinéma , Antoine de Baecque, Philippe Chevallier (dir.), PUF, 2012. Comité scientifique: Jacques Aumont Jean-Michel Durafour Antoine Gaudin Olga Kobryn Massimo Olivero Guillaume Soulez Angel Quintana Avec le soutien de: IRCAV (Institut de Recherche sur le Cinéma et l’Audiovisuel), Université Sorbonne Nouvelle -Paris III Call for papers International Conference, Université Paris-3 Sorbonne Nouvelle, IRCAV 28-30 March 2018 (INHA, Paris) Submission Deadline : November 10th, 2017 What is the virtual and what is the aesthetics of the virtual, beyond how we see them through technological innovation and their incarnation through new media? What is their origin and what is this idea of reality and art that we see embodied in technological advances, what are their aesthetic, political, media and more deeply philosophical implications? The massive integration of virtual apparatuses in any societal domain, which Pierre Lévy called the “general movement of virtualization”, affects not only the way society functions, but also its very arrangement and organization. It reconfigures the relationship between media and politics (“post-truth politics”), as well as the one between the acts of creation and the acts of communication. It also reinvents the very concept of teaching and of the transmission of knowledge (“inventive intelligence is to be measured against the distance from knowledge”, Michel Serres, Thumbelina ), and directly affects fields such as industry, cinematic aesthetics and the arts more generally. If “every disruption of the way art is made needs a disruption of the way it is thought of” (Jacques Rancière, Aesthetics and its Discontents ), would it be possible to tentatively conceptualize the impact of the virtual, carrying its due share of virtuality, by defining the twofold interdependence between technology and the concept itself as a strong philosophical idea: thinking as the origin of technology, and at the same time technology at the service of the setting up and of the transformation of thinking? Therefore, it seems necessary to define and historicize this complex aesthetic notion stretching beyond its direct involvement in new technologies. This conference sets out to better pinpoint the concept of the virtual (a very rich notion and, precisely as such, still a very uncertain one) in order to draw a conceptual map of its theoretical and philosophical issues, to get a better sense of aesthetics, of technology and of contemporary art. The first axis of our reflection thus concerns the issue of the philosophical origins of the virtual. In philosophy, the notion of the virtual, deriving from the Latin virtus (which stands for virtue as well as strength), has been associated from the very outset with the term “potential”. Classical tradition rests upon the concept of dynamis as devised by Aristotle, designating any kind of power, strength or potential. Be it passive ( pathètikè ) or active ( poiètikè ), this concept has always been linked to that of actuality ( energeia ), i.e. the shift from a potential state to an actual state. The potential is on the side of matter, whereas actuality is realized in form; here (that is, according to the doctrine of the “unmoved mover”, or of the origin as pure act), the essence precedes the potential, as the idea of the final form is originally embedded in the potential. Deleuze, as well as Bergson before him, reverses the classical stance and replaces the “potential” with the “virtual”, by putting forward the famous double opposition: “If the real is opposed to the possible, the virtual, on its part, is opposed to the actual” (Gilles Deleuze, Difference and Repetition ). Deleuze thus endows the virtual with “full-fledged reality, qua virtual”, and suggests that every object should be regarded as having “one of its parts in the virtual”, namely a part which, far from being undetermined, would rather make for an objective dimension originating the actualization process. Lately, Pierre Lévy has shifted the focus of this reflection on how the movement of virtualization qua concomitant movement is to be defined; his answer is that it should be defined as a problematization, which is to say that “the essential consistency of an entity is now to be found in a problematic field, as opposed to being defined by its actuality (that is, by a “solution”)” (Pierre Lévy, Becoming Virtual ). Therefore, the virtual is in turn potential , full-fledged reality and problematization . We thus set out to retrace the genealogy of the concept of the virtual by way of outlining the philosophical issues it is informed by and relates to. The second axis concerns the definition of the aesthetics of the virtual in general and more particularly in relation to the cinema. There are three major questions concerning aesthetics which interest us: the theme of fiction, the pre-existence of the virtual in celluloid film (as well as in more traditional visual arts) and the necessity for a better definition of contemporary film forms as well as the formulation of a new cinematic vocabulary related to the development of new technologies. - The question of fiction arises as one of the main vehicles of virtualization. How do virtual devices, as means of autonomous productivity, redefine the concept of fiction at the aesthetic level? How does the audiovisual fiction of today indicate the opening of new spaces of freedom still unexplored by the traditional narrative? - The genealogy of the aesthetics of the virtual also arises in celluloid cinema, and more broadly, in visual arts. Following from the work of Lev Manovich, for example, who considers Vertov as "an important database filmmaker", but also from more abstract reflections on the very definition of the cinematographic image, we would like to consider the beginnings of technical, plastic and conceptual cinematographic manifestations of the virtual before the appearance of new technologies. - Finally, there is today a lack of vocabulary in film analysis, the extreme malleability of the image modifying the very notion of the shot, rejecting its authority as a fundamental unit of film. Can we still use the terms "tracking", "point of view" and "sequence" in relation to images generated by a computer? How do we define these new virtual film forms or forms related to them? The third axis concerns more directly the virtual devices for production, distribution and conservation of films, with the latter being one of the current concerns of most importance, both institutionally and artistically, while the recent controversy seen at the Cannes Film Festival by the film Okja by Bong Joon-ho, financed by the American video-on-demand platform Netflix, has raised the question of the reorganization of the film industry as a whole and has confirmed the necessity to review the definition of the cinematic device (Gaudreault, Marion, Soulez), of the film industry and its economy. Therefore, what are the aesthetic, ethical and political implications of a new virtual economy? The outcomes of our thinking on this subject will be published in the conference proceedings. Abstract proposals, in French or in English, of between 500 and 800 words should be sent to Olga Kobryn and Massimo Olivero (colloquevirtuel@gmail.com) by November 10 th , 2017 . The proposal must fit within one of the theoretical categories proposed, without it being necessary to correspond to the sub-categories, which are provided as an indication only. Please indicate the theoretical category chosen and include a short biography of 10 lines. I. History, archaeology, and politics of the concept of the virtual: - Proposition of the historization and definition of the concept of the virtual in philosophy from its origins. Search for related concepts that contribute to its constitution and its diffusion. - The notion of the virtual in contemporary philosophy (Kierkegaard, Bergson, Bloch, Deleuze, Serres, Lévy, Souriau, Simondon, Châtelet, etc.) II. Towards the aesthetics of the virtual: - Theories and analysis of the aesthetic dimension of the virtual. - Problems of the aesthetic vocabulary of the virtual (what is a virtual form?, etc.) - Definition of virtual art, the question of the permeability of borders (virtual and augmented reality, digital creation, GIF, Chris Marker's website Gorgomancy , 4D cinema, etc.) - Virtuality of fiction in media and arts. The concept of post-truth. III. The virtualization of cinematic forms. The aesthetics of the virtual in cinema: - The aesthetic and technical history of the evolution of the virtual in cinema (virtual film, motion capture) versus the aesthetic of the virtual (presence of the virtual in celluloid film). - Redefinition of contemporary cinematic forms considering the notion of the virtual and considering the technical and conceptual innovations of the virtual. - Technical progress and its influence on the aesthetics of film. - Rethinking the vocabulary of film analysis based on the virtual: problems of vocabulary (notions of shot, sequence, editing, image mixing, etc.) IV. The virtualization of the film as an object, of its device and the cinematographic institution: 1. Theories of diversification of cinematic devices. - Virtualisation of device (cinema “éclaté”, Soulez). - Search for the definition of the distance between the device as a distribution platform and the device as an aesthetic part of the work. - Research around the ethical problems posed by the virtualization of the film as an object and of the cinema industry. 2. Problems of conservation: - To determine the issues and problems linked to the conservation of cinematic archives and digital audiovisual material (INA, La Cinematheque Francaise, Centre Pompidou, BnF, etc.) and digital works. Scientific Committee : Jacques Aumont Jean-Michel Durafour Antoine Gaudin Olga Kobryn Massimo Olivero Guillaume Soulez Angel Quintana
↧
L’œuvre en mouvement, de l’Antiquité au XVII e siècle - 7 et 8 juin 2018
Date du colloque : jeudi 7 et vendredi 8 juin 2018 Peut-on penser de manière positive l’œuvre en mouvement avant la promotion de la sensibilité au XVIII e siècle et l’époque contemporaine ? Là où pour le Socrate d’ Eupalinos, l’œuvre est avant tout mouvement — mobile donc vivante, mouvante donc émouvante —, au Moyen Age, le mouvement ne saurait être qu’agitation, de l’ordre du démoniaque ou de la folie; plutôt que geste, il est gesticulation, codifiée voire jugulée par la règle monastique. Cependant, le mouvement, entre acte et puissance, affecte toutes les catégories de l’être aristotélicien; et l’on ne saurait ignorer l’expression cinétique et gestuelle des émotions dans l’art, de Cluny aux exagérations expressives de l’art rhénan, jusqu’aux codifications de la rhétorique des passions durant la Contre-Réforme. Image de la vie ou dissolution de l’être, à moins qu’il n’en soit l’un des aspects fondamentaux: le colloque interrogera les manières de penser et de représenter le mouvement, afin de saisir le rôle de cette notion pour la définition et la portée de l’œuvre d’art. Une attention particulière sera portée aux œuvres d’art religieuses: le mouvement favorise-t-il ou empêche-t-il la méditation, et quel est son rôle dans la détermination des images saintes et des pratiques de dévotion? Le mouvement sera examiné du point de vue de la création et de la perception de l’œuvre d’art, entre Antiquité, Moyen Âge et première modernité. L’apport des disciplines variées — histoire, histoire de l’art, littérature, arts du spectacle, philosophie, archéologie — sera le bienvenu. Pistes d’étude : Approches théoriques du mouvement (pensées philosophiqueset théologiques ; textes prescriptifs — règles, traités, d’esthétique, de rhétorique); Mouvement et cinétique: formes, perception et valeurs du geste, des déplacements, et du rythme, dans les arts visuels et les arts de la performance (danse, théâtre, installations); Mouvement et mobilité, ponctuelle ou régulière, des œuvres d’art (déplacement, commémoratif ou rituel; processions, entrées royales, ostensions ; etc.); Modalités d’apparition de l’œuvre en fonction de parties mobiles (polyptyques ; Vierges ouvrantes ; éléments amovibles ; etc.); Techniques de représentations du mouvement; Incidences du mouvement sur les formes de l’œuvre d’art, voire sur son identité (variation, amplification, métamorphose) Les propositions de contribution sont à adresser à l’un des membres organisateurs (voir adresses mails infra ) avant le 1er décembre 2017 par voie électronique sous la forme suivante: · Un titre explicite · Un descriptif de 2000 signes maximum, comportant la précision de l’axe choisi et les références bibliographiques convoquées · Le rattachement institutionnel et scientifique du (des) auteur(s) Comité d’organisation : EA 4284 TrAme, UPJV, axe «Cultures Matérielles»: Morgan Dickson (Littérature anglaise du Moyen Âge) : morgan.dickson-farkas@wanadoo.fr Véronique Dominguez (Langue et littérature françaises du Moyen Âge): veronique.dominguez@aliceadsl.fr Marie-Laurence Haack (Histoire ancienne): haackml@yahoo.fr Dominique Poulain (Histoire de l’art médiéval): dp-poulain@orange.fr Philippe Sénéchal (Histoire de l’art moderne): phi.senechal@gmail.com Call for Papers Movement in Text and Object: Antiquity through the Eighteenth Century Dates: 7-8 June 2018 Université de Jules Verne (UPJV) Logis du Roy 9 Square Jules Bocquet, 80000 Amiens, France Proposals should be submitted by 1 December 2017 Can movement be seen in a positive light before the development of the notion of sensitivity in the eighteenth century and the contemporary period? In Paul Valéry’s Eupalinos , Socrates presents the work of art as primarily concerned with movement – it is lively because it is mobile and touching on account of its very changeability. Yet in the Middle Ages, movement is frequently seen as agitation, representing madness or demonic possession. Rather than gesture, it is gesticulation, to be codified and curbed through monastic rule. However, situated between action and power, movement touches all categories of Aristotelian being. Moreover, movement is present in the visual arts: kinetic expression and the visual articulation of emotion appear in a variety of artistic movements, from Cluny through the exuberance of Rhenish art and up to the codification of the rhetoric of the passions during the Counter-Reformation. Movement represents life itself or of the dissolution of the very being, yet can be seen as a fundamental aspect of that being. The conference aims to raise questions of how to think about and represent movement in order to place it in relation to a work of art. Particular attention will be accorded to religious art: does movement aid or hinder meditation, and what is its role in the fabrication of sacred images and devotional practices? Movement will be examined from multiple points of view, including the creation and the perception of works of art from Antiquity through the Middle Ages to the Early Modern period. Perspectives from varied disciplines – archaeology, history, history of art, literature, theatre, sociology and philosophy – are welcome. Proposals are invited on the following, non-exhaustive aspects of movement: – Theoretical approaches to movement: philosophical or theological reflection; prescriptive texts including aesthetic or rhetorical treatises – Movement and kinetics: the form, perception and significance of gesture, displacement and rhythm in the visual and performing arts (dance, theatre and other installations) – The movement and mobility, whether singular or repeated, of works of art: commemorative or ritual displacement, processions, royal entrances or ostensions – The means of making a work of art visible through moving parts: polyptychs, Opening Virgins or detachable parts – Techniques of representing movement – The relation of movement to the form or even identity of a work of art (variation, amplification or metamorphosis) Proposals for papers should be sent to one of the members of the Conference committee before 1 December 2017. Proposals should include the following: – A title – A short abstract (500 words) including the field(s) in which the paper falls – The author’s University or research affiliation Conference committee: EA 4284 TrAme, UPJV, axe «Cultures Matérielles» / Material Cultures: Morgan Dickson (Medieval Literature in English) : morgan.dickson-farkas@wanadoo.fr Véronique Dominguez (Medieval French Language and Literature): veronique.dominguez@aliceadsl.fr Marie-Laurence Haack (History, Antiquity and Classics): haackml@yahoo.fr Dominique Poulain (History of Art, Medieval): dp-poulain@orange.fr Philippe Sénéchal (History of Art, Early Modern): phi.senechal@gmail.com «L’opera in movimento dall’antichità al XVII secolo» Date : giovedì 7 e venerdì 8 giugno 2018 Luogo : Université de Picardie Jules Verne (UPJV) Logis du Roy 9 Square Jules Bocquet, 80000 AMIENS Le proposte sono da mandare a uno dei membri organizzatori entro il primo dicembre 2017 tramite posta elettronica sotto questa forma: -titolo -descrizione di 2000 caratteri al massimo con la precisazione della tematica prescelta e le referenze bibliografiche -affiliazione istituzionale e scientifica dell’autore o degli autori Si può pensare in modo positivo l’opera in movimento prima della promozione della sensibilità nel XVIII secolo e nell’epoca contemporanea? Allorché per il Socrate dell’ Eupalinos , l’opera è anzitutto movimento – mobile quindi vivente, movente quindi commovente – nel medioevo il movimento può essere soltanto agitazione dovuto al demone oppure alla follia; non è gesto, ma è un gesticolare, codificato, anzi limitato dalla regola monastica. Per il movimento, tra atto e potenza, riguarda tutte le categorie dell’essere aristotelico; e non si può lasciare da parte l’espressione cinetica e gestuale delle emozioni nell’arte, da Cluny agli eccessi dell’arte renana, fino alle codificazioni della retorica delle passioni durante la Controriforma. Immagine della vita oppure dello scioglimento dell’essere a meno che non sia uno dei suoi aspetti fondamentali: il convegno tratterà i modi di pensare e di rappresentare il movimento, per capire il ruolo di questa nozione per definire e valutare il significato dell’opera d’arte. Si interesserà particolarmente alle opere d’arte religiose: il movimento incoraggia oppure impedisce la meditazione e qual è il suo ruolo quando si definisce un’immagine come santa e le pratiche di devozione? Il movimento sarà studiato dal punto di vista della creazione e della percezione dell’opera d’arte, tra antichità, medioevo e prima modernità. Il contributo di diverse discipline – storia, storia dell’arte, letteratura, arti dello spettacolo, filosofia, archeologia, sociologia – sarà benvenuto. Spunti per la ricerca: Approcci teorici del movimento (scuole filosofiche e teologiche, testi prescrittivi – regole, trattati di estetica, di retorica). Movimento e cinetica: forme, percezioni e valori del gesto, degli spostamenti, del ritmo, nelle arti visuali e nelle arti della performance (ballo, teatro, installazioni) Movimento e mobilità, puntuale regolare, delle opere d’arte (spostamento, commemorativo oppure spirituale; processioni, ingressi regali, ostensioni…). Modalità di comparsa dell’opera secondo le parti mobili dell’oggetto (polittici, Madonne scrigni; elementi amovibili). Tecniche di rappresentazione dell’oggetto in movimento Conseguenze del movimento sulle forme dell’opera d’arte ed eventualmente sulla sua identità (variazione, amplificazione, metamorfosi…). Comitato organizzativo: Morgan Dickson (Letteratura inglese del Medioevo) : morgan.dickson-farkas@wanadoo.fr Véronique Dominguez (Lingua e letteratura francese del Medioevo): veronique.dominguez@aliceadsl.fr Marie-Laurence Haack (Storia antica): haackml@yahoo.fr Dominique Poulain (Storia dell’arte medievale): dp-poulain@orange.fr Philippe Sénéchal (Storia dell’arte moderna): phi.senechal@gmail.com
↧
Poétiques du texte francophone. Nouvelles approches
Poétiques du texte francophone. Nouvelles approches Colloque Vendredi 20 octobre 2017 – Fondation Lucien Paye 8h45 Accueil des participants 9h15 Ouverture du colloque par Florian Alix (Université Paris-Sorbonne) Session I. Insurrections francophones: déconstruire les impérialismes, repenser la condition de l’écrivain Présidence de séance: Marie Bulté , Université Lille 3 9h30 Nessrine Naccach , Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, «La langue de Molière, “butin de guerre”. Et après?» 9h50 Christophe Cosker , Centre Universitaire de Mayotte, «Poétique et politique de l’écrivain francophone» 10h10 Discussion - 10h30 Pause 10h50 Pascale Montrésor , Université de la Réunion, «La poétique francophone “décoloniale”» 11h10 Sarah Burnautzki , Université de Mannheim, et Kaiju Harinen , Université de Turku, «Poétiques féministes de la littérature “subsaharienne” de langue française : l’intersectionnalité appliquée au contexte africain» 11h30 Discussion - 11h50 Pause déjeuner Session II. Le local, le national et le global: embrasser le monde, traverser les identités Présidence de séance: Chloé Vandendorpe , Université Paris-Sorbonne 14h00 Sanaa Mahroug Mhibik , Université de Bourgogne, «Pour une déterritorialisation de la francophonie» 14h20 Amandine Guyot , Université Paris 13, «Entre espaces et identités : le pouvoir des lieux dans Les Désorientés d’Amin Maalouf» 14h40 Aminata Aidara , Université Cheikh Anta Diop, «Esthétique du transculturel dans le roman francophone: cas du Québec» 15h00 Fiorella di Stefano , Università per Stranieri di Siena, «La théorie de la convergence littéraire dans l’expressivité transculturelle du roman chinois francophone» 15h20 Discussion - 15h40 Pause Session III. Poétiques et politiques de la traduction: fabrique et diffusion des œuvres francophones Présidence de séance: Ninon Dubreucq , Université Paris-Sorbonne 16h00 Maria Teresa Rabelo Rafael , Université Fédérale de Paraïba , «La littérature africaine publiée au Brésil» 16h20 Mirella Botaro , Université de Poitiers, «La francophonie dans la lusophonie: “pour une traduction de Tierno Monénembo, Alain Mabanckou et Léonora Miano au Brésil”» 16h40 Myriam Olah , Université de Lausanne, «Une autre langue dans la langue d’écriture: les textes de Vassilis Alexakis, d’Ágota Kristóf, de Nathalie Sarraute et d’Akira Mizubayashi en comparaison différentielle» 17h00 Discussion Samedi 21 octobre – Fondation Lucien Paye Session I. Disciplines, genres et catégories à l’épreuve des laboratoires théoriques francophones Présidence de séance: Céline Gahungu , Université Paris-Sorbonne 9h00 Ninon Chavoz , Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, «Indiscipline des études africaines: avenir et écueils de la philologie» 9h20 Analyse Kimpolo , Université Paris-Sorbonne, «Le fantastique francophone postcolonial à l’épreuve des théories du fantastique occidental» 9h40 Mahaut Rabaté , Université Paris-Sorbonne, «Poétiques des voix francophones: quelle morale pour la voix?» 10h00 Emna Tounsi et Fatima Zohra Benyahia , Université Bordeaux Montaigne, « La poétique du polar algéro-tunisien féminind’expression française » 10h20 Discussion - 10h40 Pause Session II. Symptômes, crises et thérapies: les herméneutiques du texte francophone au miroir de la psychanalyse et de la biologie Présidence de séance: Stéphanie Vélin , Université Paris-Sorbonne 11h00 Mohammed El Fakkoussi , Faculté des lettres et sciences humaines Sais-Fes, «Pour une approche ethno psychanalytique de la représentation fictionnelle de la folie: question de la critique du texte littéraire maghrébin» 11h20 Xavier Luce , Université Paris-Sorbonne, «Aimé Césaire : une poétique de la rémanence. Pour une approche transdisciplinaire avec les sciences du vivant» 11h40 Discussion - 12h00 Pause déjeuner Session III. Philosophie des littératures francophones: dialogues, dialectiques et esthétiques Présidence de séance: Philippe N’Guessan , Université Paris-Sorbonne 14h00 Mohammed Benazi z , Université Moulay Ismaïl, « L’écriture de soi dans la langue de l’autre chez les écrivains maghrébins d’expression française» 14h20 Karim Nait Ouslimane , Université Paris 13, «Pour une littérature francophone mineure» 14h40 Discussion - 15h Pause Présidence de séance: Orane Touzet , Université Paris-Sorbonne 15h20 Jean-Nicolas Ngangueda , Université Paris-Sorbonne, «Poétique de l’événement dans le texte francophone» 15h40 Alice Desquilbet , Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, «Lutter contre la disparition de l’humain – Articulation des réflexions de Sony Labou Tansi dans 930 Mots dans un aquarium (1983-1987) et de Michel Foucault dans Les Mots et les Choses » 16h Discussion 16h20 Clôture du colloque par Romuald Fonkoua (Université Paris-Sorbonne)
↧
↧
Violette Leduc ou la remise en cause des normes
VIOLETTE LEDUC OU LA REMISE EN CAUSE DES NORMES 20 octobre 2017 En mars 1996, Lille 3 accueillait le premier colloque sur Violette Leduc, 21 ans après, elle renouvèle l'expérience avec une journée d'étude sur cette autrice. La journée commencera à 9h30, dans le bâtiment F, maison de la recherche, salle F0.13. Elle est ouverte à tou-te-s sans réservation au préalable. Il est cependant conseillé de venir en avance pour être sûr d'avoir une place assise. Matin: 9h30 Accueil des participant-e-s 10h –Ouverture de la journée d’étude Violette Leduc: perspectives littéraires et historiques (1945-1970) Florence de Chalonge et Florence Tamagne «Mon cas n’est pas unique»: Violette Leduc et les mouvements sociétaux Modératrice: Marie Derrien (Université de Lille 3, IRHiS) 10h30: Florence Tamagne (Université de Lille 3, IRHiS) Les relations entre femmes: invisibilisation et affirmation (1945-1970) 11h : Ludivine Bantigny (Université de Rouen, GRHis) Visions de l’émancipation: politique, érotisme et lesbianisme 11h30: Alexandre Antolin (Université de Lille 3, Alithila) Ravages de Violette Leduc : écrire l’avortement dans les années 1950 (une perspective génétique) Discussion Déjeuner: 12h15-14h Après-midi Les amitiés intellectuelles de Violette Leduc Modérateur : Olivier Wagner (Conservateur à la BnF, ITEM) 14h: Marine Rouch (Université de Lille 3 / Toulouse –Jean Jaurès, Alithila / FRAMESPA) «Je suis l’ombre qui aime la lumière»: Violette Leduc et Simone de Beauvoir Une amitié littéraire depuis la correspondance 14h30: Caroline Goldblum (Toulouse – Jean Jaurès, FRAMESPA) Françoise d’Eaubonne et Violette Leduc: deux autrices en mal d’amour? Discussion et pause Les portraits de La Folie en tête Modératrice : Florence de Chalonge (Université de Lille 3, Alithila) 16h: Mireille Brioude et Anaïs Frantz(ITEM-CNRS) « Une sentinelle aux portes de la littérature » Violette Leduc hors-la-loi: du marché noir à la prostitution, les portes obscures de la littérature. 16h30: Fanny Van Exaerde(Université de Lille 3/Vrijet Universiteit Brussel, Alithila / CLIC) Étude génétique d’un passage de La Folie en tête : Leduc en visite chez Cocteau Discussion 17h30 – Clôture de la journée d’étude
↧
Lecturer in French, Aberystwyth University
Lecturer in French Department of Modern Languages, Aberystwyth University Grade 7: £34,956 - £38,183 per annum The Department of Modern Languages at Aberystwyth is looking to appoint a Lecturer in French (Teaching and Research), to contribute to core teaching in French Studies. You will teach a combination of literary/cultural modules and language modules within the undergraduate provision of the Department. You will have an excellent command of written and spoken French and English and an established research trajectory which will enable you to contribute to the University’s REF submission for Modern Languages. You will have appropriate experience of teaching French language as well as a range of nonlanguage courses (e.g. current affairs, literature, linguistics, cultural studies, film studies), at university level. The role will also include administration and student welfare responsibilities as well as participation in a range of student recruitment activity. Applications are invited in any area of French Studies post 1900 although preference may be given to candidates specialising in fields other than the literature of metropolitan France. To make an informal enquriy, please contact Professor Wini Davies at wid@aber.ac.uk. Closing date: 30 October 2017 Interviews are expected to take placeduring theweek commencing 6th ofNovember. Ref: ML.17.1557 For information and to apply, please go to http://jobs.aber.ac.uk . We are a Bilingual Institution which operates a Welsh Language scheme and is committed to Equal Opportunities. To promote a flexible workforce, the University will consider applications from individuals seeking full time, part time, job share, or term time only working arrangements. APPOINTMENTS ARE NORMALLY MADE WITHIN 4-8 WEEKS OF THE CLOSING DATE.
↧
"Foi et trahison" ( Acta Iassyensia Comparationis )
Le Comité de Rédaction de la revue académique Acta Iassyensia Comparationis - revue semestrielle, interdisciplinaire, publiée par La Chaire de Littérature Comparée de l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi, Roumanie - vous invite à collaborer au numéro 21 (1/2018), consacré au thème CREDINŢĂ ŞI TRĂDARE / FAITH AND TREASON / FOI ET TRAHISON dans la littérature universelle . Langues acceptées: français, roumain, anglais, allemand, espagnol, italien. Plus d’informations sur: http://literaturacomparata.ro/aic/?page_id=164&lang=fr . La date limite pour l’envoi des articles scientifiques et des comptes rendus est le 15 décembre 2017. La parution du nouveau numéro est programmée pour le 30 mars 2018.
↧
Alain Nadaud, l'exigence d'écrire (Paris)
Colloque : Alain Nadaud, l'exigence d'écrire Université Paris Nanterre, Auditorium Max Weber, Bâtiment W 19-20 octobre 2017 Disparu voici deux ans, Alain Nadaud a profondément contribué au renouvellement des pratiques et des enjeux littéraires au début des années 80. Son oeuvre, son activité éditoriale (création et direction de la revue Quai Voltaire , qui a publié la plupart des écrivains aujourd'hui reconnus comme majeurs), ses textes réflexifs témoignent de cet engagement. Inventeur du "roman d'aventures métaphysiques", il interroge dans ses romans les fondements mêmes de notre civilisation : l'écriture, la première bibliothèque, l'invention du zéro, la croyance religieuse, les récits fondateurs (Ancien testament, Enéide...). Les rencontres que nous lui consacrons rassemblent écrivains, critiques littéraires, artistes et chercheurs autour d'une oeuvre majeure et cependant méconnue. JEUDI 19 OCTOBRE 2017 9h30 Ouverture SYLVIE GOUTTEBARON, directrice de la Maison des Écrivains et de la Littérature DJAMEL MESKACHE, Éditions Tarabuste DOMINIQUE VIART, Université Paris Nanterre La mémoire d'un homme et d'une oeuvre Adresse d’OLIVIER POIVRE D’ARVOR, Ambassadeur de France à Tunis, lue par JEAN-BAPTISTE MALARTRE SADIKA KESKÈS, l’association les amis d’Alain Nadaud et la Galerie Alain Nadaud 11h00 Romans d'aventures métaphysiques Modérateur PAOLO TAMASSIA DOMINIQUE RABATÉ, IUF, Université Paris Diderot : « Jouer du vrai et du faux. Crime et reconstitution dans Auguste fulminant » LAURENT DEMANZE, ENS de Lyon : « Quête de l’écriture et écriture de l’enquête :une lecture du Livre des malédictions » 14h30 Une certaine idée de la littérature Modérateur DOMINIQUE RABATÉ DOMINIQUE VIART, Université Paris Nanterre : « La littérature comme anthropologie critique » PAOLO TAMASSIA, Université de Trento : « Séparation vs autonomie : les enjeux de la littérature selon Alain Nadaud » 15h30 La question éditoriale Modérateur DOMINIQUE VIART JEAN-PHILIPPE DOMECQ, écrivain DJAMEL MESKACHE, Editions Tarabuste SERGE SAFRAN, Editeur 16h30 Lecture ALAIN NADAUD, « Autobiographie semi-fictive » lue par JEAN-BAPTISTE MALARTRE VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 9h30 En lisant, en écrivant Modérateur JEAN-MARC MOURA, IUF, Université Paris Nanterre SILVIA DISEGNI, Université Federico II, Naples : « Nadaud lecteur de Flaubert » FRANÇOIS BERQUIN, Université du Littoral : « Voyage en Grande-Scripturie » 11h00 Alain Nadaud parmi les écrivains Modérateur DJAMEL MESKACHE BELINDA CANNONE, écrivaine GUY CLOUTIER, écrivain PIERRE MICHON, écrivain 14h30 La réception de l'oeuvre Modératrice AGATHE NOVAK-LECHEVALIER, Université Paris Nanterre PHILIPPE-JEAN CATINCHI, Le Monde ALAIN NICOLAS, L’Humanité JEAN-BAPTISTE PARA, Europe 15h30 L'expérience littéraire Modérateur SILVIA DISEGNI SAMIR MARZOUKI, Université de la Manouba, Tunis : « D’écrire j’arrête, ou la cessation de l’écriture comme projet littéraire » HEDIA ABDELKEFI, Université de Tunis El Manar : « La Fonte des glaces au miroir de D’écrire j’arrête » 16h30 Nadaud en images et sur scène Modérateur PHILIPPE-JEAN CATINCHI JACQUES GYSIN, professeur de français SADIKA KESKÈS, plasticienne DOMINIQUE LIÈVRE, musicien JEAN BAPTISTE MALARTRE, comédien DANIEL NADAUD, plasticien Colloque organisé par les éditions Tarabuste et L’Observatoire des Ecritures contemporaines Université Paris Nanterre Responsables Djamel Meskache et Dominique Viart Avec le soutien de Sadika Keskès, l’Association Alain Nadaud, La Galerie Alain Nadaud L’Ambassade de France à Tunis, Le Centre des sciences des Littératures en langue Française de l’Université Paris Nanterre, l’institut universitaire de France et La Maison des Ecrivains et de la Littérature
↧
↧
Temps forts, temps faibles: le temps en effet(s) (Bordeaux)
Temps forts, temps faibles Le temps en effet(s) Université Bordeaux Montaigne, 15-16 mars 2018 Fruit d’un croisement disciplinaire, ce colloque vise à interroger notre rapport au temps en ce qu’il est vécu et pensé de façon clivée entre deux pôles réversibles ou complémentaires. Rien n’est moins égal à une heure qu’une autre heure. Le temps apparaît élastique, il se dilate ou se contracte en autant de temps forts qui se distinguent d’apparents temps faibles. Les moments d’une vie sont hiérarchisés en différents degrés d’importance. Chaque découpe temporelle résulte d’un référentiel donné : le point de vue psychologique sélectionne des instants significatifs du ressenti ; le tempo social est rythmé par la routine monotone ou la cadence événementielle ; enfin, chaque discipline adopte une périodisation qui assoit son discours critique. Le temps ne doit donc pas être considéré comme une évidence, mais plutôt comme un construit intime, social et épistémologique dont il s’agit de comprendre les mécanismes. Ce colloque se donne pour projet de mesurer le coefficient d’intensité du moment vécu, ainsi que les oscillations et retournements impliqués par le couple notionnel « temps forts / temps faibles », tant dans sa construction théorique que dans son expérimentation pratique. Nous faisons l’expérience du temps à travers des cristallisations sensibles et nous établissons des jalons pour le scander. Comment se fabrique la valeur de ces segments tant individuels que collectifs et que dit-elle de ceux laissés dans l’ombre ? Nous proposons d’analyser cette appréhension binaire du temps en adoptant une approche pragmatique. Il s’agira d’examiner les effets de construction qui, dans une œuvre ou une situation, tendent à créer un contraste entre des temps « forts » et d’autres « faibles ». Autrement dit, quelles stratégies président à la mise en lumière d’un moment ou à son invisibilisation ? On se demandera en outre comment un spectateur, un lecteur, un usager réagissent à ces dispositifs concertés (en mobilisant potentiellement les outils d’une esthétique de la réception ) ou au contraire, lorsqu’ils ne se conforment pas à un effet qui avait été programmé pour eux, comment ils s’investissent dans un temps singulier. Comprendre ces effets de sens permettra d’infléchir, de déconstruire ou d’ effectuer de nouvelles appropriations temporelles. I. Faire de l’effet : stratégies de création La composition d’une œuvre littéraire, plastique, musicale, théâtrale ou encore cinématographique, peut reposer sur la complémentarité des temps faibles et des temps forts. L’artiste dose leur proportion pour ménager ses effets, que ce soit sur un plan thématique (scène de première vue, meurtre, détail anodin) ou structurel (climax dramatique, coup de théâtre, chute narrative, cliffhanger , ellipse, installation ou performance rythmées). Si la polarisation vers une fin marquante (le « clou du spectacle ») est courante, certaines œuvres, comme Chronique d’une mort annoncée de Gabriel García Márquez, bousculent ce schéma. Comment les perturbations de l’ordre du récit (analepse, prolepse, etc.) reconfigurent-elles l’intrigue en temps sémantiquement forts ou faibles ? Soulignons que cette partition peut se penser autrement qu’en termes de rupture (les peintres conduisent par exemple le regard vers le point d’orgue du tableau en usant de la composition pyramidale). Le commissaire d’exposition, lui aussi, conçoit la scénographie des œuvres selon un parcours temporel. Pause, coup d’éclat, mise en lumière, sont autant d’effets visant à susciter l’émotion chez le récepteur au sein d’un itinéraire donné. Par ailleurs, la sphère politique connaît également la logique spectaculaire ou tout du moins des processus de ritualisation collective qui mettent à l’honneur un temps de mémoire. La société se rassemble ainsi lors de temps forts (minute de silence, journée commémorative). II. Jouir du temps faible ? La tendance est à la valorisation du temps fort comme si l’existence se mesurait à l’aune d’un film d’action. Mais dans un monde en constante accélération, certains préfèrent l’éloge de la lenteur. À l’image de tous les dérivés de l’adjectif anglais slow ( slow motion , slow food , slow reading , etc.), de nouveaux rythmes à contre-courant émergent. La contemplation esthétique apprécie depuis longtemps ces moments de respirations. Les artistes fin-de-siècle ont privilégié l’évocation de l’ennui, de l’inertie ou du temps mort, tandis que la relative faiblesse évènementielle laisse la place chez Marcel Proust ou Virginia Woolf à l’analyse des variations intimes d’une conscience hyperesthésique. Aujourd’hui, certains créateurs choisissent de même délibérément le « temps faible » comme modalité esthétique à l’exemple des poses longues du photographe Hiroshi Sugimoto ou du vidéaste Bill Viola, qui s’inspire du zen. On pourra aussi se pencher sur les temps intermédiaires, ces laps de temps entre moments «forts » et moments « faibles » ? En se consacrant aux territoires de l’attente , de la simple file d’attente aux camps de migrants, Laurent Vidal et Alain Musset rappellent que le temps faible de l’attente est tramé de rêves et de projets, tendu vers une réalisation. Mais cette attente du temps fort peut créer un malaise lorsque l’intervalle s’éternise. C’est le cas chez l’artiste Douglas Gordon qui dilue dans 24 Hour Psycho (1993) les 1h49 du film Psycho en un spectacle ralenti de 24 heures. Les effets de rythme du film initial laissent place à une suspension éprouvante. III. Relectures : donner du sens au temps Certains effets de sens nous précèdent. De fait, nous pensons le temps dans un cadre spatio-temporel et idéologiquement situé. L’historiographie nous permet de prendre conscience des présupposés inhérents à la sélection de moments-clés par une société donnée. Nous apprenons aussi dans une langue dont le système grammatical constitue déjà une représentation du temps. Sans équivalence stricte avec le passé composé français, le present perfect anglais ainsi que le pretérito perfecto compuesto espagnol reflètent la singularité de l’usage des temps verbaux propre à chaque langue. Le temps fort peut se renverser en temps faible et vice versa . La réversibilité qui s’opère alors est aussi une reconstruction. En effet, les théories se périment, les œuvres et les concepts connaissent des vagues d’appropriation et de déshérence. Que nous apprend la nouvelle faveur du has been ou le succès du vintage ? Le phénomène d’après-coup en psychanalyse réinterprète en différé un moment longtemps resté dans l’angle mort de la conscience comme un temps fort de la vie psychique. Songeons que l’historiographie travaille souvent à une réévaluation. Il faut encore se souvenir que le temps est un construit social. Le travailleur dépend d’un régime temporel légalement fixé. Là s’articulent décisions politiques (congés payés, 35 heures, rémunération des heures supplémentaires…) et choix existentiels : où situer l’accomplissement des individus et des sociétés ? Comment les constructions implicites du temps nous affectent-elles ? Quelle marge de manœuvre existe-t-il pour transformer un temps idéologiquement subi en un temps voulu et réinvesti ? Relire la bipartition entre temps fort et temps faible, l’infléchir ou inverser les polarités du majeur et du mineur sont des procédés sémantiques autant qu’identitaires. Puisque qualifier un temps de « fort » ou « faible » n’est pas un acte innocent, considérer le temps en effet(s) reviendra à se demander ce qui s’ effectue dans chaque appropriation temporelle. Nous chercherons donc à décrypter les processus d’intelligibilité et les dynamiques de (dé)construction à l’œuvre dans notre conception clivée au temps. Nous serons de même attentifs aux nouvelles effectuations du temps, œuvres ou discours, qui entendent formaliser un autre rapport au temps. Modalités de soumission Ces rencontres organisées au sein de l’École doctorale Montaigne-Humanité se veulent éminemment interdisciplinaires ; les jeunes chercheurs y seront les bienvenus. Les projets de communication d’une page maximum, assortis d’une courte présentation de l’auteur, seront envoyés avant le 26 novembre 2017 à colloquetemps@gmail.com Les présentations devront justifier leur inscription dans les axes proposés et indiquer une bibliographie sélective. Les réponses seront notifiées au plus tard le 8 janvier 2018. Le comité d’organisation : Ninon Huerta, doctorante en géographie (UMR 5319 - Passages) ; Julie Lageyre, doctorante en histoire de l’art (Centre François-Georges Pariset - EA 538) ; Chloé Morille, doctorante en littérature comparée (TELEM - EA 4195); Vanessa Saint-Martin, doctorante en études hispaniques (AMERIBER - EA 3656).
↧
J.-K. Huysmans, Œuvres complètes. Tome I - 1867-1879 (éd. par J.-M. Seillan)
 Huysmans (Joris-Karl), Œuvres complètes. Tome I - 1867-1879 Sous la direction de Pierre Glaudes et Jean-Marie Seillan Édition deJean-MarieSeillan Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque du XIXe siècle, 2017 EAN : 9782812451409 1381 pages Prix : 69 € Ce premier volume de l’édition chronologique des Œuvres complètes de J.-K. Huysmans couvre les années 1867-1879. Pourvue d’un riche appareil critique, cette édition prend en compte les travaux de recherche les plus récents et révèle l’évolution complexe et les faces diverses du jeune écrivain. Table des matières
Huysmans (Joris-Karl), Œuvres complètes. Tome I - 1867-1879 Sous la direction de Pierre Glaudes et Jean-Marie Seillan Édition deJean-MarieSeillan Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque du XIXe siècle, 2017 EAN : 9782812451409 1381 pages Prix : 69 € Ce premier volume de l’édition chronologique des Œuvres complètes de J.-K. Huysmans couvre les années 1867-1879. Pourvue d’un riche appareil critique, cette édition prend en compte les travaux de recherche les plus récents et révèle l’évolution complexe et les faces diverses du jeune écrivain. Table des matières
↧
E. Deschamps, Ca1340-1404 : anthologie thématique (éd. par J. Laidlaw et C. Scollen-Jimack)
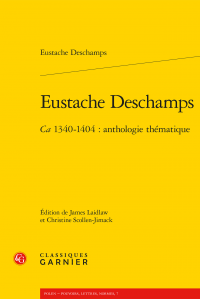 Eustache Deschamps, Eustache Deschamps - Ca 1340-1404 : anthologie thématique Édition deJames Laidlaw et Christine Scollen-Jimack Paris, Classiques Garnier, coll. POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, 2017 EAN : 9782406063568 626 pages Prix : 59 € L'œuvre d'Eustache Deschamps ( ca 1340-1404) est méconnue. Cette anthologie thématique entend réhabiliter ce haut fonctionnaire – bailli de Senlis, militaire, diplomate, voyageur, père de famille – dont les poèmes humains et multiformes évoquent les incertitudes et les plaisirs de la vie. Table des matières
Eustache Deschamps, Eustache Deschamps - Ca 1340-1404 : anthologie thématique Édition deJames Laidlaw et Christine Scollen-Jimack Paris, Classiques Garnier, coll. POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, 2017 EAN : 9782406063568 626 pages Prix : 59 € L'œuvre d'Eustache Deschamps ( ca 1340-1404) est méconnue. Cette anthologie thématique entend réhabiliter ce haut fonctionnaire – bailli de Senlis, militaire, diplomate, voyageur, père de famille – dont les poèmes humains et multiformes évoquent les incertitudes et les plaisirs de la vie. Table des matières
↧
J. Goldzink, G. Gengembre, Madame de Staël, la femme qui osait penser
 JeanGoldzink et GérardGengembre, Madame de Staël, la femme qui osait penser Paris, Classiques Garnier, coll. L'Europe des Lumières, 2017 EAN : 9782406064411 307 pages Prix : 46 € Ce volume sur Mme de Staël comporte deux parties. La première traverse les principales œuvres en écartant l’approche biographique et même interprétative. La seconde rassemble des articles écrits en commun par les deux auteurs durant 25 ans. Lisons Mme de Staël ! Table des matières
JeanGoldzink et GérardGengembre, Madame de Staël, la femme qui osait penser Paris, Classiques Garnier, coll. L'Europe des Lumières, 2017 EAN : 9782406064411 307 pages Prix : 46 € Ce volume sur Mme de Staël comporte deux parties. La première traverse les principales œuvres en écartant l’approche biographique et même interprétative. La seconde rassemble des articles écrits en commun par les deux auteurs durant 25 ans. Lisons Mme de Staël ! Table des matières
↧
↧
M. Proust, La Fugitive. Œuvres complètes, 6 (éd. par L. Fraisse)
 Marcel Proust, La Fugitive. À la recherche du temps perdu,VI - Œuvres complètes, 6 Édition deLuc Fraisse Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque de littérature du XXe siècle, 2017 EAN : 9782406061496 1159 pages Prix : 46 € Le sixième volume d’ À la recherche du temps perdu , paru en 1925, pose d’étranges problèmes éditoriaux, son titre et son contenu offrant des choix opposés. Assortie d’une abondante annotation et d’un large relevé de variantes, c’est la version longue qui est proposée ici, conduisant au Temps retrouvé . Table des matières
Marcel Proust, La Fugitive. À la recherche du temps perdu,VI - Œuvres complètes, 6 Édition deLuc Fraisse Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque de littérature du XXe siècle, 2017 EAN : 9782406061496 1159 pages Prix : 46 € Le sixième volume d’ À la recherche du temps perdu , paru en 1925, pose d’étranges problèmes éditoriaux, son titre et son contenu offrant des choix opposés. Assortie d’une abondante annotation et d’un large relevé de variantes, c’est la version longue qui est proposée ici, conduisant au Temps retrouvé . Table des matières
↧
S. Diaz, Dramaturgies de la crise (XXe-XXIe siècles)
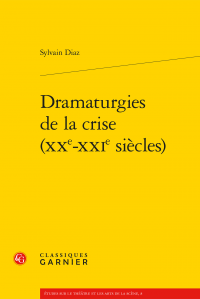 Sylvain Diaz, Dramaturgies de la crise (XXe-XXIe siècles) Paris, Classiques Garnier, coll. Études sur le théâtre et les arts de la scène, 2017 EAN : 9782406065432 303 pages Prix : 46 € Notion dramaturgique majeure au vu de la récurrence de son emploi dans les traités d’esthétique, la crise est pourtant une notion encore à construire, construction à laquelle procède cet ouvrage à partir de l’étude des œuvres de Brecht, Weiss, Bond d’une part, de Horváth, Vinaver, Crimp d’autre part. Table des matières
Sylvain Diaz, Dramaturgies de la crise (XXe-XXIe siècles) Paris, Classiques Garnier, coll. Études sur le théâtre et les arts de la scène, 2017 EAN : 9782406065432 303 pages Prix : 46 € Notion dramaturgique majeure au vu de la récurrence de son emploi dans les traités d’esthétique, la crise est pourtant une notion encore à construire, construction à laquelle procède cet ouvrage à partir de l’étude des œuvres de Brecht, Weiss, Bond d’une part, de Horváth, Vinaver, Crimp d’autre part. Table des matières
↧
L’Illustration en questions (12e séminaire du TIGRE, 2017-2018)
L’ illustration , au sens technique d’image rattachée à un texte qu’elle est censée éclairer ou expliquer, est un terme moderne: il entre dans le vocabulaire spécialisé pour qualifier l’image accompagnant un texte au tout début du xix e siècle en Angleterre. De là, son usage se répand dans les différentes langues européennes selon une chronologie diversifiée suivant le pays et l’aire linguistique. Il n’a pas partout la même valeur ni n’est uniformément admis. À l’heure actuelle, en revanche, son usage s’est installé durablement dans le vocabulaire critique au point qu’on qualifie même par commodité d’ illustration des images qui ne le sont pas ou qui refusent explicitement de l’être. Le douzième séminaire du TIGRE (Texte et Image, Groupe de Recherche à l’Ecole) abordera donc l’illustration en questions : on reviendra à la naissance du terme, à son expansion, aux résistances qu’il rencontre, on réfléchira aux raisons qui ont fini par l’imposer, et aux problèmes que son usage étendu et non problématisé peut engendrer dans la lecture complexe des imprimés (livres, revues, estampes, reproductions, etc.) considérés dans ce séminaire comme des objets culturels. vendredi 6 octobre2017, 16h-19h00 (Résistants) : Ouverture du séminaire. Evanghélia Stead (UVSQ, IUF): L’illustration en questions. Présentation du programme. Approches et tendances actuelles La séance d'ouverture du douzième séminaire du TIGRE sur «l'illustration en questions» présentera une recherche sur les connotations du terme illustration en trois langues (anglais, français, italien), sa nouvelle acception au XIXe siècle et les réactions qu'elle entraîne. Elle fera aussi le point sur les innovations techniques qui modifient la forme de l'imprimé au XIXe siècle et considérera leurs retombées sur la culture visuelle. Elle présentera enfin quelques méthodes et approches du phénomène d'immixtion des textes et des images, pour conclure par la présentation du programme de cette année. vendredi 20 octobre 2017, 16h-19h00(Résistants) : L’image dans la culture de l’imprimé en Angleterre Brian Maidment (Liverpool John Moores University): Illustration before 'Illustration' – the image in print culture, 1820-1840 vendredi 10 novembre 2017, 16h-19h00(Résistants) : Concepts, termes techniques et points de méthode autour d’une notion en France Philippe Kaenel (Université de Lausanne) et Hélène Védrine (Université Paris-Sorbonne): Autour de l’édition du Dictionnaire encyclopédique du livre illustré (XIX e -XXI e siècles) aux éditions Garnier vendredi 24 novembre 2017, 16h-19h00(Résistants) : Alice et Faust à l’épreuve de l’image Déborah Lévy-Bertherat (ENS): La chute d’Alice selon quelques illustrateurs contemporains Evanghélia Stead(UVSQ, IUF) : Usages et abus du terme “illustration” à propos de Faust: le cas d’Alexander Tille vendredi 1 er décembre 2017, 16h-19h00(Résistants): Régimes de l’image dans la presse britannique illustrée, 1860-1890 Tom Gretton (University College London): Illustrations and autonomous pictures in magazines of the Illustrated London News genre in London, c.1860- c.1890: parasitism and symbiosis vendredi 15 décembre 2017 (salle de Conférence, 46, rue d’Ulm), 16h-19h00: L’image face aux contes Ute Heidmann (Université de Lausanne): “Dynamique icono-textuelle” ou illustration? Perrault (1695 et 1697) et l’édition de Hetzel (1862 et 1867) vendredi 12 janvier 2018, 16h-19h00(Résistants) : L’image et la satire Laurent Bihl (Université Paris I) et Julien Schuh (Université Paris X, IUF): L’illustration satirique existe-t-elle? vendredi 26 janvier 2018, 16h-19h00(Résistants) : Images du rêve et de la nuit Jean-Nicolas Illouz (Université Paris VIII): “le plumage du rêve et de la Nuit”: Mallarmé et Redon, “alliés d’art”
↧