Journée d’études La critique musicale en Italie au XX e siècle et son public : Formes d’écriture et politiques de la réception Maison de l’Italie, Cité internationale universitaire 5 juin 2015 Toute critique noue un rapport avec son public. À quelle place, au XX e siècle, la critique musicale italienne met-elle son public, et le public des spectateurs en général ? À quels lecteurs s’adresse-t-elle ? Quel(s) projet(s) a-t-elle pour eux ? Patriotisme et mission spirituelle, légitimité du dilettante versus érudition de l’expert, marquent la critique musicale en Italie dès son émergence au XIX e siècle dans des revues d’abord généralistes ou littéraires, puis spécialisées. Ailleurs aussi en Europe, les discours sur la musique regorgent de qualificatifs visant à caractériser et distinguer des musiques nationales (l’italienne est « solaire », « mélodique », la germanique «harmonique», etc.) Mais l’un des topoï les plus tenaces dans l’histoire des représentations est aussi l’une des armes brandies tout au long du Risorgimento : l’Italie, patrie des arts, patrie de la musique. Ainsi Enrico Montazio, fondateur de la Revue franco-italienne , écrivait-il en 1857 : « L’Europe entière a toujours proclamé l’Italie comme la terre féconde où naissent les plus sublimes artistes en toute chose ». Reprise par les Français eux-mêmes, l’idée que ce « pays des arts » n’est pas fait pour le joug autrichien est omniprésente dans les discours du temps, couplée à la vocation civilisatrice de l’Italie, qui « représente dans l’histoire quelque chose de plus grand encore que la nationalité, selon Arthur de La Guéronnière : « elle représente la civilisation ». Ce mythe civilisateur se nourrit certes de la présence de musiciens italiens dans toute l’Europe, et bientôt dans le monde entier (chanteurs, compositeurs, instrumentistes, pédagogues). Mais pour parler de musique, point n’est besoin d’être praticien : il suffit d’être italien, revendiquait le révolutionnaire républicain Giuseppe Mazzini dans sa Filosofia della musica (1835) : « L’auteur de ces lignes connaît à la musique seulement ce que son cœur lui en a appris [...]. Mais né en Italie, patrie de la musique, [...] où l’harmonie s’insinue dans l’âme dès la première chanson dont une mère berce son enfant, il se sent dans son droit. » La péninsule italienne nouvellement unifiée hérite de ces discours sur la musique et de leurs enjeux politiques singuliers. La critique musicale naissante s’adressait moins aux spectateurs qu’à un cercle restreint de connaisseurs et de musiciens, et visait à forger une génération de compositeurs nationaux dans une Italie à construire : au tournant du siècle, elle tourne désormais vers le peuple ses ambitions pédagogiques (Capra et Nicolodi, 2011). La pensée idéaliste de Benedetto Croce influence plusieurs générations de critiques opposés à la séparation de l’art et de la vie (Luigi Parigi, Massimo Mila), soulignant l’importance de la place accordée au spectateur lecteur par une critique qui doute, se pense et se renouvelle – tantôt dans l’ouverture vers un plus grand public, tantôt vers l’exploration de chantiers de recherche, la constitution de la musicologie et des nouvelles disciplinesqui lui sont liées (la philologie musicale, l’iconographie musicale, ou encore l’organologie). La critique est par ailleurs le lieu où s’élaborent des mythographies autour de figures marquantes de l’histoire de la musique, telle celle de Giuseppe Verdi.Dans quelle mesure le régime fasciste renforce-t-il la réflexion sur la réception de la musique et corollairement de la critique musicale ? La politique culturelle menée est propice au développement de certains champs comme la musique ancienne, populaire ou chorale, avec l’institution d’événements de masse (concerts gratuits, festivals comme le Maggio fiorentino ...) dont la critique musicale se fait largement le relais et qu’elle contribue même à animer. L’édition de 1937 du colloque organisé à Florence autour du Maggio fiorentino est justement consacrée au public : les plumes de la critique musicale du temps, compositeurs, musiciens, musicologues s’y retrouvent ; au cœur de leurs questionnements, des sujets tels que les vertus pédagogiques de la musique ou du moins d’un certain type de musique (dans un parallèle entre musique et sport, le jazz est aussi honni comme la boxe), mais aussi, le développement du cinéma et de la radio. Si la critique musicale continue de se diffuser par le biais de revues spécialisées, animées par des figures comme Luigi Nono ( Rassegna musicale, Rinascita ) ou Luciano Berio (qui fonde et dirige Incontri musicali de 1956 à 1960), ce sont surtout les nouveaux médias qui, après-guerre, vont effectivement bouleverser la critique musicale italienne. Quels nouveaux modes de consommation de la musique et de la critique musicale, quels nouveaux modes d’écriture induisent-ils ? Et comment reconfigurent-ils les enjeux de la réception ? Ce qu’on appelle désormais le « grand public » consomme avec bonheur des musiques auparavant disqualifiées par le discours critique et largement diffusées à la radio comme le jazz. Influencée par les chansons francophones et anglophones, la chanson d’auteur se développe à la fin des années 1950 et connaît un succès plus ample encore : portant les rêves d’amour ou de résistance de tout une génération, elle entretient un rapport complexe avec la critique musicale qui reste encore à explorer. Les critiques contribuent ainsi à diffuser le néologisme cantautore , ils collaborent avec les artistes. Tel est le cas, par exemple, du Club Tenco créé par Luigi Tenco en 1972, une association promouvant la chanson d’auteur, formée de cantautori , producteurs et opérateurs culturels, musiciens et critiques, œuvrant pour constituer la chanson d’auteur non seulement en genre culturel distinct, mais en champ autonome de production culturelle (Santoro, 2000). Par ailleurs, ils confèrent à la chanson sa légitimité par la comparaison avec la poésie, avec un risque aujourd’hui dénoncé par la cantologie : celui de réduire la chanson au texte. Le même parallèle a été observé, de façon plus provocatrice, au sujet du rock (Tondelli, 2001). Mais d’autres critiques peuvent entraver le succès des cantautori ou autres chanteurs populaires : Fabrizio De André est ainsi au centre de polémiques nourries par des critiques attaquant le contenu politique et anarchiste de ses textes; Lucio Battisti refuse d’être médiatisé – en particulier par la presse – pour un public consommateur, disant publiquement « préférer encore l’huile de ricin de la télévision ». Comment, face au journalisme non spécialisé et même people , la critique écrit-elle sur la musique, qu’elle soit classique, jazz, pop ou rock ? N’a-t-elle pas alors conquis sa place ? Si même des critiques aguerris vivent rarement de leur plume (Massimo Mila enseigne au conservatoire puis à l’Université, Fedele D’Amico travaille à la radio EIAR puis enseigne à Rome), cette activité fait aussi vivre des écrivains pour lesquels la plume ne suffit pas, sans parler des figures qui élaborent ainsi un nouveau mode, ponctuel ou régulier, d’intervention publique (Alberto Savinio, Pierpaolo Pasolini, Eugenio Montale, Dino Buzzati, pour ne citer que ceux-là). Cette autorité de critique ou d’écrivain critique doit cependant faire face aux lois du marché : un Beniamino Dal Fabbro, par exemple, ne peut rien contre le divismo qu’il ne cesse de dénoncer, l’adoration people des artistes, les rumeurs et petites nouvelles les concernant, qui occupent de plus en plus d’espace, au détriment du jugement esthétique critique. Par ailleurs, Internet et le numérique remettent bientôt en cause la répartition nette des rôles entre les figures de créateurs, de commentateurs et de spectateurs , que la sociologie a pu considérer comme au fondement de l’importance collective des arts en vertu d’un mécanisme de production du sens semblable à celui qui régente la vie sociale des religions : là où la révélation des prophètes se trouve interprétée par les prêtres avant d’atteindre les fidèles, l’œuvre des artistes fait l’objet des commentaires des experts avant de toucher le public. Si la pyramide hiérarchique s’effondre, quelle utilité recouvre encore l’autorité des commentateurs ? (Benjamin, 1939 ; Bourdieu, 1971 ; de La Fuente, 2001).Le critique musical italien doit donc répondre aujourd’hui à un double défi – au moins – intrinsèquement lié à la question de la réception. D’une part, la critique musicale semble risquer de se réduire, comme c’est souvent le cas aujourd’hui aux États- Unis, à l’opération de marketing : tandis que revues et journaux, papier ou en ligne, réduisent l’espace consacré aux critiques spécialisés, s’appuyant largement sur des critiques culturels touche-à-tout, ils se contentent de plus en plus souvent de reproduire les communiqués que leur transmettent les agences de production – confusion qui pourrait faire l’objet d’une étude de cas italien, menée au prisme des régimes d’écriture. D’autre part, émergent et se multiplient en masse les figures d’auditeurs occupant la position de critiques et recourant à leur rhétorique, mêlée à des procédés nouveaux, en perpétuel changement. Bon nombre de ces derniers sont collaboratifs, à rebours de l’image qui s’est longuement élaborée au fil du XX e siècle du critique singulier, fort de son opinion et de sa position, reconnaissable par elles, fondatrices de sa légitimité. Les réponses qu’apporte la profession sont variées et peuvent être étudiées : création de sites comme www.ilcorrieredellamusica.it , organisation de rencontres par et pour les professionnels, telle celle qui s’est tenue à Sienne le 5 avril dernier, « Il giornalismo culturale e la critica musicale », sous l’égide de l’Ordre national des journalistes, afin de faire le point sur les conditions de travail, le rôle et les espaces du journalisme culturel et de la critique musicale. Cette journée s’inscrit dans le prolongement d’un chantier récemment ouvert sur la critique musicale, et d’un cycle de journées d’études consacrées à la question. Elle entend tirer parti des théories de la réception et des études sur le spectateur développées ces dernières années dans le champ des arts en particulier, en croisant les approches monographiques (études consacrées à un critique, à une revue, qu’elle soit nationale ou régionale), comparées (au sein d’une même aire culturelle ou de plusieurs aires) ou encore synthétiques (une période, une question, etc.). La journée vise ainsi à poursuivre les travaux réunis dans un ouvrage de référence paru sous la direction de Marco Capra et Fiamma Nicolodi ( La critica musicale in Italia nella prima metà del Novecento , Marsilio, 2011). Il s’agira moins cependant de proposer une histoire de la critique musicale en Italie que d’en éclairer les enjeux esthétiques et réceptifs. Pour cela, seront considérés tout le XX e siècle, tout type d’écriture (critique professionnel, mélomane, musicien, écrivain), et tout type de musique – classique, lyrique, jazz, rock, pop, etc., avec une attention particulière au phénomène crucial en Italie des cantautori . Avant tout littéraire et comparatiste, la démarche s’appuiera sur des méthodes innovantes et pluridisciplinaires: seront concernés des domaines aussi variés quel’esthétique, la civilisation italienne, la musicologie, l’histoire de la musique, l’histoire culturelle, l’histoire de l’art ou encore les arts du spectacle. Pour valoriser et exploiter de façon systématique les sources de la critique musicale en Italie, on pourra recourir aux nouvelles ressources numérisées en ligne, récemment développées par des chercheurs italiens et dotées d’outils de traitement statistique et de recherche intégrés : le portail web Permusica ( Banca dati sui Periodici musicali del Novecento, 1900-1970 ), donnant accès à deux bases de données, fruits de deux programmes de recherche italiens, consacrés à la critique et à la presse musicale : BaDaCri ( Banca dati della critica musicale italiana / base de données de la critique musicale italienne) et Permusica (la Base dati dei periodici musicali italiani / base de données des périodiques musicaux italiens). À quoi s’ajoute également le RIPM ( Retrospective Index to Music Periodicals ), qui a indexé un certain nombre de revues italiennes du premier XX e siècle.Seront privilégiées les approches qui présenteront un caractère synthétique ou porteront sur des corpus multiples. Les monographies sur telle ou telle figure ne sont nullement exclues, à la condition toutefois qu’elles s’imposent particulièrement, qu’elles soient mise en perspective, et que les objets « journal » et « revue » ne soient pas perdus de vue. Enfin, toutes ces communications devront contribuer à une meilleure compréhension historique et théorique de la pratique de la critique musicale en général: elles ne pourront faire entièrement l’impasse sur l’approche proprement littéraire (étude des styles, des formes, etc.) et seront particulièrement attentives à tous les propos de type « métacritique » (propos sur la critique tenus par le critique lui- même). Les propositions de communication (environ 500 mots), assorties d’une brève notice bio-bibliographique (5 à 10 lignes rédigées), seront envoyéesavant le 30 septembre 2014 simultanément à Céline Frigau Manning ( celine.frigau@univ- paris8.fr ) et Timothée Picard ( timothee.picard@gmail.com ). Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme sur « La critique musicale au XX e siècle » (Institut universitaire de France). On trouvera la présentation des journées d’études passées ou à venir sur le site du CELLAM ( www.cellam.fr ). Les communications feront l’objet d’une publication en fin de programme. Coordination : Céline Frigau Manning (Univ. Paris 8, EA 1573 Scènes du monde / EA 4385 Laboratoire d’Études romanes) et Timothée Picard (Univ. de Rennes 2, Centre d’Études des Littératures et Langues Anciennes et modernes/Institut Universitaire de France). Références Atti del secondo congresso internazionale di musica. Firenze-Cremona, 11-20 Maggio 1937-XV , Firenze, Felice Le Monnier, 1940.W. Benjamin, « Über einige Motive bei Baudelaire », Zeitschrift für Sozialforschung , n° 8, 1/2, 1939, p. 50- 89, trad. M. de Gandillac, R. Rochlitz et P. Rusch, « Sur quelques thèmes baudelairiens », in Œuvres III , Paris, Gallimard, 2000, p. 329 et suiv. P. Bourdieu, Une interprétation de la théorie de la religion selon Max Weber , Archives européennes de sociologie , XII, 1971, n° 1, p. 3-21.M. Capra et F. Nicolodi (dir.), La critica musicale in Italia nella prima metà del Novecento , Marsilio, Casa della Musica, 2011. Champagne, L’émancipation. Chanson patriotique , Lyon, [s.n.], 1859.E. de La Fuente, « La filosofia weberiana del profeta e il compositore d’avanguardia », Rassegna italiana di sociologia , XLII, 2001, n° 4, p. 513-540.G. Mazzini, Filosofia della musica (1835), trad. M. Kaltenecker, Philosophie de la musique. Vers un opéra social , Paris, Van Dieren, 2001.E. Montazio, Adelaide Ristori, par A. Morand et H. Montazio , Paris, chez l’éditeur, De Soye et Bouchet, 1857. F. Nicolodi, « Mitografia verdiana nel primo Novecento », L. Frassà, M. Niccolai (éd.), Verdi Reception , Turnhout, Brepols, 2013, p. 33-77. 4 A. de La Guéronnière, L’Empereur Napoléon III et l’Italie , 1859.M. Santoro, « La leggerezza insostenibile. Genesi del campo della canzone d’autore », Rassegna italiana di sociologia , XLI/2, 2000, p. 189-223.P.V. Tondelli, Poesia e rock (1987-1989), in Opere , Milano, Bompiani, 2001. 5
 Birahim Thioune et Jack Vivier, Léopold Sédar Senghor : Tourangeau et soldat des idéaux de la FranceParis : L'Harmattan, 2014.100 p.EAN 9782296998612 ( EAN Ebook format Pdf : 9782336350264)12,00 EUR (version numérique : 8,99 EUR)Présentation de l'éditeur :Léopold Sédar Senghor est affecté au lycée Descartes, à Tours, en octobre 1935. Parallèlement à son activité d'enseignement, il contribue à la formation de la conscience ouvrière et observe les péripéties de l'histoire mondiale. A travers la campagne d'Ethiopie et la guerre civile espagnole, il pressent le péril mondial qui arrive en 1939. Ce livre montre la dimension résolument humaniste de l'homme Senghor, dans les domaines de l'engagement social et de l'écriture poétique.Jack Vivier est ancien Résistant et auteur d'ouvrages historiques.Birahim Thioune enseigne à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Birahim Thioune et Jack Vivier, Léopold Sédar Senghor : Tourangeau et soldat des idéaux de la FranceParis : L'Harmattan, 2014.100 p.EAN 9782296998612 ( EAN Ebook format Pdf : 9782336350264)12,00 EUR (version numérique : 8,99 EUR)Présentation de l'éditeur :Léopold Sédar Senghor est affecté au lycée Descartes, à Tours, en octobre 1935. Parallèlement à son activité d'enseignement, il contribue à la formation de la conscience ouvrière et observe les péripéties de l'histoire mondiale. A travers la campagne d'Ethiopie et la guerre civile espagnole, il pressent le péril mondial qui arrive en 1939. Ce livre montre la dimension résolument humaniste de l'homme Senghor, dans les domaines de l'engagement social et de l'écriture poétique.Jack Vivier est ancien Résistant et auteur d'ouvrages historiques.Birahim Thioune enseigne à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
 Birahim Thioune et Jack Vivier, Léopold Sédar Senghor : Tourangeau et soldat des idéaux de la FranceParis : L'Harmattan, 2014.100 p.EAN 9782296998612 ( EAN Ebook format Pdf : 9782336350264)12,00 EUR (version numérique : 8,99 EUR)Présentation de l'éditeur :Léopold Sédar Senghor est affecté au lycée Descartes, à Tours, en octobre 1935. Parallèlement à son activité d'enseignement, il contribue à la formation de la conscience ouvrière et observe les péripéties de l'histoire mondiale. A travers la campagne d'Ethiopie et la guerre civile espagnole, il pressent le péril mondial qui arrive en 1939. Ce livre montre la dimension résolument humaniste de l'homme Senghor, dans les domaines de l'engagement social et de l'écriture poétique.Jack Vivier est ancien Résistant et auteur d'ouvrages historiques.Birahim Thioune enseigne à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Birahim Thioune et Jack Vivier, Léopold Sédar Senghor : Tourangeau et soldat des idéaux de la FranceParis : L'Harmattan, 2014.100 p.EAN 9782296998612 ( EAN Ebook format Pdf : 9782336350264)12,00 EUR (version numérique : 8,99 EUR)Présentation de l'éditeur :Léopold Sédar Senghor est affecté au lycée Descartes, à Tours, en octobre 1935. Parallèlement à son activité d'enseignement, il contribue à la formation de la conscience ouvrière et observe les péripéties de l'histoire mondiale. A travers la campagne d'Ethiopie et la guerre civile espagnole, il pressent le péril mondial qui arrive en 1939. Ce livre montre la dimension résolument humaniste de l'homme Senghor, dans les domaines de l'engagement social et de l'écriture poétique.Jack Vivier est ancien Résistant et auteur d'ouvrages historiques.Birahim Thioune enseigne à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
 Saint-Evremond - L'art du bien vivreClaude Le RoyDATE DE PARUTION : 01/01/14 EDITEUR : Editions H & D COLLECTION : Ecrivains & Normandie ISBN : 978-2-914266-25-3 EAN : 9782914266253 PRÉSENTATION : Broché NB. DE PAGES : 277 p.L'art du bien vivre ? Charles de Saint-Evremond, gentilhomme normand l'a mis en pratique tout au long de sa longue vie (1614-1705). Après de studieuses études, il a su satisfaire son besoin d'action en se faisant soldat auprès des plus prestigieux capitaines, le maréchal de Turenne et le Grand Condé. Il a bénéficié, entre deux campagnes militaires, des récompenses qui comblent le guerrier en devenant l'amant puis l'ami des célèbres courtisanes Marion Delorme et Ninon de Lenclos.Il a su alors associer les jeux de l'amour aux plaisirs de l'esprit dans les salons. Ajoutons le goût de la bonne chère, en fin gastronome, et celui de la musique, à la fois comme auditeur et comme exécutant. Tout cela compose le portrait du parfait honnête homme. L'âge venu, celui d'un long exil en Angleterre, Saint-Evremond a su s'adapter, usant d'une sagesse où l'harmonie et l'équilibre favorisent la sérénité.Il connut alors les joies d'écrire, de converser et de cultiver l'amitié, tellement à l'aise qu'il renonça à revenir en France lorsque enfin on le lui permit ! Correspondant des plus grands esprits de son temps, il repose au Poets' corner en l'abbaye de Westminster. La vie de ce gentilhomme, tour à tour soldat, poète, amoureux, diplomate, philosophe, illustre un art de vivre bien enviable ! Je vous convie à la découvrir.
Saint-Evremond - L'art du bien vivreClaude Le RoyDATE DE PARUTION : 01/01/14 EDITEUR : Editions H & D COLLECTION : Ecrivains & Normandie ISBN : 978-2-914266-25-3 EAN : 9782914266253 PRÉSENTATION : Broché NB. DE PAGES : 277 p.L'art du bien vivre ? Charles de Saint-Evremond, gentilhomme normand l'a mis en pratique tout au long de sa longue vie (1614-1705). Après de studieuses études, il a su satisfaire son besoin d'action en se faisant soldat auprès des plus prestigieux capitaines, le maréchal de Turenne et le Grand Condé. Il a bénéficié, entre deux campagnes militaires, des récompenses qui comblent le guerrier en devenant l'amant puis l'ami des célèbres courtisanes Marion Delorme et Ninon de Lenclos.Il a su alors associer les jeux de l'amour aux plaisirs de l'esprit dans les salons. Ajoutons le goût de la bonne chère, en fin gastronome, et celui de la musique, à la fois comme auditeur et comme exécutant. Tout cela compose le portrait du parfait honnête homme. L'âge venu, celui d'un long exil en Angleterre, Saint-Evremond a su s'adapter, usant d'une sagesse où l'harmonie et l'équilibre favorisent la sérénité.Il connut alors les joies d'écrire, de converser et de cultiver l'amitié, tellement à l'aise qu'il renonça à revenir en France lorsque enfin on le lui permit ! Correspondant des plus grands esprits de son temps, il repose au Poets' corner en l'abbaye de Westminster. La vie de ce gentilhomme, tour à tour soldat, poète, amoureux, diplomate, philosophe, illustre un art de vivre bien enviable ! Je vous convie à la découvrir.
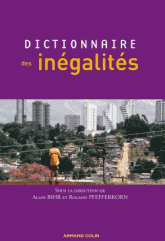 Dictionnaire des inégalitésRoland Pfefferkorn, Alain BihrDATE DE PARUTION : 11/06/14 EDITEUR : Armand Colin ISBN : 978-2-200-27924-0 EAN : 9782200279240, 604 p.En près de 600 entrées, ce dictionnaire interdisciplinaire offre les clés indispensables à la compréhension de la dynamique des inégalités sociales : entre classes et sexes, âges et générations, nationalités et groupes ethniques, selon les différents espaces (villes et campagnes, régions, etc.). Inédit, il donne tous les repéres indispensables sur la question : repères lexicaux, conceptuels et méthodologiques, contextualisation historique et culturelle, vision explicative des inégalités, focus sur des auteurs clés, comparaisons internationales.Sommaire:8 champs d’exploration : - les inégalités entre classes sociales, - les inégalités de genre ou entre sexes sociaux, - les inégalités entre classes d’âge et entre générations, - les inégalités entre nationalités, ethnies, groupes racisés ou racialisés à l’intérieur d’un même État, - les inégalités sociospatiales (entre quartiers urbains, centres et périphéries, entre villes et campagnes, entre régions), - les inégalités au niveau mondial (entre États et groupes d’États, entre continents ou régions continentales, etc.), - les débats autour des inégalités sociales et du concept d’inégalité sociale mettant aux prises les principaux courants philosophiques, politiques et idéologiques contemporains, - enfin les questions de méthode que posent l’étude et la mesure empiriques des inégalités.* * *On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage:"Les inégalités, de A à Z", par C. Ruby.
Dictionnaire des inégalitésRoland Pfefferkorn, Alain BihrDATE DE PARUTION : 11/06/14 EDITEUR : Armand Colin ISBN : 978-2-200-27924-0 EAN : 9782200279240, 604 p.En près de 600 entrées, ce dictionnaire interdisciplinaire offre les clés indispensables à la compréhension de la dynamique des inégalités sociales : entre classes et sexes, âges et générations, nationalités et groupes ethniques, selon les différents espaces (villes et campagnes, régions, etc.). Inédit, il donne tous les repéres indispensables sur la question : repères lexicaux, conceptuels et méthodologiques, contextualisation historique et culturelle, vision explicative des inégalités, focus sur des auteurs clés, comparaisons internationales.Sommaire:8 champs d’exploration : - les inégalités entre classes sociales, - les inégalités de genre ou entre sexes sociaux, - les inégalités entre classes d’âge et entre générations, - les inégalités entre nationalités, ethnies, groupes racisés ou racialisés à l’intérieur d’un même État, - les inégalités sociospatiales (entre quartiers urbains, centres et périphéries, entre villes et campagnes, entre régions), - les inégalités au niveau mondial (entre États et groupes d’États, entre continents ou régions continentales, etc.), - les débats autour des inégalités sociales et du concept d’inégalité sociale mettant aux prises les principaux courants philosophiques, politiques et idéologiques contemporains, - enfin les questions de méthode que posent l’étude et la mesure empiriques des inégalités.* * *On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage:"Les inégalités, de A à Z", par C. Ruby.
 Référence bibliographique : Jeffrey Weeks, Sexualité , Presses universitaires de Lyon, collection "Sexualités", 2014. EAN13 : 9782729708641.Première traduction française d’un ouvrage de Jeffrey Weeks , ce «manifeste intellectuel» est d’ores et déjà un classique anglo-saxon depuis plus de vingt ans. Dès sa première édition, il s’est imposé comme une introduction de pointe aux débats sur les sexualités, le genre et l’intime.Jeffrey Weeks retrace l’histoire de la sexualité, pensée comme une construction sociale, façonnée et remodelée inlassablement par le contexte dans lequel elle existe et s’exprime : la sexualité n’est ni naturelle ni uniforme, mais culturelle et plurielle. Cette approche pionnière permet de couvrir un large champ d’investigation: les traditions religieuses, les politiques identitaires, la mondialisation, l’impact social du sida, l’influence de la génétique et de la psychanalyse, la lutte des sexes, les nouveaux modèles familiaux...Désormais, dans sa troisième édition (qui fait l’objet de cette traduction), cet essai majeur intègre de nouveaux concepts et enjeux, issus en particulier des mouvements LGBT et des débats sur le mariage homosexuel.Professeur émérite de sociologie à la London South Bank University, Jeffrey Weeks jouit d’une réputation internationale dans les études sur la sexualité et la vie intime. On peut retenir parmi ses publications : Sexuality and its Discontents, Against Nature ou Invented Moralities .Le texte a été traduit de l’anglais par une équipe composée de Samuel Baudry, Colette Collomb-Boureau, Baudouin Millet et Nathalie Zimpfer, dirigée par Françoise Orazi.Il est accompagné d’une «Introduction à l’œuvre de Jeffrey Weeks» par Rommel Mendès-Leite, directeur de la présente collection « Sexualités », sociologue et anthropologue social, maître de conférences en psychologie sociale à l’Université Lumière Lyon2 et chercheur au Centre MaxWeber.Sexualité de Jeffrey Weeks,310 p. – 13 € – Presses universitaires de Lyon – Parution mai 2014
Référence bibliographique : Jeffrey Weeks, Sexualité , Presses universitaires de Lyon, collection "Sexualités", 2014. EAN13 : 9782729708641.Première traduction française d’un ouvrage de Jeffrey Weeks , ce «manifeste intellectuel» est d’ores et déjà un classique anglo-saxon depuis plus de vingt ans. Dès sa première édition, il s’est imposé comme une introduction de pointe aux débats sur les sexualités, le genre et l’intime.Jeffrey Weeks retrace l’histoire de la sexualité, pensée comme une construction sociale, façonnée et remodelée inlassablement par le contexte dans lequel elle existe et s’exprime : la sexualité n’est ni naturelle ni uniforme, mais culturelle et plurielle. Cette approche pionnière permet de couvrir un large champ d’investigation: les traditions religieuses, les politiques identitaires, la mondialisation, l’impact social du sida, l’influence de la génétique et de la psychanalyse, la lutte des sexes, les nouveaux modèles familiaux...Désormais, dans sa troisième édition (qui fait l’objet de cette traduction), cet essai majeur intègre de nouveaux concepts et enjeux, issus en particulier des mouvements LGBT et des débats sur le mariage homosexuel.Professeur émérite de sociologie à la London South Bank University, Jeffrey Weeks jouit d’une réputation internationale dans les études sur la sexualité et la vie intime. On peut retenir parmi ses publications : Sexuality and its Discontents, Against Nature ou Invented Moralities .Le texte a été traduit de l’anglais par une équipe composée de Samuel Baudry, Colette Collomb-Boureau, Baudouin Millet et Nathalie Zimpfer, dirigée par Françoise Orazi.Il est accompagné d’une «Introduction à l’œuvre de Jeffrey Weeks» par Rommel Mendès-Leite, directeur de la présente collection « Sexualités », sociologue et anthropologue social, maître de conférences en psychologie sociale à l’Université Lumière Lyon2 et chercheur au Centre MaxWeber.Sexualité de Jeffrey Weeks,310 p. – 13 € – Presses universitaires de Lyon – Parution mai 2014
 Référence bibliographique : Massimo Prearo, Le Moment politique de l'homosexualité. Mouvements, identités et communautés en France , Presses universitaires de Lyon, collection "Sexualités", 2014. EAN13 : 9782729708757.Comment l’homosexualité a-t-elle été pensée par les militant.e.s et comment ce savoir a-t-il participé à la construction des mouvements, des identités et des communautés en tant que discours d’une minorité politique?Depuis l’invention de l’homosexualité par la médecine au XIX esiècle, et tout au long du XX esiècle, le militantisme homosexuel s’est employé à travailler, construire et déconstruire, par moments et par mouvements distincts et singuliers, un savoir et un pouvoir d’action. Arcadie ou les premières expériences collectives des années1950 et 1960, l’effervescence révolutionnaire de 1970 soulevée par le FHAR et soutenue par Le Gai Pied, l’arrivée du VIH/sida dans les années1980 et la lutte imaginée par ActUp, la naissance du militantisme version LGBT à l’aube des années2000: autant de moments de l’analyse politique présentée dans ce livre, qui tente de déconstruire quelques fausses évidences et de présenter les étapes cruciales des stratégies collectives discutées et mises en pratique.Massimo Prearo , lauréat de la bourse européenne Marie Curie, est post-doctorant au Centre de recherche sur les politiques et les théories de la sexualité de l’Université de Vérone. Après avoir soutenu en 2011 un doctorat en études politiques à l’EHESS de Paris, il a été visiting research fellow à l’University of Sussex et a enseigné la science politique à l’Université de la Rochelle. Il est également cofondateur et directeur dela revue Genre, sexualité & société .Massimo Prearo, Le Moment politique de l'homosexualité , préface de Sylvie Chaperon –336 p. – 20 € – Parution mai 2014
Référence bibliographique : Massimo Prearo, Le Moment politique de l'homosexualité. Mouvements, identités et communautés en France , Presses universitaires de Lyon, collection "Sexualités", 2014. EAN13 : 9782729708757.Comment l’homosexualité a-t-elle été pensée par les militant.e.s et comment ce savoir a-t-il participé à la construction des mouvements, des identités et des communautés en tant que discours d’une minorité politique?Depuis l’invention de l’homosexualité par la médecine au XIX esiècle, et tout au long du XX esiècle, le militantisme homosexuel s’est employé à travailler, construire et déconstruire, par moments et par mouvements distincts et singuliers, un savoir et un pouvoir d’action. Arcadie ou les premières expériences collectives des années1950 et 1960, l’effervescence révolutionnaire de 1970 soulevée par le FHAR et soutenue par Le Gai Pied, l’arrivée du VIH/sida dans les années1980 et la lutte imaginée par ActUp, la naissance du militantisme version LGBT à l’aube des années2000: autant de moments de l’analyse politique présentée dans ce livre, qui tente de déconstruire quelques fausses évidences et de présenter les étapes cruciales des stratégies collectives discutées et mises en pratique.Massimo Prearo , lauréat de la bourse européenne Marie Curie, est post-doctorant au Centre de recherche sur les politiques et les théories de la sexualité de l’Université de Vérone. Après avoir soutenu en 2011 un doctorat en études politiques à l’EHESS de Paris, il a été visiting research fellow à l’University of Sussex et a enseigné la science politique à l’Université de la Rochelle. Il est également cofondateur et directeur dela revue Genre, sexualité & société .Massimo Prearo, Le Moment politique de l'homosexualité , préface de Sylvie Chaperon –336 p. – 20 € – Parution mai 2014
 Référence bibliographique : Stéphane François, Au-delà des vents du Nord. L'extrême droite française, le pôle Nord et les Indo-Européens , Presses universitaires de Lyon, collection "Hors collection", 2014. EAN13 : 9782729708740.Depuis les années 1960 se synthétise, notamment autour de la Nouvelle Droite, du Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne (GRECE) et de figures comme celle d'Alain de Benoist, une pensée qui imprègne toute l'extrême droite occidentale. Elle est à la fois l'héritière des thèses de Gobineau, de Günther et du nazisme, et le résultat d'un effort pour s'en affranchir: une pensée racialiste et raciste, mais selon des principes culturels plutôt que biologiques; un discours anticapitaliste, anti-occidental, antichrétien, mais sur fond d'un différentialisme pris chez Lévi-Strauss.Dans cette nébuleuse où les trajectoires sont diverses, il y a un point de fuite: le mythe nordique. Stéphane François propose ici une lecture des sources et des formes de cette littérature d'extrême droite qui a inventé ou réinventé une anthropologie politique et archéologique des Indo-Européens, détournant notamment les travaux de Dumézil et se donnant pour berceau le pôle Nord: une anthropologie s'inscrivant dans la vieille tradition aryaniste, héritage pseudo-scientifique de l'Occident du XIX esiècle.Stéphane François est historien des idées et politologue, docteur en science politique, chercheur associé au Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL) du CNRS et membre de l'Observatoire des radicalités politiques (ORAP) de la fondation Jean Jaurès. Il enseigne l'histoire contemporaine et la science politique à l'Institut de préparation à l'administration générale de Valenciennes. Ses recherches portent sur les droites radicales européennes et leurs relations avec les subcultures (en particulier musicales), le néo-paganisme et l'ésotérisme.Stéphane François, Au-delà des vents du Nord. L'extrême droite française, le pôle Nord et les Indo-Européens – 324 p. – 20 € – Parution mars 2014
Référence bibliographique : Stéphane François, Au-delà des vents du Nord. L'extrême droite française, le pôle Nord et les Indo-Européens , Presses universitaires de Lyon, collection "Hors collection", 2014. EAN13 : 9782729708740.Depuis les années 1960 se synthétise, notamment autour de la Nouvelle Droite, du Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne (GRECE) et de figures comme celle d'Alain de Benoist, une pensée qui imprègne toute l'extrême droite occidentale. Elle est à la fois l'héritière des thèses de Gobineau, de Günther et du nazisme, et le résultat d'un effort pour s'en affranchir: une pensée racialiste et raciste, mais selon des principes culturels plutôt que biologiques; un discours anticapitaliste, anti-occidental, antichrétien, mais sur fond d'un différentialisme pris chez Lévi-Strauss.Dans cette nébuleuse où les trajectoires sont diverses, il y a un point de fuite: le mythe nordique. Stéphane François propose ici une lecture des sources et des formes de cette littérature d'extrême droite qui a inventé ou réinventé une anthropologie politique et archéologique des Indo-Européens, détournant notamment les travaux de Dumézil et se donnant pour berceau le pôle Nord: une anthropologie s'inscrivant dans la vieille tradition aryaniste, héritage pseudo-scientifique de l'Occident du XIX esiècle.Stéphane François est historien des idées et politologue, docteur en science politique, chercheur associé au Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL) du CNRS et membre de l'Observatoire des radicalités politiques (ORAP) de la fondation Jean Jaurès. Il enseigne l'histoire contemporaine et la science politique à l'Institut de préparation à l'administration générale de Valenciennes. Ses recherches portent sur les droites radicales européennes et leurs relations avec les subcultures (en particulier musicales), le néo-paganisme et l'ésotérisme.Stéphane François, Au-delà des vents du Nord. L'extrême droite française, le pôle Nord et les Indo-Européens – 324 p. – 20 € – Parution mars 2014
 Référence bibliographique : Alexander Kluge, L'Utopie des sentiments. Essais et histoires de cinéma , Presses universitaires de Lyon, collection "Le vif du sujet", 2014.Ce recueil est une proposition théorique ambitieuse : pour introduire à l’œuvre monumentale et multiple d’Alexander Kluge, il est composé à la fois d’essais rédigés entre les années 1960 et 1980 (dont on peut lire ici la première traduction française), et de textes littéraires des années 2000, des « histoires » consacrées elles aussi au cinéma et aux médias (dont quatre récits inédits). Sa forme n’est pas sans rappeler la technique même d’Alexander Kluge, qui a constitué son œuvre en constellation de fragments, qu’il expose à toutes sortes de montages et de remontages. Le titre lui-même, L’Utopie des sentiments , rend hommage à la place centrale de la subjectivité dans la vision de l’artiste, qui y voit le lieu d’une rencontre dialectique et révélatrice entre le privé et le public, entre le personnel et le politique. Sa théorie du cinéma met au centre le rôle du spectateur : les films, comme les médias, n’existent que par lui, au cœur de son imagination.Figure centrale de la culture allemande contemporaine, Alexander Kluge est tout à la fois cinéaste, écrivain, enseignant, philosophe, sociologue, théoricien des médias et homme de télévision. Maître de l’essayisme sous toutes ses formes, il est l’un des héritiers les plus inventifs de la Théorie critique de Theodor W. Adorno et conduit une recherche inlassable et inclassable, traversant et réinventant les champs disciplinaires. Parmi ses films les plus connus, on retiendra Anita G. (1966), La Patriote (1979), Le Pouvoir des sentiments (1983) ou encore Nouvelles de l’antiquité idéologique (2009).Les textes ont été réunis et présentés par Dario Marchiori , maître de conférences en histoire des formes filmiques à l’Université Lumière Lyon 2, spécialiste du « nouveau cinéma allemand » et des réalisateurs marginalisés de l’histoire du cinéma. Les « essais » ont été traduits par Christophe Jouanlanne , les « histoires de cinéma » par Vincent Pauval .Alexander Kluge, L'Utopie des sentiments. Essais et histoires de cinéma , Traduit par Christophe Jouanlanne & Vincent Pauval – Textes réunis et présentés par Dario Marchiori – 228 p. – 14 x 20,5 cm – 18 € – Parution juin 2014
Référence bibliographique : Alexander Kluge, L'Utopie des sentiments. Essais et histoires de cinéma , Presses universitaires de Lyon, collection "Le vif du sujet", 2014.Ce recueil est une proposition théorique ambitieuse : pour introduire à l’œuvre monumentale et multiple d’Alexander Kluge, il est composé à la fois d’essais rédigés entre les années 1960 et 1980 (dont on peut lire ici la première traduction française), et de textes littéraires des années 2000, des « histoires » consacrées elles aussi au cinéma et aux médias (dont quatre récits inédits). Sa forme n’est pas sans rappeler la technique même d’Alexander Kluge, qui a constitué son œuvre en constellation de fragments, qu’il expose à toutes sortes de montages et de remontages. Le titre lui-même, L’Utopie des sentiments , rend hommage à la place centrale de la subjectivité dans la vision de l’artiste, qui y voit le lieu d’une rencontre dialectique et révélatrice entre le privé et le public, entre le personnel et le politique. Sa théorie du cinéma met au centre le rôle du spectateur : les films, comme les médias, n’existent que par lui, au cœur de son imagination.Figure centrale de la culture allemande contemporaine, Alexander Kluge est tout à la fois cinéaste, écrivain, enseignant, philosophe, sociologue, théoricien des médias et homme de télévision. Maître de l’essayisme sous toutes ses formes, il est l’un des héritiers les plus inventifs de la Théorie critique de Theodor W. Adorno et conduit une recherche inlassable et inclassable, traversant et réinventant les champs disciplinaires. Parmi ses films les plus connus, on retiendra Anita G. (1966), La Patriote (1979), Le Pouvoir des sentiments (1983) ou encore Nouvelles de l’antiquité idéologique (2009).Les textes ont été réunis et présentés par Dario Marchiori , maître de conférences en histoire des formes filmiques à l’Université Lumière Lyon 2, spécialiste du « nouveau cinéma allemand » et des réalisateurs marginalisés de l’histoire du cinéma. Les « essais » ont été traduits par Christophe Jouanlanne , les « histoires de cinéma » par Vincent Pauval .Alexander Kluge, L'Utopie des sentiments. Essais et histoires de cinéma , Traduit par Christophe Jouanlanne & Vincent Pauval – Textes réunis et présentés par Dario Marchiori – 228 p. – 14 x 20,5 cm – 18 € – Parution juin 2014
 Référence bibliographique : Vincent Amiel, Lancelot du Lac de Robert Bresson , Presses universitaires de Lyon, collection "Le vif du sujet", 2014. EAN13 : 9782729708764.L’objet de cette étude est double: d’une part mettre en perspective les images de Lancelot du Lac de Robert Bresson et celles qui ont traité du même cycle arthurien, des enluminures médiévales au cinéma hollywoodien, d’autre part tenter de situer les innovations poétiques et formelles de ce film dans son temps, dans le contexte du cinéma contemporain. Approche iconographique et esthétique, l’étude du film met en avant l’extrême rigueur formelle de Robert Bresson, et la beauté rare de ses choix de montage. Une analyse des rythmes, des répétitions, des mouvements propres au «cinématographe» de Bresson voisine ici avec une réflexion sur les thèmes des récits de la Table ronde, et la tragédie d’un monde qui disparaît dans un désordre parfaitement mis en forme.Vincent Amiel est professeur d’études cinématographiques à l’université de Caen-Basse Normandie. Directeur de la revue Double jeu , il est par ailleurs critique (pour les revues Positif et Esprit en particulier) et essayiste, dans les domaines du cinéma, mais aussi de la télévision et des images en général. Il a publié notamment Les Ateliers du 7 eart (Gallimard, 1995), Le Corps au cinéma, Keaton, Bresson, Cassavetes (PUF, 1998), Esthétique du montage (Armand Colin, 2001, 2005), Formes et obsessions du cinéma américain contemporain (Klincksieck, 2003), et Joseph L. Mankiewicz et son double (PUF, 2010, Prix du meilleur livre de cinéma, Syndicat de la critique de cinéma). Vincent Amiel, Lancelot du Lac de Robert Bresson – 112 p. – 14 x 18 cm – ill. coul. – 14 € – Parution juin 2014
Référence bibliographique : Vincent Amiel, Lancelot du Lac de Robert Bresson , Presses universitaires de Lyon, collection "Le vif du sujet", 2014. EAN13 : 9782729708764.L’objet de cette étude est double: d’une part mettre en perspective les images de Lancelot du Lac de Robert Bresson et celles qui ont traité du même cycle arthurien, des enluminures médiévales au cinéma hollywoodien, d’autre part tenter de situer les innovations poétiques et formelles de ce film dans son temps, dans le contexte du cinéma contemporain. Approche iconographique et esthétique, l’étude du film met en avant l’extrême rigueur formelle de Robert Bresson, et la beauté rare de ses choix de montage. Une analyse des rythmes, des répétitions, des mouvements propres au «cinématographe» de Bresson voisine ici avec une réflexion sur les thèmes des récits de la Table ronde, et la tragédie d’un monde qui disparaît dans un désordre parfaitement mis en forme.Vincent Amiel est professeur d’études cinématographiques à l’université de Caen-Basse Normandie. Directeur de la revue Double jeu , il est par ailleurs critique (pour les revues Positif et Esprit en particulier) et essayiste, dans les domaines du cinéma, mais aussi de la télévision et des images en général. Il a publié notamment Les Ateliers du 7 eart (Gallimard, 1995), Le Corps au cinéma, Keaton, Bresson, Cassavetes (PUF, 1998), Esthétique du montage (Armand Colin, 2001, 2005), Formes et obsessions du cinéma américain contemporain (Klincksieck, 2003), et Joseph L. Mankiewicz et son double (PUF, 2010, Prix du meilleur livre de cinéma, Syndicat de la critique de cinéma). Vincent Amiel, Lancelot du Lac de Robert Bresson – 112 p. – 14 x 18 cm – ill. coul. – 14 € – Parution juin 2014
 Juriste de formation, chercheur à la très sérieuse Vrije Universiteit Brussel, directeur de la non moins académique collection "Perspectives critiques" aux PUF, Laurent de Sutter poursuit son chemin de "bad boy de la philosophie": après Pornostars. Fragments d'une métaphysique du X (La Musardine), qui promettait "Après avoir lu cet essai subversif, vous ne regarderez plus jamais un film pornographique de la même façon", paraissent (coup sur coup) aux éditions L. Scheer, une glaçante Théorie du trou qui donne à lire "Cinq méditations métaphysiques sur Une sale histoire de J. Eustache" , et une Métaphysique de la putain , qui affole toutes les questions de la philosophie, en soutenant que "les putains sont les visages mêmes de la métaphysique".
Juriste de formation, chercheur à la très sérieuse Vrije Universiteit Brussel, directeur de la non moins académique collection "Perspectives critiques" aux PUF, Laurent de Sutter poursuit son chemin de "bad boy de la philosophie": après Pornostars. Fragments d'une métaphysique du X (La Musardine), qui promettait "Après avoir lu cet essai subversif, vous ne regarderez plus jamais un film pornographique de la même façon", paraissent (coup sur coup) aux éditions L. Scheer, une glaçante Théorie du trou qui donne à lire "Cinq méditations métaphysiques sur Une sale histoire de J. Eustache" , et une Métaphysique de la putain , qui affole toutes les questions de la philosophie, en soutenant que "les putains sont les visages mêmes de la métaphysique".