APPEL À COMMUNICATIONS NEON GENESIS EVANGELION: CONFIGURATIONS EN SÉRIE D’UNE SCIENCE-FICTION CONTEMPORAINE Journée d’étude organisée par Karim Charredib et Yannick Kernec’h Laboratoire Pratique et Théorie de l’Art Contemporain Le 15 mars 2018 Université Rennes 2 Si les études occidentales sur les séries ont progressé de manière exponentielle ces dernières années, la sérialité animée japonaise, qui représente pourtant un pan non négligeable de la production télévisuelle, reste souvent marginalisée, voire désertée. Elle a pourtant permis l’émergence d’œuvres singulières qu’il convient d’approcher afin d’appréhender la complexité de la création télévisuelle contemporaine. À ce titre, Neon Genesis Evangelion , série japonaise d’Hideaki Anno produite par le studio Gainax et diffusée en 1995 au Japon et en 1998 en France, peut être perçue comme un moment télévisuel innovant. Produite spécifiquement pour la télévision là où nombre de réalisations constituent des adaptations de mangas, Neon Genesis Evangelion se présente comme une série de science-fiction apocalyptique devenue un objet culturel majeur au Japon. Reprenant la structure d’un récit traditionnel de robots géants comme Mazinger Z (Gō Nagai, 1972-74) ou encore la saga Gundam (Yoshiyuki Tomino et Hajime Yatate) créée en 1979, elle entame toutefois rapidement une corruption des codes propres à ce genre d’une manière qu’il pourrait être par ailleurs intéressant de rapprocher de séries comme Twin Peaks (David Lynch et Mark Frost, 1991-2017) avec le thriller policier et le soap opera . L’œuvre prend ainsi la forme, dans ses deux derniers épisodes, d’une tentative d’essai à dimension quasi-sociologique sur le désœuvrement relationnel du Japon de la fin du XX e siècle; par là, c’est la diégèse elle-même qui semble ultimement écartée. Cette journée d’étude centrée sur la série originelle de 26 épisodes, Neon Genesis Evangelion et ses adaptations cinématographiques au statut transmédiatique indécidable ( Rebuild of Evangelion ), a pour projet d’en cerner, au travers de son rapport original au genre de la science-fiction, les spécificités esthétiques et politiques. De fait, il sera nécessaire de réinvestir la présence de figures particulières telles que celles des géants, de l’adolescence contrariée, de l’animalité ou encore de la solitude et de la fin de la socialité comme formes apocalyptiques. Il s’avère pour cela prédominant de s’interroger sur la plasticité ainsi que sur les dispositifs de mise en scène, notamment par l’utilisation d’opérations techniques aussi diverses que la rotoscopie, le plan long, l’image subliminale, le décadrage, la contre-plongée ou encore des échos de plans d’un épisode à l’autre. Ceci contribuera à esquisser, à partir d’une telle série, les particularités inhérentes aux procédés d’animation sur les thématiques science-fictionnelles, et par extension de dessiner les contours d’une approche japonaise de ce genre. Cette journée se veut aussi une première approche de l’œuvre du réalisateur Hideaki Anno dont nous tenterons, à partir d’ Evangelion , d’en identifier et d’en circonscrire quelques problématiques générales. Il pourra donc être pertinent de cartographier les circulations existantes avec ses autres dessins animés tels que Nadia et le secret de l’eau bleue (1990-91) mais également ses films en prises de vues réelles comme Love & Pop (1998), adaptant Ryū Murakami, ou encore son dernier long-métrage en date, Shin Godzilla (2016). Propositions de communication Les propositions de communication, dont la durée sera de 30 minutes, mentionneront:Le titre de la communicationUn résumé de 1500 signes environUne notice biobibliographique Les propositions seront à envoyer avant le 15 décembre 2017 aux adresses suivantes: yannick.kernech@gmail.com et karim.charredib@gmail.com Fin décembre : Notification de la liste des communications acceptées. Organisation Karim Charredib (Maître de conférences en Arts plastiques, université Rennes 2) et Yannick Kernec'h (ATER, université Toulouse 2, LERASS, et doctorant en études cinématographiques à l’université Rennes 2, APP)
↧
Neon Genesis Evangelion : Configurations en série d’une science-fiction contemporaine (Rennes)
↧
V. Wiel, Usage du monde et liberté à l’Âge classique
 Véronique Wiel, Usage du monde et liberté à l’Âge classique , Honoré Champion, collection "Lumière classique", 2017 EAN13 : 9782745344700. — 318 p. — 55 EUR. On ne saurait trop souligner combien l’âge « classique » est un âge critique : moment de crise aiguë, totale, puisque c’est la destitution du monde ancien qui s’amorce. Dès lors une question se pose : comment réinventer la liberté dans les conditions de la modernité ? Cette entreprise s’énonce électivement en terme d’usage et révèle en particulier une conception aussi originale que méconnue, condensée dans la formule de Paul : « user du monde comme n’en usant pas». Attester son actualité à l’âge classique, c’est montrer comment Fénelon, Pascal, Malebranche ou Mme de Lambert se l’approprient diversement et en font une figure de la liberté disponible pour la modernité - y compris la nôtre. Véronique Wiel est maître de conférences HDR à l’Institut Catholique de Paris. Ses recherches où se conjuguent différents champs disciplinaires comme la philosophie, la théologie ou la rhétorique, portent principalement sur Malebranche auquel elle a consacré un ouvrage paru dans la même collection , Écriture et philosophie chez Malebranche . Table des matières
Véronique Wiel, Usage du monde et liberté à l’Âge classique , Honoré Champion, collection "Lumière classique", 2017 EAN13 : 9782745344700. — 318 p. — 55 EUR. On ne saurait trop souligner combien l’âge « classique » est un âge critique : moment de crise aiguë, totale, puisque c’est la destitution du monde ancien qui s’amorce. Dès lors une question se pose : comment réinventer la liberté dans les conditions de la modernité ? Cette entreprise s’énonce électivement en terme d’usage et révèle en particulier une conception aussi originale que méconnue, condensée dans la formule de Paul : « user du monde comme n’en usant pas». Attester son actualité à l’âge classique, c’est montrer comment Fénelon, Pascal, Malebranche ou Mme de Lambert se l’approprient diversement et en font une figure de la liberté disponible pour la modernité - y compris la nôtre. Véronique Wiel est maître de conférences HDR à l’Institut Catholique de Paris. Ses recherches où se conjuguent différents champs disciplinaires comme la philosophie, la théologie ou la rhétorique, portent principalement sur Malebranche auquel elle a consacré un ouvrage paru dans la même collection , Écriture et philosophie chez Malebranche . Table des matières
↧
↧
Écritures du passé: histoire et littérature.Séminaire du Grihl (EHESS & Paris 3)
Écritures du passé: histoire et littérature Premier semestre 2017-2018 Mardi de 17 heures à 20 heures 7 novembre, CRH (105 boulevard Raspail), salle 13: Introduction Alain Cantillon et Dinah Ribard 14 novembre, Centre Censier, 13 rue Santeuil, salle 410: La vie mode d'emploi Judith Lyon-Caen 21 novembre, CRH (105 boulevard Raspail), salle 13: Tamizey de Larroque ou le métier d'érudit Christophe Blanquie 28 novembre, Centre Censier, 13 rue Santeuil, salle 410: Libertinage, érudition et lecteurs ordinaires: la première traduction du Satyricon de Pétrone (XVII e siècle) Corinna Onelli 5 décembre, CRH (105 boulevard Raspail), salle 13: Accidents de souveraineté: Le Chat botté de Louis Marin Alain Cantillon et Giuseppe Vizzini 12 décembre, Centre Censier, 13 rue Santeuil, salle 410: L'expérience libertine du XVII e siècle Laurence Giavarini 19 décembre, CRH (105 boulevard Raspail), salle 13: Ce qui me repousse: la question de l'intransmissible dans les écrits du passé Christian Jouhaud 9 janvier, Centre Censier, 13 rue Santeuil, salle 410: Infractions au droit du livre : illustration et défense du littéraire (domaine français, XVI e siècle) Audrey Duru 16 janvier, CRH (105 boulevard Raspail), salle 7: Ordinaire du littéraire et histoire. Le dépôt des archives des Affaires étrangères au tournant des XVIII e et XIX e siècles Juliette Deloye 23 janvier, Centre Censier, 13 rue Santeuil, salle 410: Un manuscrit daté par la littérature, L'Innocence persécutée (XVII e -XIX e siècle) Laurence Giavarini 30 janvier, CRH (105 boulevard Raspail), salle 7: Pierre-Corneille Blessebois (1646?-1697?), poète galérien, ou l'efficace du pillage littéraire Sophie Houdard 6 février, CRH (105 boulevard Raspail), salle 7: Comment ne pas écrire une fiction: Nerval, Les Faux-Sauniers , 1850 Keiko Tsujikawa
↧
Y. Reboul (dir.), Les Deux Étendards.Le Chef-d’œuvre inconnu de Lucien Rebatet
 Les Deux Étendards.Le Chef-d’œuvre inconnu de Lucien Rebatet , Ouvrage collectif dirigé par Yves Reboul, Roman 20-50, 2017. À sa parution en 1952 le roman de Lucien Rebatet, Les Deux Étendards , aujourd’hui presque oublié, avait été salué comme un chef-d’œuvre par beaucoup et non des moindres: Camus, Blondin, Paulhan, George Steiner… Mais la personnalité de l’auteur, journaliste vedette de la Collaboration, avait joué d’emblée comme un tabou, engendré ce que Paulhan a désigné comme une véritable «consigne du silence», fait du roman, pour parler comme Steiner, «un des chefs-d’œuvre secrets de la littérature moderne». Dominique Aury avait été à l’époque chargée par Gallimard de juger de l’opportunité d’une publication. Sa réaction avait été sans appel: «À publier d’urgence». Quelques années plus tard, relecture faite, elle n’avait pas changé d’avis, retrouvant dans le livre ce «quelque chose d’intense, de rayonnant, qui monte des pages comme une buée brûlante. Ce feu incompréhensible», ajoutait-elle, c’était «le don du grand romancier». Le présent volume s’emploie à montrer que ces premiers lecteurs enthousiastes avaient raison. Il le tente à travers une série d’études, poétiques pour la plupart. Et aussi par le biais de l’ Étude sur la composition des Deux Étendards , texte écrit par Rebatet lui-même au moment de la publication du roman et qui en éclaire la genèse. Sommaire Yves REBOUL: Avant-propos Rebatet et Les Deux Étendards: éléments biographiques Les Deux Étendards: résumé de l’action Yves REBOUL: Un grand roman? Jacques LECARME: Un même auteur? Philippe BERTHIER: Wagner en Beaujolais Louis BALADIER: La musicalisation des formes dans Les Deux Étendards Stéphane CHAUDIER : Les Deux Étendards, polyphonie romanesque et discours rapportés Hélène BATY-DELALANDE: Puissance de la longueur: la lenteur débridée des Deux Étendards Pascal IFRI: L’épilogue sartrien des Deux Étendards: une présentation de la fin originale du roman Robert BELOT: De la parole pamphlétaire à l’œuvre littéraire. La tentative de conversion ontologique de Lucien Rebatet par Les Deux Étendards Jean-François LOUETTE: Les Deux Étendards: libération, masturbation, profération Gilles de BEAUPTE: Amours et contr’amours. La portée de l’antichristianisme dans Les Deux Étendards Lucien REBATET: Étude sur la composition des Deux Étendards (anthologie) Pour commander cet ouvrage (au prix de 18 € franco de port): Roman 20-50 1 Bois du Vieux Mont 62580 Vimy
Les Deux Étendards.Le Chef-d’œuvre inconnu de Lucien Rebatet , Ouvrage collectif dirigé par Yves Reboul, Roman 20-50, 2017. À sa parution en 1952 le roman de Lucien Rebatet, Les Deux Étendards , aujourd’hui presque oublié, avait été salué comme un chef-d’œuvre par beaucoup et non des moindres: Camus, Blondin, Paulhan, George Steiner… Mais la personnalité de l’auteur, journaliste vedette de la Collaboration, avait joué d’emblée comme un tabou, engendré ce que Paulhan a désigné comme une véritable «consigne du silence», fait du roman, pour parler comme Steiner, «un des chefs-d’œuvre secrets de la littérature moderne». Dominique Aury avait été à l’époque chargée par Gallimard de juger de l’opportunité d’une publication. Sa réaction avait été sans appel: «À publier d’urgence». Quelques années plus tard, relecture faite, elle n’avait pas changé d’avis, retrouvant dans le livre ce «quelque chose d’intense, de rayonnant, qui monte des pages comme une buée brûlante. Ce feu incompréhensible», ajoutait-elle, c’était «le don du grand romancier». Le présent volume s’emploie à montrer que ces premiers lecteurs enthousiastes avaient raison. Il le tente à travers une série d’études, poétiques pour la plupart. Et aussi par le biais de l’ Étude sur la composition des Deux Étendards , texte écrit par Rebatet lui-même au moment de la publication du roman et qui en éclaire la genèse. Sommaire Yves REBOUL: Avant-propos Rebatet et Les Deux Étendards: éléments biographiques Les Deux Étendards: résumé de l’action Yves REBOUL: Un grand roman? Jacques LECARME: Un même auteur? Philippe BERTHIER: Wagner en Beaujolais Louis BALADIER: La musicalisation des formes dans Les Deux Étendards Stéphane CHAUDIER : Les Deux Étendards, polyphonie romanesque et discours rapportés Hélène BATY-DELALANDE: Puissance de la longueur: la lenteur débridée des Deux Étendards Pascal IFRI: L’épilogue sartrien des Deux Étendards: une présentation de la fin originale du roman Robert BELOT: De la parole pamphlétaire à l’œuvre littéraire. La tentative de conversion ontologique de Lucien Rebatet par Les Deux Étendards Jean-François LOUETTE: Les Deux Étendards: libération, masturbation, profération Gilles de BEAUPTE: Amours et contr’amours. La portée de l’antichristianisme dans Les Deux Étendards Lucien REBATET: Étude sur la composition des Deux Étendards (anthologie) Pour commander cet ouvrage (au prix de 18 € franco de port): Roman 20-50 1 Bois du Vieux Mont 62580 Vimy
↧
Assistant or Associate Professor of French and Francophone Studies
The Department of French and Francophone Studies at The Pennsylvania State University invites applications for a tenure-track position at the rank of assistant or associate professor, beginning Fall 2018. We are seeking candidates with a strong record of research and teaching experience in 20th-/21st-century culture and society. We are a vibrant department with interdisciplinary strengths in francophone studies; cultural history; and women’s, gender, and sexuality studies. Besides a specialty in 20th-/21st-century culture and society, the ideal candidate would have an interest and experience in one or more of our three areas of strength and/or in migration studies, material culture, or the digital humanities. Start date is August 2018 and the teaching load is two courses per semester. Applicants must have a Ph.D., native or near-native fluency in both French and English, an active research agenda, and a record of successful teaching at multiple levels. To apply, please submit a cover letter, curriculum vitae, writing sample (no more than thirty pages) and contact information for three references. Application received by November 1, 2017, will be considered for MLA interviews; those arriving later will be accepted until the position is filled.
↧
↧
M. Wasserman, Paul Claudel et l’Indochine
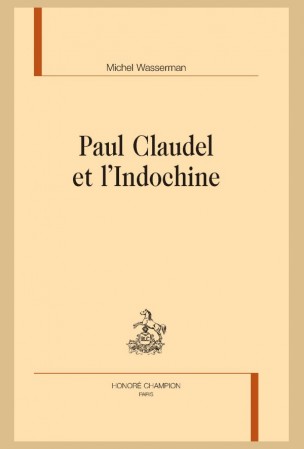 Référence bibliographique : Michel Wasserman, Paul Claudel et l’Indochine , Honoré Champion, collection "Poétiques et esthétiques, XXe-XXIe siècle", 2017. EAN13 : 9782745344571. 126 pages 28 EUR. Présentation de l'éditeur : L’Indochine joua un rôle non négligeable, quoique jusqu’ici peu mis en évidence, dans la réflexion et l’action d’un diplomate qui passa vingt ans comme consul en Chine (1895-1909) et ambassadeur au Japon (1921-1927), et fut appelé en ces qualités à favoriser les échanges de tous ordres entre la colonie et les zones de compétence successives du fonctionnaire. Claudel, qui effectue en marge de son affectation japonaise deux séjours prolongés en Indochine et réagit d’une façon originale à l’ensorcellement d’Angkor, demeurera attentif jusqu’à ses tout derniers jours au sort de la colonie, pays de mission et de martyre où la chute de Dien Bien Phu arrachera au vieux poète « un cri d’horreur et d’indignation ». Ancien directeur de l'Institut franco-japonais du Kansai et de la Villa Kujoyama, Michel Wasserman enseigne à la Faculté des Relations internationales de l'Université Ritsumeikan (Kyoto). Metteur en scène, il dirige une compagnie lyrique, la Kyoto Opera Society . Spécialiste des formes traditionnelles du théâtre japonais, il s'est également intéressé à la période japonaise de Claudel : D'or et de neige - Paul Claudel et le Japon (Les Cahiers de la NRF, 2008) a obtenu en 2009 le Prix Émile Faguet (Académie Française), ainsi que le Prix Littéraire de l'Asie. Il est aussi l’auteur de Paul Claudel dans les villes en flammes (Champion, 2015). Table des matières
Référence bibliographique : Michel Wasserman, Paul Claudel et l’Indochine , Honoré Champion, collection "Poétiques et esthétiques, XXe-XXIe siècle", 2017. EAN13 : 9782745344571. 126 pages 28 EUR. Présentation de l'éditeur : L’Indochine joua un rôle non négligeable, quoique jusqu’ici peu mis en évidence, dans la réflexion et l’action d’un diplomate qui passa vingt ans comme consul en Chine (1895-1909) et ambassadeur au Japon (1921-1927), et fut appelé en ces qualités à favoriser les échanges de tous ordres entre la colonie et les zones de compétence successives du fonctionnaire. Claudel, qui effectue en marge de son affectation japonaise deux séjours prolongés en Indochine et réagit d’une façon originale à l’ensorcellement d’Angkor, demeurera attentif jusqu’à ses tout derniers jours au sort de la colonie, pays de mission et de martyre où la chute de Dien Bien Phu arrachera au vieux poète « un cri d’horreur et d’indignation ». Ancien directeur de l'Institut franco-japonais du Kansai et de la Villa Kujoyama, Michel Wasserman enseigne à la Faculté des Relations internationales de l'Université Ritsumeikan (Kyoto). Metteur en scène, il dirige une compagnie lyrique, la Kyoto Opera Society . Spécialiste des formes traditionnelles du théâtre japonais, il s'est également intéressé à la période japonaise de Claudel : D'or et de neige - Paul Claudel et le Japon (Les Cahiers de la NRF, 2008) a obtenu en 2009 le Prix Émile Faguet (Académie Française), ainsi que le Prix Littéraire de l'Asie. Il est aussi l’auteur de Paul Claudel dans les villes en flammes (Champion, 2015). Table des matières
↧
C. Gauthier, Auerbach, Grigorovitch, Němcová: trois récits villageois autour de 1848
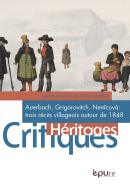 Référence bibliographique : Cécile Gauthier, Auerbach, Grigorovitch, Němcová: trois récits villageois autour de 1848, Editions et presses universitaires de Reims, collection "Héritages critiques (ISSN : 2257-4719)", 2017. EAN13 : 9782374960302. Au milieu du XIX e siècle, le récit villageois connaît une vogue sans précédent dans les littératures européennes, mais sa fortune a été très diverse depuis lors. Si en France les romans champêtres de Sand sont encore bien connus et étudiés, plus nombreux sont les textes tombés dans l’oubli. La valeur, certes inégale, de ces œuvres littéraires n’est sans doute pas seule en cause. On peut penser qu’a joué également l’assimilation de cette veine d’inspiration rurale avec des textes ultérieurs relevant d’une littérature du terroir à tendance conservatrice, si ce n’est franchement nationaliste. Cette assimilation hâtive méconnaît le terreau humaniste et libéral dans lequel ces textes ont vu le jour, dans les années 1840. Afin de donner à voir la dimension transnationale de ce phénomène littéraire, nous avons rassemblé dans ce volume des traductions de récits villageois de langue allemande, russe et tchèque, qui occupent une place significative dans l’histoire littéraire mais n’ont pas toujours passé les frontières linguistiques de leur propre culture. Ont contribué à ce volume Anne Coldefy-Faucard , maître de conférences en littérature russe, Paris-Sorbonne. Dalibor Dobiáš , directeur du département d’études sur le xix e siècle, Institut de la littérature tchèque (Prague). Cécile Gauthier , maître de conférences en littérature comparée, Université de Reims Champagne-Ardenne. Hans Otto Horch , professeur émérite, Institut für Germanistische und Allgemeine Literaturwissenschaft, Université technique de Rhénanie-Westphalie, Aix-la-Chapelle. Luba Jurgenson , professeure en littérature russe, Paris-Sorbonne. Table des matières
Référence bibliographique : Cécile Gauthier, Auerbach, Grigorovitch, Němcová: trois récits villageois autour de 1848, Editions et presses universitaires de Reims, collection "Héritages critiques (ISSN : 2257-4719)", 2017. EAN13 : 9782374960302. Au milieu du XIX e siècle, le récit villageois connaît une vogue sans précédent dans les littératures européennes, mais sa fortune a été très diverse depuis lors. Si en France les romans champêtres de Sand sont encore bien connus et étudiés, plus nombreux sont les textes tombés dans l’oubli. La valeur, certes inégale, de ces œuvres littéraires n’est sans doute pas seule en cause. On peut penser qu’a joué également l’assimilation de cette veine d’inspiration rurale avec des textes ultérieurs relevant d’une littérature du terroir à tendance conservatrice, si ce n’est franchement nationaliste. Cette assimilation hâtive méconnaît le terreau humaniste et libéral dans lequel ces textes ont vu le jour, dans les années 1840. Afin de donner à voir la dimension transnationale de ce phénomène littéraire, nous avons rassemblé dans ce volume des traductions de récits villageois de langue allemande, russe et tchèque, qui occupent une place significative dans l’histoire littéraire mais n’ont pas toujours passé les frontières linguistiques de leur propre culture. Ont contribué à ce volume Anne Coldefy-Faucard , maître de conférences en littérature russe, Paris-Sorbonne. Dalibor Dobiáš , directeur du département d’études sur le xix e siècle, Institut de la littérature tchèque (Prague). Cécile Gauthier , maître de conférences en littérature comparée, Université de Reims Champagne-Ardenne. Hans Otto Horch , professeur émérite, Institut für Germanistische und Allgemeine Literaturwissenschaft, Université technique de Rhénanie-Westphalie, Aix-la-Chapelle. Luba Jurgenson , professeure en littérature russe, Paris-Sorbonne. Table des matières
↧
La Grammaire de la Cause - II/ The Grammar of Causation - II (Paris)
La Grammaire de la Cause – II The Grammar of Causation - II COLLOQUE INTERNATIONAL CeLiSo, Université Paris - Sorbonne, 25-26 mai 2018 Organisation: Stéphane VIELLARD, Irina THOMIÈRES Après le succès du premier colloque international sur la Grammaire de la Cause, un second colloque du même nom, sur la causalité en langue aura lieu en mai 2018 à l’Université Paris – Sorbonne. Cette future manifestation ne se veut pas uniquement une reprise et un approfondissement des problématiques déjà en partie évoquées par les intervenants dans les Actes ( www.paris-sor bonne.fr/IMG/pdf/Cause_Pr_Final_anglais.pdf ), mais une ouverture vers d’autres pistes . Les axes de réflexions proposés sont les suivants: - la définition de la «cause», les phénomènes langagiers que l’on peut regrouper sous la bannière de la «cause», les arguments qui le justifient; la distinction «cause/ causalité» ; - verbes, adjectifs, substantifs, adverbes , autres parties de discours qui, dans une langue donnée, prennent en charge l’idée du rapport de cause: les contraintes qui pèsent sur leur emploi, les nuances de sens qu’ils induisent, la possibilité ou l’impossibilité d’un équivalent strict dans d’autres langues: povod, pričina, vina, predlog, motiv, rezon, faktor, etc. (en russe), provoquer, susciter, occasionner, origine [être à l’origine de], etc. (en français); - les structures syntaxiques empruntées par le locuteur pour exprimer la cause - certaines spécifiques et d’autres qui prennent en charge l’idée de cause sporadiquement, i.e. en fonction du contexte( c’est à cause de .. vs c’est la faute de ; cause à vs grâce à , en français); - dans le domaine du figement , proverbes, dictons et autres formes sentencieuses qui expriment la relation de cause à effet, ce que soit au moyen de connecteurs ou non; stéréotypes nationaux et variabilité (degrés de figement); possibilité ou impossibilité de traduction en d’autres langues de la même famille ou non; - la pragmatique , et notamment les connecteurs , mais aussi l’expression de la relation causale en l’absence du connecteurs; - la cause et les notions connexes (ex. la finalité). Comité scientifique: Wilfrid Rotgé, Stéphane Viellard, Irina Thomières, Pierre Frath, Gaston Gross. Propositions à envoyer à irina.thomieres@gmail.com en indiquant: nom, prénom, grade académique, rattachement, un résumé de 400 mots (bibliographie comprise). Date limite: le 15 mars 2018. Langues de travail: français, anglais. Langues d’étude: français, anglais, allemand, espagnol, italien, russe. Pour les autres langues, nous consulter. Publication: prévue. Fraisd’inscription: 40 euros, doctorants – 30 euros, membres du CeLiSo – exonérés.
↧
Assistant Professor of French (Princeton)
The Department of French and Italian at Princeton University seeks to hire a tenure-track assistant professor specializing in eighteenth-century French literature and culture. A demonstrated interest in interdisciplinarity would be an advantage. The successful candidate will have native or near-native French; clear evidence of scholarly excellence and of potential distinction in research and publication; and evidence of a serious and successful commitment to teaching. Applicants should include a cover letter of application, curriculum vitae, and contact information for at least three references online at https://puwebp.princeton.edu/AcadHire/ . Review of applications will begin in early October. Applications received by November 15, 2017 will be given full consideration.Interviews will be conducted at the MLA Convention in New York, January 4-7, 2018. Please note that the Ph.D. is expected by the appointment start date of September 1, 2018. Princeton University is an equal opportunity employer and complies with applicable EEO and affirmative action regulations. Women and minority candidates are strongly encouraged to apply. This appointment is subject to the university’s background check policy.
↧
↧
Les imaginaires de la traduction / The imaginaries of translation / Gli immaginari della traduzione
AdditionalCall for papers2017 Les imaginaires de la traduction The imaginaries of translation Gli immaginari della traduzione Appel à contributions / Call for papers / Bando per pubblicazione * Responsables/Organizers/Responsabili: Christina Bezari (Univ. of Ghent) Riccardo Raimondo (Univ. Sorbonne Paris Cité) Thomas Vuong (Univ. Paris 13) * Comité scientifique/Scientific committee/Comitato scientifico: James K. Archibald (McGill University), Franco Buffoni (Università di Cassino), Carole Birkan-Berz (Université Sorbonne-Nouvelle), Teresa Caligiure (University of Hamburg), Antoine Cazé (Université Paris-Diderot), Guillaume Coatalen (Université de Cergy-Pontoise),Lieven D'Hulst (Université de Louvain), Roberto Deidier (Università Kore di Enna), Caroline Fischer (Université de Pau et des Pays de l'Adour), Teresa Franco (University of Manchester), François Géal (Université Lyon 2), Rosario Gennaro (University of Antwerp), Philippe Guérin (Université Sorbonne-Nouvelle), Astrid Guillaume (Paris-Sorbonne), Michela Landi (Università di Firenze), Marianne Lederer (Université Sorbonne-Nouvelle), Ilse Logie (University of Ghent), Jean-Yves Masson (Université Paris-Sorbonne), Chiara Montini (ENS/CNRS), Franco Nasi (Università di Modena), Paschalis Nikolaou (University of Corfu), Nicholaos Papadimitriou (University of Corfu), Antonio Prete (Università di Siena), Jennifer Rushworth (University College of London), Laura Santone (Università di Roma), Fabio Scotto (Università di Bergamo), Pietro Taravacci (Università di Trento), Giota Tempridou (Aristotle University of Thessaloniki), Gilda Tentorio (University of Pavia), Beatrijs Vanacker (University of Leuven), [ et al. ]. * SCROLL DOWN FOR ENGLISH AND ITALIAN VERSIONS Les imaginaires de la traduction Appel à contribution Suite au grand succès des Journées d’Études Les imaginaires de la traduction qui se sont tenues les 3 et 4 mars 2017 à la Sorbonne-Nouvelle, nous souhaitons prolonger les réflexions qui s'y sont tenues, de manière à tracer une cartographie novatrice de la pratique et de la théorie du traduire, dans une perspective comparatiste. Argument Les rapports entre traductologie et littérature comparée dévoilent toute la complexité et les risques de ces disciplines hybrides, ainsi que l’importance de réfléchir sur leur identité et leurs spécificités. C’était déjà, d’ailleurs, le thème du XI e Congrès de l’Association Internationale de Littérature Comparée (1985): dans son introduction, José Lambert soulignait l’importance de la traduction comme étant un champ spécifique en même temps que la nécessité d’une interaction entre la théorie, l’histoire de la traduction et les autres disciplines. Cela revient à dire qu’il est souhaitable de considérer la traduction, non seulement d’un point de vue de la littérature, mais aussi l’histoire des savoirs et des pratiques sociales (F. Rastier: 2011; A. Guillaume: 2015; Y. Chevrel, J.-Y. Masson: 2015). Il nous semble donc nécessaire de repenser la traduction au prisme de la philosophie, de la poétique, des études sur l’imaginaire, enfin, de la repenser comme un art et non comme l’un des domaines de la linguistique appliquée. En effet, comme l’a avancé G. Lane-Mercier, la littérature comparée et la traductologie trouveraient leur spécificité commune à la fois dans la visée centrifuge, nomade ou encore «cartographique» qui les anime, et dans la logique de l’intersection, du réalignement, de la traversée. C’est par le biais d’un tel processus que ces deux disciplines deviennent des champs de conflit mais aussi de synthèse. Dans ce contexte, nous souhaitons envisager une hybridation entre la traductologie et les études sur l’imaginaire. On considérera dans ce contexte la notion d’imaginaire de la traduction comme une déclinaison de ce qu’on souhaite appeler les « théories de l’imaginaire linguistique» (Glissant 1996; 2010 ; Houdebine 2002). Perspectives On pourrait résumer les approches des imaginaires en traduction à travers deux principaux volets. D’une part, il s'avère intéressant de prendre en considération les manières par lesquelles l’imaginaire intervient dans la représentation « socio-symbolique des pratiques traductives » (Lavieri 2006; 2010). Dans cette perspective, on peut parler d’un «imaginaire du traduire» ou d’une «représentation du traduire» qui s’incarne dans des métaphores, des stéréotypes ou des récits. On traitera alors les représentations, les récits, les métaphores et les mythes du traduire, aussi bien que les connotations appliquées à l'acte de traduction dans les textes théoriques ou dans les paratextes. D’autre part, en ce qui concerne l’étude des textes traduits, il est crucial d’observer les procédés par lesquels l’imaginaire et l’imagination des traducteurs, en relation avec l’imaginaire collectif, jouent un rôle concret dans la pratique traduisante (Raimondo2016a; 2016b). En effet, on peut constater que nombre de solutions traductionnelles dérivent de l’imagination créatrice des traducteurs, qui s’incarne dans des choix linguistiques et poétiques, comme l’on peut remarquer par exemple à travers les travaux de Collinge (2000) ou de Verger (2010). Dans cette perspective, la traductologie est considérée du point de vue d’une « génétique de la traduction » au sens large qui repense son identité à la lumière des études sur l’imaginaire. Ce deuxième volet explore les imaginaires de la traduction et la psychè des traducteurs face aux textes. Avec une certaine prudence, on pourra aussi parler de «psychologie de la traduction». C’est d’ailleurs par une telle interdisciplinarité (Bassnett et Lefevre 1998 ; voir Ladmiral 2006: 109-125) qu’on peut espérer mettre en perspective la traduction avec l’histoire des savoirs (Rastier 2011; Guillaume 2015 ; Chevrel et Masson 2015), ainsi qu’organiser la complexité des facteurs fondant la traduction littéraire à l’intérieur d’un système cohérent, qui tient compte à la fois de la dimension linguistique et du substrat socioculturel, comme le souligne Bassnett (1998: 10). En d’autres termes, c’est grâce à une telle inspiration que la traductologie peut approfondir l’étude de ses «sphères d’influence» (Guillaume 2014 ; 2016) ou «sphères d’existence» (Ballard 2016), dans le but d’améliorer l’efficacité et la profondeur de ses outils analytiques et herméneutiques. Il s’agit de considérer la traduction à l’intérieur de ce qu’on pourrait appeler les «circonstances événementielles de la production imaginaire» (Van Eynde 2005). En effet, on peut constater que nombre de choix traductionnels dérivent de l’imagination créatrice des traducteurs, à savoir une «imagination active» (Jung 1970) qui s’incarne, consciemment ou inconsciemment, dans des choix linguistiques et poétiques. Il s'agira donc d’envisager ce que Paul Ricœur nomme une « poétique de la volonté » (Ricœur: 1986) en observant un certain nombre de phénomènes et d’expériences «à la charnière du théorique et du pratique» (P. Ricœur: 1986). Cette conception de l’imagination fait clairement écho à celle de Giambattista Vico qui, dans la Scienza nova (1744), expose la doctrine des «universaux fantastiques» dans laquelle l’imagination est considérée par rapport à son lien avec la poétique et avec l’histoire. De ce point de vue, on peut renvoyer aux inspirations d’Olivier Rimbault (2015: 24-28) qui reprend les théories de Carl Gustav Jung (1993) et de Gilbert Durand (1984) et envisage l’existence d’une même structure de l’imaginaire et des discours culturels: une « zone matricielle » (Rimbault 2016) commune serait alors à l’origine des archétypes et des idées. Dans le contexte de cette publication, nous souhaitons proposer quelques pistes de réflexion sans prétention à l'exhaustivité: - l’imaginaire «socio-symbolique» de la traduction - les représentations, les récits, les métaphores et les mythes du traduire - la psychè des traducteurs - l’imaginaire exotique en traduction - l’imaginaire du traduire comme violence - les rapports entre imaginaire du traducteur et pratique traduisante - les approches mystiques de la traduction - les imaginaires philosophiques de la traduction - les imaginaires politiques de la traduction - les imaginaires sourciers et ciblistes - psychanalyse et imaginaire des traducteurs - psychologie de la traduction - l’imaginaire dans la traduction des textes fondateurs - les représentations du traducteur dans les littératures et les arts - imaginaire et «belles infidèles» - la sémiotraductologie à l’épreuve de l’imaginaire On attendra des contributions qu'elles s'appuient sur les références bibliographiques citées ci-dessus, ainsi que sur les indications théoriques qui ont présidé à ces journées d'études (voir www.imagotrad.hypotheses.org/120 ). Modalités de soumission et calendrier Les articles devront compter entre 25.000 et 40.000 caractères (bibliographie inclue) et devront parvenir au format WORD en deux exemplaires: l'un signé et l'autre anonymé avant le 5 novembre2017 aux adresses ci-dessous. Les articles devront être accompagnés d’un résumé en français, en italien et en anglais (150/200 mots pour chaque résumé) et d’une brève biobibliographie en anglais (150/200 mots pour chaque biobibliographie). Le formatage des textes devra suivre soigneusement les consignes suivantes: > http://itineraires.revues.org/2255#tocto4n8 Les auteur-e-s sont prié-e-s de suivre rigoureusement les règles de cet appel à contribution. Les propositions incomplètes ne seront pas prises en compte. Les propositions acceptées seront soumises à une double relecture anonyme. Après une correction approfondie, les articles apparaitront dans un numéro spécial de la revue Itinéraires (Université Paris 13, 2018), classée ERIH PLUS. raimondo.riccardo@yahoo.it ths.vuong@gmail.com bezari.christina@gmail.com ---------------------------------------------------------- SCROLL DOWN FOR ITALIAN VERSION The imaginaries of translation Call for Papers Following the great success of our workshop on the “Imaginaries of Translation”, which took place at the University of Sorbonne-Nouvelle on the 3 rd and 4 th of March 2017, we now wish to extend our reflections on the theory and practice of translation and to encourage innovative and comparative perspectives. Topic The connections that are developed between translation studies and comparative literature reveal the complexity of such hybrid disciplines and emphasize the importance of rethinking their identity and their special characteristics. In fact, this subject was at the centre of attention during the 11 th Congress that was organized by the International Association of Comparative Literature (1985). In his introduction, José Lambert defined translation as a dynamic field and underscored its increasing interactions with other disciplines. It is therefore desirable to grasp translation, not only from the viewpoint of literature, but also from the viewpoint of the history of knowledge and social practices (F. Rastier: 2011; A. Guillaume: 2015; Y. Chevrel, J.-Y. Masson: 2015). Furthermore, it seems necessary to rethink translation through the prism of philosophy, poetics, studies on the imaginary, and finally, to consider it as an art and not as a branch of applied linguistics. Indeed, as argued by G. Lane-Mercier, comparative literature and translation studies are intrinsically linked because of their common centrifugal, nomadic or “cartographic” aims as well as their common propensity to the intersection, the realignment and the crossing of borders. It is, in fact, through such processes that these two disciplines become fields of major conflict and of major synthesis. In this framework, we wish to envisage a process of hybridization between translation studies and the studies on the imaginary. In order to achieve this goal, we will consider the notion of the imaginary in translation as a divergence from what has been defined as “the theory of the linguistic imaginary” (Glissant 1996; 2010; Houdebine 2002). Perspectives Our approach to the imaginary in translation is twofold: On the one hand, we take into consideration the ways in which the imagination is involved in the “socio-symbolic elaboration of translation practices” (Antonio Lavieri: 2007, 2010). In this regard, we can articulate an “imaginary of translation” or a “representation of translation” which is depicted in the use of metaphors, stereotypes or narratives. We will thus focus on the representations, the narratives, the metaphors and the myths that are associated with the act of translation. These practices can be traced in theoretical texts as well as in paratexts. On the other hand, when it comes to the study of translated texts, it is crucial to observe the process by which the imaginary and the imagination of translators –also in relation to the collective imagination-, play a decisive role in the act of translation (Raimondo 2016a 2016b). It is, indeed, noteworthy that many translational solutions derive from the creative imagination of translators, which is in its turn embodied in linguistic and poetic choices, as can be seen, for example, in the works of Collinge (2000) or Verger (2010). In this regard, it is possible to rethink translation studies from a “genetic” perspective that is enhanced in the light of new studies on the notion of the imaginary. This second part explores the imaginaries of translation and the psyche of translators in relation to texts. In a certain way and with certain cautiousness, we can also speak of “the psychology of translations”. We, therefore, hope to unearth the relationships between the act of translation and the history of knowledge (Rastier 2011, Guillaume 2015, Chevrel and Masson 2015) through the prism of interdisciplinarity (Bassnett and Lefevre 1998; see Ladmiral 2006: 109-125). We also wish to propose a coherent system that takes into account both the linguistic dimension and the socio-cultural substratum (Bassnett 1998: 10), which will help to define the complex factors underpinning literary translation. Through this attempt, we envisage to widen the scope of translation, to improve the effectiveness of its analytical and hermeneutical tools and to expand its “spheres of influence” (Guillaume 2014, 2016) or “spheres of existence” (Ballard 2016). In order to achieve our goals, we will examine translation through the prism of the so-called “circumstances of the imaginary production” (Van Eynde: 2005). Indeed, it is possible to notice that the “active imagination” (Jung: 1970) of the translator is, consciously or unconsciously, embodied in his/her linguistic, stylistic and poetic choices. In this regard, we will put forward Ricœur’s “poetics of will” (P. Ricœur: 1986) which will help us trace a number of phenomena and experiences that are situated “between theory and practice” (P. Ricœur: 1986).Furthermore, we will base our research on the conception of the imagination that was articulated by Giambattista Vico in his doctrine of the “fantastic universals” that appeared in his work Scienza nova (1744). According to Vico, imagination is considered in relation to its link with the historical and the poetic. Finally, we will look into the work of Olivier Rimbault (2015: 24-28), which evokes Carl Gustav Jung (1993) and Gilbert Durand (1984) and envisages the existence of a common imaginary structure in cultural discourse. According to Rimbault, a common “matrix zone” (2016) can be found at the origin of archetypes and ideas. For our upcoming publication, we welcome academic articles that focus on, but are not limited to, the following categories: - the “socio-symbolic” imaginary of translation - representations, narratives, metaphors and myths in translation - the translator’s psyche - the imaginary of the exotic in translation - the imaginary of translation and its connection to the notion of violence - the act of translation in connection to the translator’s imagination - mystical approaches to translation - philosophical imaginaries in translation - political imaginaries in translation - imaginaries between s ourciers and ciblistes - psychoanalysis and the imaginaries of translation - the psychology of translation - the imaginary in the translation of the founding texts - the translator’s representations in literature and in art - imaginary and the “Beautiful Infidels” - traductology, semiotics and the experience of the imaginary Contributions are expected to be based on the bibliographic references cited below, as well as on the theoretical background that was elaborated during our workshop (see www.imagotrad.hypotheses.org/120). Submission procedure and timetable The articles should not exceed 25,000-40,000 characters (bibliography included) and should be sent to the addresses below in the format WORD and in two copies (a signed and an anonymous one) before the 5th November 2017 . The articles should be accompanied by an abstract in English, Italian and French (150/200 words for each abstract) and a brief bio-bibliography in English (150/200 words for each bio-bibliography). The texts must neatly follow these Guidelines: > http://itineraires.revues.org/2255#tocto4n9 Authors are kindly requested to respect the rules of this call for papers. Incomplete proposals will not be considered. The accepted proposals will be subjected to a peer review by our Scientific committee. After thorough correction, the articles will be published in a special issue of the journal Itinéraires (University of Paris 13, 2018), rank ERIH PLUS. raimondo.riccardo@yahoo.it ths.vuong@gmail.com bezari.christina@gmail.com ---------------------------------------------------------- SCROLL UP FOR ENGLISH AND FRENCH VERSION Gli immaginari della traduzione Bando per pubblicazione scientifica In seguito al grande successo delle giornate di studio Gli immaginari della traduzione tenutasi il 3 e 4 marzo 2017 all’Università Sorbonne-Nouvelle , ci proponiamo di approfondire le riflessioni che sono state evocate, nell’ottica di tracciare una nuova cartografia delle pratiche e delle teorie della traduzione, in una prospettiva comparatista. Tematica I legami fra traduttologia e letteratura comparata svelano tutta la complessità e i rischi di queste discipline ibride, e mettono l’accento sull’importanza di ripensare la loro identità e le loro specificità. D’altra parte, questo era già il tema dell’ XI Congresso dell’Associazione Internazionale di Letteratura Comparata ( XI e Congrès de l’Association Internationale de Littérature Comparée, 1985): nella sua introduzione, José Lambert sottolineava l’importanza della traduzione come un ambito di studi indipendente, ma al tempo stesso la necessità di un’interazione fra la traduttologia, la storia della traduzione e le altre discipline. Ciò equivale a dire che sarebbe importante considerare la traduzione, non solo da un punto di vista della letteratura, ma anche della storia delle culture e delle pratiche sociali (F. Rastier 2011; A. Guillaume 2015; Y. Chevrel, J.-Y. Masson 2015). Ci sembra dunque necessario ripensare la traduzione attraverso il prisma della filosofia, della poetica, degli studi sull’immaginario, infine, ripensarla come un’ arte e non come una sottocategoria della linguistica applicata. In effetti, come lo ha già affermato G. Lane-Mercier, la letteratura comparata e la traduttologia trovano un felice dialogo, in una dinamica centrifuga, nomade o “cartografica”, ma anche nella logica dell’intersezione, del riallineamento, dell’attraversamento. Grazie a un tale approccio, queste due discipline diventano, non solo degli spazi di conflitto, ma anche di sintesi. In questo contesto, abbiamo ipotizzato un’ibridazione fra traduttologia e studi sull’immaginario. Possiamo quindi considerare la nozione d’immaginario della traduzione come una possibile declinazione di ciò che potremmo chiamare le “teorie sull’immaginario linguistico” (Glissant 1996; 2010; Houdebine 2002). Prospettive È possibile descrivere due approcci principali per questo particolare ambito di ricerca, gli immaginari della traduzione. Da un lato, è interessante prendere in considerazione il modo in cui l’immaginario interviene nella rappresentazione “socio-simbolica delle pratiche traduttive” (Lavieri 2006; 2010). Da questo punto di vista, si può parlare di un “immaginario del tradurre” o di una “rappresentazione del tradurre” che s’incarna in metafore, stereotipi o racconti. L’oggetto di studio saranno quindi le rappresentazioni, i racconti, le metafore e i miti del tradurre, oltre che le definizioni e le connotazioni presenti nei testi teorici e nei paratesti. Da un altro punto di vista, ponendo una maggiore attenzione ai testi tradotti, diventa cruciale l’analisi di tutti quei processi attraverso i quali l’immaginario e l’immaginazione dei traduttori giocano un ruolo concreto nella pratica traduttiva (Raimondo 2016a; 2016b). In effetti, possiamo facilmente constatare che numerose soluzioni traduttive derivano dall’immaginario dei traduttori, come si nota ad esempio nei lavori di Collinge (2000) o di Verger (2010). Da questo punto di vista, la traduttologia è considerata dal punto di vista di una “genetica della traduzione” nel senso lato del termine, una genetica quindi reinterpretata alla luce degli studi sull’immaginario. Questo secondo ambito di ricerca esplora gli immaginari della traduzione e la psiche dei traduttori, tenendo sempre come punto di partenza l’analisi dei testi tradotti. Con una certa prudenza, si potrebbe parlare anche di “psicologia della traduzione”. Proprio grazie a questa interdisciplinarietà (Bassnett et Lefevre 1998; voir Ladmiral 2006: 109-125), abbiamo la possibilità non solo di mettere in prospettiva la traduzione con la storia delle idee e dei saperi (Rastier 2011; Guillaume 2015; Chevrel et Masson 2015), ma anche di ripensare la complessità degli elementi fondatori della traduzione all’interno di un sistema coerente, che tenga conto al tempo stesso della dimensione linguistica e del sostrato culturale, come lo sottolinea Bassnett (1998: 10). In altri termini, grazie a questo tipo di approccio, la traduttologia può approfondire lo studio delle sue “sfere d’influenza” (Guillaume 2014; 2016) o “sfere di esistenza” (Ballard 2016), con lo scopo di migliorare l’efficacia e la profondità dei suoi strumenti analitici ed ermeneutici. Da questo punto di vista, considereremo la traduzione all’interno di ciò che potremmo chiamare «le circostanze situazionali all’origine dell’immaginario» (L. Van Eynde: 2005). In effetti, si può facilmente constatare che numerose scelte traduttive derivano dall’immaginario e dall’immaginazione creatrice dei traduttori, una «immaginazione attiva» (Jung 1970) che s’incarna, consciamente o inconsciamente, in delle scelte linguistiche e poetiche. Considereremo come punto di partenza ciò che Paul Ricœur chiama «una poetica della volontà» (Ricœur 1986), attraverso l’osservazione di una certa quantità di fenomeni e di esperienze «al confine fra la teoria e la pratica» (Ricœur 1986). La nostra concezione dell’immaginazione rimanda evidentemente a quella di Giambattista Vico che, nella Scienze nova (1744), espone la dottrina degli «universali fantastici» all’interno della quale l’immaginazione è considerata nel suo rapporto con la poetica e con la storia. Da questo punto di vista, possiamo rinviare alle ispirazioni di Olivier Rimbault (2015: 24-28) che riprende le teorie di Carl Gustav Jung (1993) e di Gilber Durand (1984) e ipotizza l’esistenza di una struttura originaria dell’immaginario e dei referenti culturali: una «zona primigenia» comune sarebbe all’origine degli archetipi e delle idee. Nel contesto di questa pubblicazione, ci permettiamo di proporre alcune piste di riflessione senza alcuna pretesa di esaustività: - l'immaginario «socio-simbolico» della traduzione - le rappresentazioni, i racconti, le metafore e i miti del tradurre - le rappresentazioni del traduttore nelle letterature e nelle arti - la psiche dei traduttori - l’immaginario esotico in traduzione - l’immaginario del tradurre come violenza - i rapporti fra immaginario del traduttore e pratica traduttiva - gli approcci mistici alla traduzione - gli immaginari filosofici della traduzione - gli immaginari politici della traduzione - gli immaginari sourcier e cibliste - psicanalisi e immaginario dei traduttori - psicologia della traduzione - l’immaginario nella traduzione dei testi fondatori - immaginario e « belles infidèles » - la semiotraduttologia e l’immaginario della traduzione Sono richiesti degli articoli che facciano riferimento alla bibliografia citata in questo documento e alle indicazioni teoriche che hanno ispirato le suddette giornate di studio (vedere www.imagotrad.hypotheses.org/120). Modalità di candidatura e calendario Gli articoli dovranno contare fra i 25.000 e le 40.000 caratteri (bibliografie inclusa) e dovranno essere inviati in formato WORD e in due esemplari (uno firmato, l’altro anonimo) entro il 5 novembre 2017 agli indirizzi e-mail indicati in questo documento. Gli articoli includeranno un riassunto in italiano, francese e in inglese (150/200 parole per ogni riassunto) e una breve biobibliografia in inglese (150/200 parole per ogni biobibliografia). I testi dovranno seguire attentamente le seguenti regole di formattazione: > http://itineraires.revues.org/2255#tocto4n9 Le autrici e gli autori sono pregati di attenersi rigorosamente alle regole di questo bando. Le proposte incomplete saranno scartate. Le proposte accettate saranno sottoposte a un ulteriore referaggio da parte del nostro Comitato scientifico. Dopo un’approfondita correzione, gli articoli saranno pubblicati in un numero speciale della rivista Itinéraires (Università Paris 13, 2018), classificata ERIH PLUS. raimondo.riccardo@yahoo.it ths.vuong@gmail.com bezari.christina@gmail.com ---------------------------------------------------------- Bibliographie / Bibliography / Bibliografia Yves CHEVREL, Jean-Yves MASSON: «Avant-propos», in Véronique DUCHÉ (dir.). Histoire des traductions en langue française , XV e et XVI e siècles (1470-1610) , Lagrasse, Verdier, 2015, p. 7-14. Michel BALLARD: «La traductologie comme espace», Les Langues Modernes , année 11, n°1 (2016), 14-25. Susan BASSNETT, André LEFEVERE: Constructing cultures: Essays on Literary Translation . Clevedon, Multilingual Matters, 1998. Franco BUFFONI: Con il testo a fronte. Indagine sul tradurre e l’essere tradotti , Novara, Interlinea 2007 (II edizione accresciuta Interlinea 2016). Linda COLLINGE: Beckett traduit Beckett : de « Malone meurt » à « Malone Dies », l’imaginaire en traduction . Genève, Droz, 2000. Gilbert DURAND: Les structures anthropologiques de l’imaginaire , Paris, Bordas, 1969 ; 10ème rééd. Paris, Dunot, 1984. Edwin GENTZLER: Contemporary Translation Theories . Londres/New York, Routledge, 2001. Édouard GLISSANT: Introduction à une poétique du divers . Paris, Gallimard, 1996. Édouard GLISSANT: L’imaginaire des langues , entretiens avec Lise Gauvin, Paris, Gallimard, 2010. Astrid GUILLAUME: «Vers une sémiotique diachronique et contrastive des cultures», in Driss ABLALI, Sémir BADIR, Dominique DUCARD (dir.): Documents, textes, œuvres. Perspectives sémiotiques , Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 381-406. Astrid GUILLAUME: «L’interthéoricité : sémiotique de la transférogenèse. Plasticité, élasticité, hybridité des théories». PLASTIR (Plasticités, Sciences et Arts) , n° 37 (2014), p. 1-36. Astrid GUILLAUME: « The Intertheoricity : Plasticity, Elasticity and Hybridity of Theories ». Human and Social Studies. Vol. 4, n°1 (2015), p. 13-29. Astrid GUILLAUME: «Avant-propos», in Astrid GUILLAUME (dir.), Traduction et implicites idéologiques . Paris, Éditions La Völva, 2016, p. 5-12. Anne-Marie HOUDEBINE (dir.): L’imaginaire linguistique , Paris, L’Harmattan, 2002. Antonio LAVIERI: Translatio in fabula. La letteratura come pratica teorica del tradurre , Editori Riuniti, Roma 2007. Antonio LAVIERI: «Gli sguardi, i fatti e l’immaginario del tradurre» , in Stefano ARDUINI et Ilide CARMIGNANI (dir.) Le giornate della traduzione letteraria : nuovi contributi . Rome, Iacobelli, 2010, p. 135-139. Charles LE BLANC: Le complexe d’Hermès , Presses de l’Université d’Ottawa, 2009. Christine LOMBEZ: La Seconde Profondeur: la traduction poétique et les poètes traducteurs en Europe au XX e siècle . Paris, Les Belles Lettres, 2016. Jean-Yves MASSON: «Territoire de Babel (notes sur la théorie de la traduction)», Corps Ecrit , n°36, Babel ou la diversité des langues, PUF, 1990, pp. 157-160. Antonio PRETE: All’ombra dell’altra lingua. Per una poetica della traduzione , Torino, Bollati Boringhieri, 2011. Carl Gustav JUNG: Types psycologiques , préf. et trad.n de Y. Le Lay, Genève, Georg, 1950 ; 8ème éd., Genève, Georg, 1993. Carl Gustav JUNG: Mysterium conjunctionis , Princeton University Press, 1970 ; rééd 2 vol., trad. par Etienne Perrot, Paris, Albin Michel, 1982, t. II; rééd. «Réflexions théoriques sur la nature du psychisme», in La réalité de l’âme , 2 vol., éd. de Michel Cazenave, Paris, Librairies Générale Française, 1998, t. 1. John MILTON, Paul BANDIA: Agents of Translation . Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2009. José ORTEGA Y GASSET: Misère et splendeur de la traduction , trad. sous la dir. de François Géal, post-face de Jean Yves Masson, Paris, Les Belles Lettres, 2013. Riccardo RAIMONDO a : « Le démon fugitif de l’imagination : propositions pour une traductologie comparée, entre Nerval et Baudelaire », Nouvelle Fribourg, n° 2 (2016). [en ligne : nouvellefribourg.com] Riccardo RAIMONDO b : « Orphée contre Hermès : herméneutique, imaginaire et traduction (esquisses) », Meta , n°61 (2016), p. 650-674. François RASTIER: La mesure et le grain. Sémantique de corpus , Paris, Champion, 2011. Olivier RIMBAULT: «Structures imaginales, linguistiques, littéraires, intellectuelles», in Imaginaire et pensée. Désiré Érasme, Martin Luther, Nicolas de Cues: trois imaginaires, trois modèles de pensée , Presses Universitaires de Perpignan, 2016 Tiphaine SAMOYAULT: «Morts récentes & vies nouvelles de la littérature comparée», Acta fabula , vol. 12, n° 5, «Le partage des disciplines», Mai 2011. [en ligne: fabula.org/revue] Mary SNELL-HORNBY: The Turns of Translation Studies. New paradigms or shifting viewpoints?. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2006. Gayatri Chakravorty SPIVAK: Death of a Discipline . New York, Columbia University Press, 2003. George STEINER: After Babel: Aspects of Language and Translation . Oxford, Oxford University Press, 1975. Paul ST-PIERRE, and Prafulla C. KAR (eds): In Translation: Reflections, Refractions, Transformations , Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 2007. Gideon TOURY: Translation Theory and Intercultural Relations . Tel Aviv, The Porter Institute for Poetics and Semiotics, 1981. Laurent VAN EYNDE: « Avant-propos », in Éléonore Faivre D’ARCIER, Jean-Pol MADOU et Laurent VAN EYNDE (dir.). Mythe et création. Théorie et figures , 2 vol., t. I, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2005. Lawrence VENUTI (ed.): The Translation Studies Reader , London, Routledge, 2000. François VEZIN: « Philosophie et pédagogie de la traduction », Revue philosophique de la France et de l'étranger , Tome 130 (2005/4). Mathias VERGER: «Antonin Artaud et l’imaginaire de la traduction». Carnets de Chaminadour , n°4 (2015), p. 61-85. Giambattista VICO : La scienza nuova (le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744) , a cura di Manuela Sanna e Vincenzo Vitiello. Milano, Bompiani, 2012. ----------------------------------------------------------------------------- WWW.IMAGOTRAD.HYPOTHESES.ORG
↧
Tran Duc Thao philosophe: Conscience et langage (Paris)
Colloque du centenaire de Tran Duc Thao (1917-2017) Tran Duc Thao philosophe: Conscience et langage Paris, 24-25 novembre 2017 Partenaires Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle Ecole doctorale 268 Langage et langues UMR 7597: Histoire des théories linguistiques Fondation Gabriel Péri Editions Sociales Comité scientifique Renaud Barbaras (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) – Jocelyn Benoist (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) –Marina De Palo (Sapienza-Università di Roma) – Stéphane Haber (Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense) – Jérôme Melançon (University of Regina) – Christian Puech (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3) – Dan Savatovsky (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3) –Trinh Van Thao (Aix-en-Provence) Comité d'organisation Alexandre FERON (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) alexandre.feron@mailoo.org . Jacopo D’ALONZO (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle-UMR7597-Sapienza Università di Roma) jacopo.dalonzo@gmail.com Depuis quelques années on remarque un certain regain d’intérêt pour le philosophe vietnamien Tran Đức Thảo (1917-1993), et notamment pour le rôle important qu'il a joué dans l'introduction de la phénoménologie en France et dans les débats philosophiques de l'après-guerre. Divers colloques et publications, en France et à l’étranger (à l’ENS de Paris en 2012, au Vietnam en 2013), ont été l'occasion d'un travail important pour retracer sa vie mouvementée, ses rapports avec Sartre et Merleau-Ponty, ainsi que l’influence qu’il a exercée sur la génération qui s’est formée dans les années 1950 (Derrida, Foucault, Althusser, Bourdieu, mais aussi Desanti). A l’occasion du centenaire de sa naissance, il nous semble important de dépasser l’évocation de sa trajectoire biographique et les présentations générales de son évolution intellectuelle, pour nous intéresser plus spécifiquement à son travail conceptuel et à ses contributions philosophiques. Nous pensons, par ailleurs, qu’il faut faire droit non seulement à ces travaux en dialogue avec la tradition phénoménologique mais également à ses élaborations ultérieures dans le champ de la linguistique et l’anthropologie. Ce colloque sera l’occasion d'entreprendre un tel travail sur les concepts et les axes majeurs de sa pensée. Il se déroulera sur deux journées, chacune s’organisant autour des deux grands moments de la pensée de Tran Duc Thao que constituent ses deux ouvrages publiés. – Autour de Phénoménologie et matérialisme dialectique Ce premier moment portera sur la spécificité de sa lecture de la phénoménologie husserlienne sur la manière dont il tente de l’articuler à la phénoménologie de l’Esprit à la Hegel (lue dans une perspective anti-kojévienne) et à un «matérialisme dialectique» inspiré de Marx et d’Engels. Il s’agira à la fois d'étudier le travail qu’il fait sur certains concepts (intentionnalité, réduction phénoménologique, monde de la vie, Présent vivant, genèse, esquisse, dialectique, etc.), sa méthode propre de lecture des philosophes (Hegel, Husserl, Engels, Marx, Descartes, Kant, Parménide), ainsi que la manière dont il tente de mettre en relation les analyses de Husserl avec travaux contemporains dans les sciences empiriques (psychologie, ethnologie, sociologie, etc.). – Autour des Recherches sur l’origine du langage et de la conscience . Ce second moment étudiera les travaux ultérieurs de Tran Duc Thao dans le champ des sciences humaines (linguistique, anthropologie, psychologie). Il s’agirait d'étudier sa conception sémiotique du langage (avec l’importance qu’il accorde au geste d’indication), ses discussions avec les linguistes (Saussure, Jakobson) et ses diverses propositions de réponse au problème de l’origine du langage. Il s'agira aussi, à cette occasion, de pouvoir examiner ses travaux anthropologiques sur l’hominisation, son intérêt pour les travaux de paléo-anthropologie (Spirkin, Leakey, Leroi-Gourhan), de psychologie animale (Pavlov, Köhler) et de psychologie de l’enfant (Piaget, Pichon, Wallon). Programme 24 Novembre 2017 Université Paris 1 Sorbonne Panthéon 1, rue Victor Cousin 75005 Paris 9h00 – Accueil 9h10 - Ouverture de la journée 9h30 Laurent Perreau - Expérience antéprédicative et expérience matérielle chez Tran Duc Thao 10h15 Guilherme Costa Riscali - Matérialisme et matérialité chez Tran Duc Thao 11h00 – Pause 11h15 Ovidiu Stanciu - Le lieu de la négativité. Tran Duc Thao, Kojève et le « contenu réel » de la Phénoménologie de l’Esprit 12h00 Timothée Haug - Le concept de « production » dans la dialectique de la nature de Tran Đức Thảo : penser la rupture anthropologique au sein de la continuité ontologique 12h45 - Repas 14h30 Guillaume Dechauffour – La construction mutuelle du sujet et du monde : la méthode génétique et l'hypothèse de la récapitulation chez Piaget et chez Tran Duc Thao 15h15 Etienne Bimbenet – L'indication originaire. Une anticipation marxiste de la Joint Attention 16h00 – Pause 16h15 Jérôme Melançon - La production et l’intentionnalité : de l’origine et de la genèse matérielles et pratiques de la conscience selon Tran Duc Thao 17h00 Clôture de la journée: Alexandre Feron – Comité d'organisation du colloque 25 Novembre 2017 Université Sorbonne Nouvelle Maison de la recherche, Salle Claude Simon 4, rue des Irlandais 75005 Paris 9h00 – Accueil 9h10 - Ouverture de la journée: Dan Savatovsky - Directeur de l’ED 268. Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 9h30 Jean-Jacques Lecercle - A propos du matérialisme en linguistique 10h15 Andrea D’Urso - Tran Duc Thao entre Bakhtine et Rossi-Landi : le travail linguistique dans l'hominisation et dans l'homologie de la reproduction sociale 11h00 – Pause 11h15 Patrick Flack - Philosophie du langage chez Kita Megrelidze, Hendrik Pos et Tran Duc Thao: Un tryptique entre phénoménologie, structuralisme et matérialisme dialectique 12h00 Antonino Bondì - Phénoménologie sémiotique et matérialisme dialectique entre sciences du langage et théorie de l’expérience 12h45 - Repas 14h00 Didier Samain - Technique ou fiction? Similitudes et divergences entre Tran Duc Thao et les savoirs de son époque. 14h45 Matteo Vincenzo D’Alfonso - Anthropogenèse et origine du langage: la possibilité d'un dialogue entre les neurosciences et Tran-Duc-Thao 15h30 – Pause 15h45 Yohann Douet - Critique de l'idéologie et genèse des idéalités chez Tran Duc Thao 16h30 - Clôture de la journée: Jacopo D'Alonzo – Comité d'organisation du colloque Argumentaires Etienne BIMBENET (Université de Bordeaux Montaigne) L'indication originaire. Une anticipation marxiste de la Joint Attention En 1973, dans les Recherches sur l'origine du langage et de la conscience , Tran Duc Thao situe l'origine de l'intentionnalité en tant qu'humaine dans le geste de l'indication. Ce faisant il anticipe la découverte d'un phénomène que la psychologie de l'enfant et une certaine primatologie des années 1990 et 2000 mettront au centre de leurs investigations, la Joint Attention (Attention partagée). Ainsi le même comportement se découvre au sein de deux cadres théoriques bien distincts : l'anthropologie hégéliano-marxiste d'un côté, une philosophie de l'esprit largement cognitivisée de l'autre. Nous tenterons la confrontation. Antonino BONDI (ENS de Lyon - LabEx Aslan) Phénoménologie sémiotique et matérialisme dialectique entre sciences du langage et théorie de l’expérience Dans les dernières décennies, les recherches en sémiotique, en sciences cognitives et en philosophie du langage ont montré un nouveau intérêt pour les perspectives phénoménologiques et matérialistes issues des philosophies du XXème siècle. Dans cette intervention, je voudrais focaliser mon attention sur une proposition théorique en sciences du langage que l’on pourrait définir comme phénoménologie sémiotique (Rosenthal, Visetti 2010). Cette perspective voulant croiser de façon native une étude de ce qui fait signe dans ses phases d’ apparition , stabilisation-institutionnalisation , emploi et déformation incessante par les sujets et les communautés, se préoccupe de tenir ensemble dans un canevas descriptif hétérogène les principes et les dynamiques de constitution des expériences de sens. C’est dans ce contexte qu’une telle perspective a essayé de prolonger (et de croiser) une linguistique et une sémiotique herméneutique et textuelle, et même fortement pragmatique, avec une proposition phénoménologique qui puisse articuler les différentes phases (matérielles et symboliques) de la conscience sémiotique. Si la sémiose se constitue comme un champ de co-constitution de forces et de formes, et si elle se produit comme reprise continuelle et transformation sans cesse de la conscience sémiotique elle-même, maintes questions se posent: comment se constitue alors cette conscience sémiotique? Quelles sont les dynamiques matérielles et psychiques d’un tel mouvement? Peut-on sérieusement penser en termes de genèse des formes, sans tenir compte de la socialité du sens et de la nature fortement sémiotique de la perception? Et, si l’on accorde ce pouvoir sémiotique à la perception, comment concevoir le déploiement social et institutionnel, sans oublier le nécessaire rôle du vécu expérientiel qui traverse toute construction sémiotique? Dans ce contexte, les recherches sur l’origine du langage et de la conscience de Tran Duc Thao représentent une tentative intéressante, pour proposer une archéologie de cette perspective de phénoménologie sémiotique. Les propositions de Tran Duc Thao sur la constitution indicative et ostensive de l’expérience sémiotique (et que l’on pourrait qualifier d’originairement gestuelle de la sémiose) essaient de tenir ensemble la dimension perceptive de la sémiose et la nature sociale et sémiotique de la perception. Nous explorerons cette tentative en en vérifiant l’ampleur conceptuelle et la teneur modélisante. Matteo Vincenzo D'ALFONSO (Università di Ferrara) Anthropogenèse et naissance du langage: Tran-Duc-Thao et les neurosciences, un dialogue possible? Dans Le mouvement de l’indication comme forme originaire de la conscience (1966), s’interrogeant sur le rapport entre le psychisme sensori-moteur et le psychisme conscient Tran-Duc-Thao formule l’hypothèse que la naissance de la conscience humaine coïnciderait avec l’avènement des outils. Cette hypothèse se fondait sur l’observation que les opérations finalisées à la création d’outils inclueraient déjà la projection d’une image idéale de l’objet à produire. Trois ans plus tard, dans l’essai Du geste de l’index à l’image typique (1969), Tran-Duc-Thao arrive même à soutenir qu’une forme embryonnaire de conscience serait déjà là dans le simple geste d’indiquer puisque ce dernier implique de l’intentionnalité. A nos yeux cette réflexion se trouve aujourd’hui confirmée sur le plan empirique par un certain nombre de recherches neuroscientifiques concernant les relations entre les mouvements des mains et la naissance du langage. Les résultats des recherches de Fadiga (et a. 2007) prouvent notamment que les neurones des aires du cerveau responsables pour le langage (les aires de Broca) déchargent à la simple perception ou vue du mouvement de porter la main à la bouche (mirror neurons). A partir de là les auteurs de cette étude formulent l’hypothèse que le langage pourrait se développer par des représentations de tels mouvements main–bouche. Dans la même direction Craighero 2014 soutient que le système moteur serait impliqué dans les fonctions cognitives. Par leur mise en parallèle notre intervention veut esquisser une interprétation des résultats empiriques des recherches neuroscientifiques mentionnées à partir du concept d’intentionnalité chez Thao. Guillaume DECHAUFFOUR (Université Paris-Sorbonne - Paris IV) La construction mutuelle du sujet et du monde : la méthode génétique et l'hypothèse de la récapitulation chez Piaget et chez Tran Duc Thao Dans la seconde partie de Phénoménologie et matérialisme dialectique et dans les Recherches sur l’origine du langage et de la conscience , la démarche de Tran Duc Thao repose sur l’interprétation commune des résultats de la paléoanthropologie et de la psychologie du développement. Il justifie cette combinaison par l’idée que l’ontogenèse reproduit nécessairement la phylogenèse. Cette méthode trouve sa source dans le matériau même à partir duquel elle opère: les travaux de Jean Piaget sur la construction du réel chez l’enfant. Nous nous intéresserons donc aux présupposés que charrie la psychologie piagétienne et à l’interprétation que Piaget en propose lui-même dans le cadre de l’épistémologie génétique. Nous établirons ainsi qu’il est possible de rapprocher les projets philosophiques de Piaget et de Tran Duc Thao sur la base de leur conception temporelle de la vérité. Cette mise en parallèle permettra de dégager, sous l’apparente simplicité de l'analogie entre l’histoire de l’individu et celle de l’espèce, une pluralité des gestes philosophiques dont nous chercherons à montrer la légitimité, la fécondité et la compatibilité avec les résultats des sciences du vivant. Yohann DOUET (Université Paris Nanterre - Université de Poitiers) Critique de l'idéologie et genèse des idéalités chez Tran Duc Thao Nous esquisserons l'apport des travaux de Tran Duc Thao à la question de l'idéologie. Bien que cette notion y soit rarement thématisée explicitement, deux éléments méritent d'être relevés. Le chapitre 2 de la partie 2 de Phénoménologie et matérialisme dialectique élabore une critique des idéologies de la transcendance, expliquées à partir de la propriété privée. Les Recherches sur les origines du langage et de la conscience rendent compte de la genèse des idéalités en faisant notamment intervenir différentes configurations de la division sociale du travail. Nous tâcherons de montrer qu'une telle conception des idéalités apporte une perspective novatrice pour l'analyse des idéologies (en particulier religieuses), et qu'elle peut notamment entrer dans un dialogue fructueux avec les théories d'Althusser. Andrea D’URSO (Università del Salento, Italie – Université SHS Lille 3) Tran Duc Thao entre Bakhtine et Rossi-Landi : le travail linguistique dans l’hominisation et dans l’homologie de la reproduction sociale Cette contribution voudrait expliciter des convergences peu explorées entre Tran Duc Thao, Mikhaïl Bakhtine et Ferruccio Rossi-Landi. À partir des mêmes passages de L’Idéologie allemande et des Grundrisse, que Bakhtine accroît de ces études avant que ces ouvrages soient connus, Thao conçoit « le mouvement d’indication comme forme originaire de la conscience », recoupant également des concepts bakhtiniens sur la conscience comme « discours intérieur », et Rossi-Landi élabore en 1965 sa théorie de « l’homologie de la production linguistique et de la production matérielle », considérant la coexistence du travail proprement dit et du langage comme moteur de l’hominisation qu’étudiera Tran Duc Thao. Patrick FLACK (Institut Centre-Européen de Philosophie, Université Charles de Prague) Philosophie du langage chez Kita Megrelidze, Hendrik Pos et Tran Duc Thao: Un tryptique entre phénoménologie, structuralisme et matérialisme dialectique L'objectif de cette présentation est de contextualiser et de mettre en évidence une convergence étonnante sur la question de l'origine du langage entre Tran Duc Thao et deux penseurs relativement méconnus mais importants à leur époque, le philosophe marxiste géorgien Kita Megrelidze (1900-1944) et le linguiste et philosophe néerlandais Hendrik Pos (1898-1955). Cet exercice comparatif jettera en particulier un certain éclairage sur la densité et la complexité des liens historiques entre phénoménologie, structuralisme et matérialisame dialectique sur la question du langage. Timothée HAUG (Université de Strasbourg) Le concept de « production » dans la dialectique de la nature de Tran Đức Thảo : penser la rupture anthropologique au sein de la continuité ontologique L’anthropogenèse entreprise par Tran Duc Thao dans la deuxième partie de Phénoménologie et matérialisme dialectique est fondamentalement naturaliste, en ce sens qu’elle cherche à fonder l’émergence de la vie humaine dans un développement graduel des formes de consciences animales. Pourtant, elle n’abandonne pas l’ambition de comprendre la socialité propre de cette existence comme une rupture anthropologique au sein d’une continuité ontologique. En revenant sur certaines sources implicites de son argumentation dans quelques textes fondateurs de Hegel, Marx et Engels, il s’agira d’indiquer la fonction charnière qu’il attribue au concept de production pour résoudre cette difficulté. Cela nous permettra d’interroger le statut problématique de la dialectique de la nature, tiraillée entre naturalisme téléologique justifiant le progrès de l’histoire vers le communisme, et naturalisme différencié visant à comprendre la socialité spécifique de l’homme sans nier sa naturalité. Jean-Jacques LECERCLE (Université Paris-Ouest Nanterre) A propos du matérialisme en linguistique Dans un premier temps, on montrera en quoi les Recherches de Tran Duc Thao doivent être prises comme une critique du structuralisme en linguistique, mobilisant un certain nombre de concepts et thèses de la tradition marxiste (primat de l'être sur la pensée, langage de la vie réelle, co-originarité du langage et du travail, etc.) pour critiquer les principaux concepts saussuriens (linguistique interne, langue, signe, arbitraire du signe, valeur). Dans un second temps, on tirera des leçons de Tran Duc Thao quant à la conjoncture actuelle en philosophie du langage, en particulier en ce qui concerne le concept d'interpellation comme prolongement du signe de l'indication. Jérôme MELANÇON (University of Regina) La production et l’intentionnalité : de l’origine et de la genèse matérielles et pratiques de la conscience selon Tran Duc Thao Prenant l'envers de nos travaux précédents sur l'illusion de la conscience pure et la critique de la philosophie idéaliste, nous nous tournerons ici sur les descriptions qu'offre Tran Duc Thao de la conscience que l'on pourrait dire réelle. Celle-ci apparaît à travers le prisme du langage, dans ce qu'il comporte à la fois de matérialité et d'idéalité. La production des moyens de vie dans le cadre de l'existence collective s'avère être un thème que Thao reprend dans la plupart de ses travaux; c'est de cette production qu'émergent l'intentionnalité ainsi que la conscience de soi. Puisque la philosophie de Tran Duc Thao, comme celle de Husserl, fut constamment recommencée et infléchie, nous tâcherons de montrer ce qui, à chaque étape de l'avancée philosophique de Thao, constitue un acquis à préserver. En effet, chaque moment de sa pensée est l'occasion d'une reprise à neuf de ses études précédentes, reprise qui s'appuie toutefois sur des éléments à conserver et à réintégrer dans un nouveau contexte - dans les textes des années 1940; dans les Recherches et des autres écrits des années 1960-70 relatifs au langage et à la conscience; et dans les textes publiés en revue ou à compte d'auteur au début des années 1990. L'étude des moments où apparaît la question de l'émergence historique (origine) et géographique/contextuelle (genèse) de la conscience permettra d'isoler la philosophie pratique et matérielle de la conscience que Thao a pu proposer. Laurent PERREAU (Université de Franche-Comté) Expérience antéprédicative et expérience matérielle chez Tran Duc Thao Dans Phénoménologie et matérialisme dialectique , Tran Duc Thao reproche à Husserl de faire de l’expérience antéprédicative un vécu abstrait, détaché des pratiques effectives et il recommande, en somme, de fonder l’expérience antéprédicative sur l’expérience matérielle. À cette fin, il met au jour la genèse de la conscience depuis la nature, par le biais de la production et de l’expérience de la matérialité. En revenant sur la philosophie du dernier Husserl, désormais mieux connue, on cherchera à montrer que celle-ci est à même de nourrir les analyses développées par Tran Duc Thao et que la conception que le dernier Husserl se fait de la praxis et de la communauté sociale est en réalité très proche de celle de Tran Duc Thao. On pourra également, par là, préciser le point de divergence entre les deux auteurs, relativement à la genèse de l’expérience antéprédicative. Guilherme COSTA RISCALI (Université de Lisbonne) Matérialisme et matérialité chez Tran Duc Thao Thao rencontre dans l’œuvre de Husserl une contradiction entre le projet transcendantal de la phénoménologie et les analyses de la genèse passive. Ces analyses révèleraient une synchronie avec des résultats psychologiques concrets lesquels seraient le sens réel de la phénoménologie aussi bien que la voie de son rapprochement au matérialisme dialectique. Mais si la phénoménologie génétique permet une critique du passage de la matière à l’idéalité, une lecture psychologisante de la genèse passive risque de retomber dans une notion de matérialité qui n’assure ni la complexité propre à la notion phénoménologique de constitution ni la richesse du matérialisme dialectique. Didier SAMAIN (ÉSPÉ, Paris Sorbonne) Technique ou fiction? Similitudes et divergences entre Tran Duc Thao et les savoirs de son époque. L’historien des sciences retrouve dans le programme génétique de Tran Duc Thao nombre de postulations d’époque, qu’il s’agisse du projet lui-même: proposer une théorie non physicaliste du sens incarné (on songera par exemple à Tolman), du rôle attribué à la deixis, à la nomination, à la prototypie, à l’interaction (autant de choses familières aux linguistes germanophones depuis Wegener), etc. Mais linguistes et psychologues de la période restaient généralement prudents sur les questions d’émergence, et eussent sans doute considéré que les thèses de l’auteur excédaient l’ambition des sciences, dès lors qu’elles complétaient l’observable par une postulation d’ensemble (l’hypothèse de la récapitulation), une méthode (l’extension analogique), des schémas génétiques ( e.g. l’inhibition), à quoi il faut encore ajouter une stratégie narrative. Il en résulte un effet de puzzle, à la fois proche et lointain de thèses contemporaines. C’est ce qu’on exposera rapidement. Ovidiu STANCIU (Sciences Po, Paris) Le lieu de la négativité. Tran Duc Thao, Kojève et le «contenu réel» de la Phénoménologie de l’Esprit Je me propose de restituer les axes majeurs du dialogue philosophique noué par Alexandre Kojève et Tran Duc Thao à propos de la signification qu’il convient d’attribuer à la dialectique hégélienne. Le noyau du débat touche à la question de la négativité: doit-elle demeurer confinée dans un registre anthropologique, comme le veut Kojève, ou bien est-il légitime de lui attribuer une extension véritablement universelle, comme le soutient Tran-Duc-Thao à la suite de Hegel?
↧
D. Fabre & M. Scarpa (dirs), Le Moment réaliste .
Référence bibliographie : Daniel Fabre et Marie Scarpa (dirs), Le Moment réaliste. Un tournant de l'ethnologie , Nancy, Editions Universtaires de Lorraine, EthnocritiqueS, 2017, 316 p. Dans la continuité de Savoirs romantiques (publié en 2010 aux Presses Universitaires de Nancy dans la collection EthnocritiqueS ), ce volume constitue le second temps de cette histoire autre de la discipline ethnologique que Daniel Fabre a voulu entreprendre. Une histoire qui part des pratiques de construction et de connaissance de l'altérité (les « savoirs des différences »), en privilégiant le point de vue européen (les « autres » chez soi) et les situations où un discours de nature anthropologique émerge dans le champ intellectuel et esthétique. Une histoire qui prendrait au(x) mot(s), en somme, le constat récurrent que l’anthropologie est de toutes les sciences humaines et sociales celle qui a conservé le plus d’affinités avec la création littéraire et artistique. Si l’apport profond du romantisme, plus que d’accueillir les aspects « pittoresques » de l’altérité, a été de pointer l’inéluctable disparition des vaincus de l’Histoire et du progrès, le moment réaliste est marqué surtout par la volonté critique de rationaliser et d’objectiver les savoirs et les pratiques, afin d’atteindre une vérité du social, épistémé sur laquelle se construisent et s’instituent en disciplines les différentes sciences de la société. C’est ce tournant de l’ethnologie que ce volume se propose d’explorer à partir des mouvements intellectuels et artistiques qui lui sont contemporains, à partir du roman en particulier qui va s’imposer à la même période comme le presque tout de la production littéraire. Table Marie Scarpa – D'une ethnologie réaliste I. Voir/écouter/rendre (le réel) - Judith Lyon-Caen – Enquêtes, littérature et savoir sur le monde social en France dans les années 1840 - Marie-Ève Thérenty – « Choses vues », corps impressionnés au XIXe siècle. Du journal au roman - Agnès Sandras, Henri Viltard – Caricaturistes et photographes. Bataille autour du réel (1840-1900) - Marie Scarpa – Le « document humain », entre littérature et ethnographie II. Altérités du proche et du lointain : les savoirs et les devoirs du roman - Claudie Voisenat – Amélie Bosquet (1815-1904), entre folklore romanesque et roman réaliste - Sylvie Sagnes – Entre science et roman. Au pays de Roupnel, Nono, Garain et les autres - Françoise Michel-Jones – L'Inde chez Jules Verne : exotisme et modernité. Le Tour du monde en quatre- vingts jours et La Maison à vapeur - Francis Zimmermann – De Tolstoï à Thakazhi. Le roman réaliste au Kérala (1930-1970) III. Récits de rite/Rites du Récit - Daniel Fabre † – Le roman du charivari • Jean-Marie Privat – Le micmac des rites - Agnès Fine – Rite de passage et roman de formation. L'Initiation de Bone (Russell Banks) - Sylvie Sagnes – Postface. Éloge de la discordance des temps Index ISBN: 9782814303089, 316 pages, 20 euros
↧
Avldigital.de | Specialised Information Service for Comparative Literature
The online portal avldigital.de offers a platform for finding literature, publishing and networking in Comparative Literature Studies . Funded by the German Research Foundation, it aims at the German speaking research community – nevertheless, its services are open for all researchers in Comparative Literature to use, and to address their colleagues in Germany. A beta version is available on http://www.avldigital.de . Its features include:Open Access for Literary Studies: Digital publishing for researchers, research institutions and academic publishers on our repository CompaRe : http://www.avldigital.de/CompaRe/ .E-Journals made easy: We host your periodicals, such as open access journals, working papers and research papers. Our hosting service offers state of the art online publishing with Open Journal Systems (OJS): http://avldigital.de/publizieren/e-journal-hosting/ .Comparative Literature Researcher Index: Make yourself and your research known and find out who shares your research interests. Register now: http://avldigital.de/vernetzen/forscherInnen/ .Who is who in Comparative Literature: A register of institutions, research projects and websites: http://avldigital.de/vernetzen/ – Is your institution listed yet?Communicating in Comparative Literature: Announce calls for papers, jobs and grants, conferences and much more: http://avldigital.de/vernetzen/neuigkeiten-melden/ . All items are also published on twitter Twitter https://twitter.com/avldigital and on the avldigital BLOG https://avldigital.wordpress.com/ .avldigital.de is a service provided by the Specialised Information Service for Comparative Literature, a project under development at the University Library of Frankfurt since 2016. It is funded by the German Research Foundation. Find out more on http://www.avldigital.de/ueber-uns/ .Please subscribe to our newsletter for regular updates on avldigital.de : http://dlist.server.uni-frankfurt.de/mailman/listinfo/newsletter.avldigital . Please direct any questions to Jakob Jung at info@avldigital.de . Jakob Jung, M. A. Fachinformationsdienst Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (FID AVL) Universitätsbibliothek J. C. Senckenberg Bockenheimer Landstraße 134-138 60325 Frankfurt am Main E-Mail: j.jung@ub.uni-frankfurt.de Tel: +49 (0)69 798 25163 P.S. What are current research interests in Comparative Literature? Please take our poll "Eight Answers for Comparative Literature" (German language only): http://tinygu.de/hd76 .
↧
↧
Oxford University Studies in the Enlightenment /Enquête de lectorat
Les Oxford University Studies in the Enlightenment (anciennement Études sur Voltaire et le dix-huitième siècle ) entreprennent un questionnaire auprès de ses lecteurs, en les invitant à compléter notre sondage sur les pratiques de lecture en suivant ce lien . "Publié par la Fondation Voltaire à l'Université d'Oxford, les Studies ont publié des travaux érudits sur les Lumières depuis 1955. Cette longévité est due en grande partie à son lien étroit avec vous – nos lecteurs, auteurs et réviseurs. Au fur et à mesure que nous progressons dans notre septième décennie, l'équipe de rédaction cherche à faire en sorte que nous continuions à publier des recherches innovantes, sur des sujets à l'avant-garde du domaine – et à rendre ce travail aussi largement accessible que possible. Par conséquent, nous cherchons à mieux comprendre, à travers les réponses à ce questionnaire, comment notre communauté accède aux ressources scientifiques – et imprimées et numériques. L'enquête nécessite moins de 15 minutes pour remplir, en anglais ou en français. Le sondage est ouvert dès le mercredi 27 septembre, et il restera ouverte jusqu'au dimanche 29 octobre. Pour participer au sondage, veuillez y accèder par ce lien: Oxford University Studies in the Enlightenment survey of scholarly reading practices . Rassurez-vous qu’aucune information identifiante sur les répondants ne sera conservée, en dehors des réponses au sondage. Toutes les réponse seront conservées anonymes et confidentielles. Les résultats agrégés seront partagés avec la communauté savante en temps voulu. Davantage de détails concernant l'enquête sont disponibles ici . En reconnaissance de votre engagement pour les valeurs des Lumières de la tolérance et de l'humanisme international, la Fondation Voltaire fera une don de bienfaisance à Amnesty International et à Médecins Sans Frontières pour chaque enquête remplie. Veuillez répondre à vos questions ou préoccupations à Gregory.Brown@voltaire.ox.ac.uk . Nous vous remercions de votre soutien aux Oxford University Studies in the Enlightenment! La Voltaire Foundation."
↧
Assistant Professor of French 20 th - and 21 st -Century Literature (Univ. of Alabama)
The Department of Modern Languages & Classics at The University of Alabama invites applications for a tenure-track position of Assistant Professor with primary specialization in 20 th - and 21 st -century French literature, culture, and civilization . PhD or equivalent in French or related field in hand by August 16, 2018, native or near-native command of French and English, evidence of scholarly excellence required. Applicants must have an active research agenda and a commitment to undergraduate as well as graduate teaching in French at all levels. Applicants should apply online at https://facultyjobs.ua.edu/postings/41835 , attaching letter of application, curriculum vitae, and article-length writing sample. Candidates should have three recent letters of recommendation sent directly, by mail, to the French Search Committee, Department of Modern Languages & Classics, Box 870246, The University of Alabama, Tuscaloosa, AL 35487-0246. For more information on the French program, please see mlc.ua.edu/french/ . Review of applications will begin on November 15, 2017. Women and minority candidates are strongly encouraged to apply. The University of Alabama is an Equal Opportunity / Affirmative Action employer, and actively seeks diversity among its employees.
↧
Th. Labbé, Les catastrophes naturelles au Moyen Âge (XIIe-XVe s. )
 Les catastrophes naturelles au Moyen Âge - XIIe-XVe siècle Thomas Labbé Date de parution : 09/02/2017 Editeur : CNRS ISBN : 978-2-271-08947-2 EAN : 9782271089472 Comment comprendre la notion de catastrophe naturelle dans la pensée médiévale ? Etonnement, puissance, terreur, fonction purificatrice, choc des consciences... Avec tous les fantasmes qu'ils drainent dans leur sillage et la stupeur qu'ils produisent sur les esprits, ces "accidents de la nature" ouvrent une fenêtre fascinante sur l'histoire des représentations au Moyen Âge. Revisitant les textes des chroniqueurs qui tentèrent d'en rendre compte, Thomas Labbé montre que le récit du phénomène extrême favorise toujours la déformation de la réalité vécue. La catastrophe apparaît comme une manière de donner un sens à l'extraordinaire, comme en attestent les récits de l'effondrement du mont Granier en 1248, de l'inondation de l'Arno en 1333 ou encore du tremblement de terre à Naples en 1456. Le processus d'"événementialisation" qui en découle s'opère plus à travers l'imaginaire et la sensibilité de la société que par ses capacités rationnelles d'objectivisation. Une grande étude à la croisée de l'histoire sociale et de l'histoire des émotions en Occident. * On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage : "Menace écologique au Moyen Âge", par F. Lavocat.
Les catastrophes naturelles au Moyen Âge - XIIe-XVe siècle Thomas Labbé Date de parution : 09/02/2017 Editeur : CNRS ISBN : 978-2-271-08947-2 EAN : 9782271089472 Comment comprendre la notion de catastrophe naturelle dans la pensée médiévale ? Etonnement, puissance, terreur, fonction purificatrice, choc des consciences... Avec tous les fantasmes qu'ils drainent dans leur sillage et la stupeur qu'ils produisent sur les esprits, ces "accidents de la nature" ouvrent une fenêtre fascinante sur l'histoire des représentations au Moyen Âge. Revisitant les textes des chroniqueurs qui tentèrent d'en rendre compte, Thomas Labbé montre que le récit du phénomène extrême favorise toujours la déformation de la réalité vécue. La catastrophe apparaît comme une manière de donner un sens à l'extraordinaire, comme en attestent les récits de l'effondrement du mont Granier en 1248, de l'inondation de l'Arno en 1333 ou encore du tremblement de terre à Naples en 1456. Le processus d'"événementialisation" qui en découle s'opère plus à travers l'imaginaire et la sensibilité de la société que par ses capacités rationnelles d'objectivisation. Une grande étude à la croisée de l'histoire sociale et de l'histoire des émotions en Occident. * On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage : "Menace écologique au Moyen Âge", par F. Lavocat.
↧
Culture galante et sigisbéisme en Europe durant le long XVIII e siècle (Toulouse)
Appel à communication Journée d’étude Culture galante et sigisbéisme en Europe durant le long XVIII e siècle Université Toulouse Jean-Jaurès, 4 mai 2018 FRAMESPA. France, Amériques, Espagne – Sociétés, Pouvoirs, Acteurs Organisation : Azzurra Mauro (Université Toulouse Jean-Jaurès) Matthieu Magne (Université Toulouse Jean-Jaurès/Université Nice Sophia-Antipolis - CMMC) Le XVIII e siècle italien a vu s’épanouir le «sigisbé» (« cicisbeo» ), un chevalier servant qui avait le devoir de rester auprès d’une dame, avec le consentement de son époux, afin de l’accompagner dans ses activités quotidiennes. Cette pratique pose la question de l’expression de la culture galante et de ses transformations sous l’effet du libertinage de la fin du XVIII e siècle, puis des bouleversements de l’ordre politique, social et moral au cours de la décennie révolutionnaire et des campagnes napoléoniennes. Le sigisbé est une de ces figures ambigües de la fin de l’époque moderne. L’abbé Galiani l’introduit dans ses discours sur l’amour, interrogeant ainsi le sigisbéisme sous l’angle de la relation conjugale et des pratiques matrimoniales à l’heure où les femmes jouaient un rôle central dans les pratiques de sociabilité. Au cœur de la tension entre l’espace domestique et la présence publique de la dame, le sigisbéisme fut aussi une pratique de régulation entre les familles détentrices d’un pouvoir foncier et politique. Il s’agit ici de partir des différentes interprétations de cette pratique pour développer une réflexion sur la manière de penser la civilité et le mariage au regard des normes de l’ancien régime. Cette problématique des rapports entre individu, famille et société se situe au croisement entre morale privée et construction des identités nationales [1] . «L’image domestique et familière du chevalier servant [2] » fait l’objet de nombre de descriptions et parfois de déformations de la part des voyageurs. Le sigisbéisme est souvent présenté comme une coutume spécifiquement italienne, dont l’origine appelle encore bien des éclaircissements, en insistant sur la circulation des modèles à l’échelle européenne. La nouvelle morale individuelle et familiale de la société post-révolutionnaire, entraîna la crise du sigisbéisme. À peine arrivé à Venise en 1816, le comte de Clary-Aldringen entendit «sur la Sigisbeatura des choses que je croyais entièrement passées de mode et qu’on prendrait pour des fables». La coutume était alors sous le feu de la critique de Sismondi qui en fit le symptôme d’une déviance morale inséparable de l’histoire de la Péninsule. Elle apparaît donc comme un objet historique de premier ordre pour étudier un processus de normalisation sociale porteur de lourds enjeux politiques. Cette journée d’étude a pour objectif de mettre en rapport la construction d’un imaginaire du sigisbé avec les aspects très concrets de la culture matérielle, en particulier autour du corps et de sa représentation. L’ambiguïté qui entoure le chevalier servant renvoie plus largement à celle de la culture galante, en tension entre l’idéal de l’honnête homme et la malicieuse ironie des libertins. Thème littéraire et pictural omniprésent depuis la fin du XVII e siècle, la belle galanterie fut élevée au rang d’art dans les cours qui servirent de vecteurs à sa promotion. Les usages du terme mettent en évidence la thématique de la séduction, dont les différents aspects seront abordés. Le passage des Lumières au romantisme est marqué par une relecture de l’idéal courtois et des codes de l’honneur, nourrie par la fascination pour le Grand Siècle et le succès des romans de chevalerie. Elle participe à l’émergence de nouveaux modèles de la virilité et de la féminité. Les héritages de cette culture ne disparurent pas pour autant, conduisant à s’interroger sur les manifestations d’une galanterie réinventée dans l’Europe post-révolutionnaire. Plusieurs pistes de réflexions sont à développer autour des pratiques galantes et de leur réception au cours du long XVIII e siècle: - Le corps habillé, parfumé, paré et costumédu sigisbée et les origines de cette pratique. Son insertion dans les normes sociales et matrimonialeset l’effet que sa perception et ses représentations peuvent avoir sur les normes de l’époque. - La notion de service de la dame dans la construction d’une sphère d’alliances et de civilité des familles. Les enjeux de la politesse dans la relation entre les sexes. - La circulation des modèles courtois des salons de la noblesse italienne jusqu’aux cours de l’Europe du Nord. Le rôle de l’étiquette comme outil de régulation dans les cours anciennes et nouvelles. Les aspects éducatifs et pédagogiques, essentiels dans la transmission d’un idéal de civilité confronté aux nouvelles manières de penser la vie en société. -La question de la mise en scène de cette culture dans les espaces privés et publics. Les héritages des fêtes galantes dans la conception des réjouissances publiques et politiques. Le français et l’anglais seront les deux langues de la journée d’étude, dont les résultats doivent permettre la mise en place d’une publication. Organisationmatérielle : Lecomitéd'organisation prendà sachargel'hébergementdes participants à concurrence de deux nuits et leur restauration sur place. Lorsqu’un participant n’a pu obtenir sa prise enchargepar son institution de rattachement, il pourra bénéficier d'une prise en chargeforfaitaire des frais de déplacement. Envoi des propositions de communication: Les propositions de communication (2 000 signes) sont à envoyer accompagnées d’une présentation biographique succincte aux deux coordinateursau plus tard le 25 novembre 2017 : Azzura Mauro: azzurra.mauro@gmail.com Matthieu Magne: matthieu-magne@wanadoo.fr [1] Roberto Bizzocchi, Cicisbei. Morale privata e identità nazionale in Italia , Roma-Bari, Laterza, 1997. [2] Idem , p. 66.
↧
↧
'De l'Antiquité à la modernité politique : quelles médiations ?' (Lyon)
Le colloque final du Laboratoire Junior REPHAM organisé par Flora Champy et par Caroline Labrune lundi 23 et mardi 24 octobre 2017 e campus Monod de l’ ENS Lyon (46 allée d’Italie, Lyon 7) – Salle 1, Place de l’École. L’entrée est libre. Lundi 23 octobre 9h – Accueil des participants. 9h30 – Introduction. I- Traduction, imitation et réécriture des textes politiques antiques 10h – Antoine Vuilleumier (Université de Neuchâtel, Suisse) : Trois médiations de sources antiques à l'aube des guerres de religion (1562): traduction, commentaire et traité politique chez Loys Le Roy. 10h30 – Adrien Aracil (Université Paris-Sorbonne) : «Dieu permit que le Roy allast, vist, vinquist». Réflexions sur l'usage politique d'une imitation de César par Henri de Rohan (1610-1630). 11h – Stavroula Kefallonitis (Université Jean Monnet Saint-Étienne) : La philologie comme art politique: la constitution mixte de Denys d'Halicarnasse sous le regard de philologues européens du XVIII e siècle. 11h30 – Hans-Jürgen Lüsebrink (Université de la Sarre, Allemagne) : La (ré-)invention de l'intellectuel-philosophe: Sénèque relu par Diderot et par Mably. 12h – Discussion. 12h30 – Déjeuner. II- Quelles médiations pour engager les sources antiques dans l'Histoire? 14h – Alexandre Goderniaux (Université de Liège, Belgique) : L'Antiquité pour convaincre. L'histoire romaine dans les libelles de la Ligue parisienne (1585-1594): rhétorique et circulation du savoir historique. 14h30 – Frédéric Dauzet (Université Paris-Sorbonne) : Jean Domat magistrat (1625-1696), passeur entre Droit romain et État de droit moderne. 15h – Camille Pollet (Université de Nantes) : Convoquer l'Antiquité pour définir la noblesse en Espagne, en France et en Angleterre au XVIIe siècle. 15h30 – Léa Gagnon (Université du Havre) : L'histoire métallique de Louis XIV: un récit entre modèle antique et nouvelle gloire. 16h – Discussion. 17h – Fin des débats. Mardi 24 octobre 10h – Accueil III- Une médiation socio-culturelle: la politique antique vue par la littérature de Cour 10h30 – Delphine Amstutz (Université Paris-Sorbonne) : Présences de l'Antiquité dans la pensée politique de Guez de Balzac: Aristippe ou de la Cour . 11h – Joséphine Gardon (ENS Lyon) : Les politiques antiques et leur transmission dans Le Grand Cyrus et Clélie de Madeleine de Scudéry. 11h30 – Discussion 12h – Déjeuner IV- Penser avec l'Antiquité: quelles médiations dans les réinterprétations personnelles de la politique antique? 14h00 – Sébastien Roman (ENS Lyon) : L'Antiquité et l'enseignement des humanités au XVI e siècle: étude comparative de Machiavel et de La Boétie. 14h30 – Marta Libertà De Bastiani (Université di Roma Tre, Italie / ENS Lyon) : Hobbes et Spinoza lecteurs de Tacite. 15h00 – Raffaele Carbone (IHRIM / Université Federico II, Naples, Italie) : Malebranche et l'héritage politique antique. 15h30 – Sergey Zanin (Université de Samara, Russie) : Référence à l'Antiquité chez Rousseau: des Lettres écrites de la montagne au projet polonais. 16h – Discussion 17h – Conclusion
↧
Viatica ,Hors-série n°1, oct. 2017 : "Bouvier, capital intermédiaire"
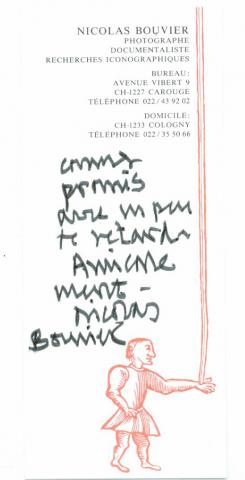 Viatica, Bouvier, intermédiaire capital (hors-série, n°1), Presses universitaires Blaise Pascal, octobre 2017. ISSN : 2275-0827 [..] Si Bouvier est bien un auteur suisse (par sa nationalité, par le lieu où il résidait, et même, paradoxalement, par la volonté de mettre à distance son éducation calviniste ...), il est aussi un écrivain pleinement inscrit dans une littérature qui dépasse les frontières nationales- son objet de prédilection, le voyage, l'y prédestinait, ainsi que ses lectures privilégiées, renvoyant à des langues et des aires culturelles multiples (Henri Michaux, Vladimir Holan, Henry Miller...). Et, de fait, la vaste reconnaissance dont il fait aujourd'hui l'objet, y compris aux États-Unis, où il a d'ailleurs brièvement enseigné et donné des conférences à la fin de sa vie, nous conduit à prendre en compte une production critique désormais internationale et plurilingue. Ce numéro de Viatica s'inscrit dans ce mouvement d'ouverture, qui permet en retour d'éclairer Bouvier de manière plurielle. [...] Sommaire : Introduction Sarga Moussa I. Nouvelles lectures de l'Usage du monde Les morceaux épars d'une mosaïque détruite : language, literature and the poetics of travel Charles FORSDICK Tabriz dans L'Usage du monde : un cosmopolitisme dans les marges Sarga MOUSSA Musique du voyage, musique de l'écriture : Les fondements d'un paradigme dans L'Usage du monde Raphaël PIGUET La géographie précaire de L'Usage du monde Liouba BISCHOFF II. Récits, images, traductions Bouvier et le quatuor cingalais, ou les ambivalences de la «magie» Xavier RIDON Choses (entre)vues Danièle MÉAUX Voyage et expression poétique : Bouvier lecteur et traducteur de Bashô Muriel DÉTRIE III. Correspondances et entretiens La fabrique du tales teller Philippe ANTOINE La Correspondance de Thierry Vernet à ses proches.Un contrepoint à L'Usage du monde Gilles LOUŸS Bibliographie critique
Viatica, Bouvier, intermédiaire capital (hors-série, n°1), Presses universitaires Blaise Pascal, octobre 2017. ISSN : 2275-0827 [..] Si Bouvier est bien un auteur suisse (par sa nationalité, par le lieu où il résidait, et même, paradoxalement, par la volonté de mettre à distance son éducation calviniste ...), il est aussi un écrivain pleinement inscrit dans une littérature qui dépasse les frontières nationales- son objet de prédilection, le voyage, l'y prédestinait, ainsi que ses lectures privilégiées, renvoyant à des langues et des aires culturelles multiples (Henri Michaux, Vladimir Holan, Henry Miller...). Et, de fait, la vaste reconnaissance dont il fait aujourd'hui l'objet, y compris aux États-Unis, où il a d'ailleurs brièvement enseigné et donné des conférences à la fin de sa vie, nous conduit à prendre en compte une production critique désormais internationale et plurilingue. Ce numéro de Viatica s'inscrit dans ce mouvement d'ouverture, qui permet en retour d'éclairer Bouvier de manière plurielle. [...] Sommaire : Introduction Sarga Moussa I. Nouvelles lectures de l'Usage du monde Les morceaux épars d'une mosaïque détruite : language, literature and the poetics of travel Charles FORSDICK Tabriz dans L'Usage du monde : un cosmopolitisme dans les marges Sarga MOUSSA Musique du voyage, musique de l'écriture : Les fondements d'un paradigme dans L'Usage du monde Raphaël PIGUET La géographie précaire de L'Usage du monde Liouba BISCHOFF II. Récits, images, traductions Bouvier et le quatuor cingalais, ou les ambivalences de la «magie» Xavier RIDON Choses (entre)vues Danièle MÉAUX Voyage et expression poétique : Bouvier lecteur et traducteur de Bashô Muriel DÉTRIE III. Correspondances et entretiens La fabrique du tales teller Philippe ANTOINE La Correspondance de Thierry Vernet à ses proches.Un contrepoint à L'Usage du monde Gilles LOUŸS Bibliographie critique
↧
Lucrèce
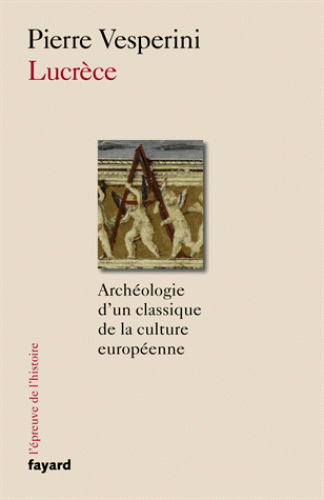 Couronné par le prix La Bruyère de l'Académie française pour Droiture et mélancolie consacré aux écrits de Marc Aurèle,(Verdier),Pierre Vesperini délaisse le stoïcisme pour l'épicurisme avec Lucrèce (Fayard), qui s'attache à la construction du mythe : "Mythe du poète hors des normes de son temps, mythe d'un Moyen Âge obscur, mythe de l'humaniste éclairé parti seul sur les routes à la redécouverte d'un passé disparu". Dénouant un à un les fils de l'histoire supposée des origines de notre modernité, P. Vesperini cherche à éclairer l'apport de l'héritage antique à notre culture européenne. Fabula vous invite à lire un extrait de l'ouvrage.
Couronné par le prix La Bruyère de l'Académie française pour Droiture et mélancolie consacré aux écrits de Marc Aurèle,(Verdier),Pierre Vesperini délaisse le stoïcisme pour l'épicurisme avec Lucrèce (Fayard), qui s'attache à la construction du mythe : "Mythe du poète hors des normes de son temps, mythe d'un Moyen Âge obscur, mythe de l'humaniste éclairé parti seul sur les routes à la redécouverte d'un passé disparu". Dénouant un à un les fils de l'histoire supposée des origines de notre modernité, P. Vesperini cherche à éclairer l'apport de l'héritage antique à notre culture européenne. Fabula vous invite à lire un extrait de l'ouvrage.
↧