Séminaire Choréa 2018-2019 - "Lieux réels, lieux rêvés à la Renaissance" Première et deuxième séance en Sorbonne, salle Paul Hazard – 10h à 13h. Le séminaire sera articulé en deux temps :la première heure sera consacrée au compte rendu d’un ouvrage récemment paru et/ou à des échanges autour d’une question méthodologique, à la présentation des travaux d’un jeune chercheur ou d’une jeune chercheuse, suivis d’une discussion.les deux autres heures seront l’occasion d’explorer le thème choisi par l’assemblée cornucopienne pour l’année, « Lieux réels, lieux rêvés à la Renaissance », à travers les interventions de jeunes chercheurs et chercheuses.20 octobre 2018 i) Présentation du séminaire et introduction ii) A. Glaize : « Les Pères de l’Eglise au XVIe siècle, ou les textes de Jean Chrysostome » iii) Monia Mejri : « Relativité et spiritualité du lieu dans la cosmologie de Nicolas de Cues » 8 décembre 2018 i) Marie Goupil-Lucas-Fontaine : « La réception de la chanson du XVIe siècle au début du XXe siècle : discours, imaginaire, appropriations » ii) Valerio Tolve : « Villa Madama in Rome. Raffaello’s dream about “Le belle forme degli edifici antichi” » iii) Sonia Zerbib : « Lieux de pouvoir, lieux de spectacles : rencontre entre réalité politique et fêtes éphémères dans les palais florentins médicéens (1539-1589) » 2 février 2019 i) Matteo Leta : « Le sud de l’Italie, lieu de tromperie et de sorcellerie à la Renaissance » ii) Alexandre Ruelle : « Entre rêves et réalités, une nouvelle représentation des Alpes occidentales à la Renaissance » iii) Lisa Pochmalicki : « Quinsay, la ville aux douze mille ponts : lieu asiatique ou lieu commun ? » 6 avril 2018 i) Anne-Gaëlle Leterrier : « Poétique des chansons et autres textes pamphlétaires catholiques en vers au temps des guerres de religion » ii) Pierre-Elie Pichot : « La poésie et les mines : quand les Muses se mussent » iii) Raphaëlle Errera : « Le mont Parnasse, un lieu réel devenu allégorie » 8 juin 2018 i) M. Giraud : titre à définir ii) Clara Lambert-Maes : « Le château de Chambord et l’abbaye de Thélème comme espaces utopiques » iii) Auderic Maret : « Lieux historiques et lieux imaginés dans le De laudibus Provinciae (1551) de Pierre Quiqueran de Beaujeu » Membres organisateurs : Paul-Victor Desarbres (Sorbonne-Université) Marie Goupil-Lucas-Fontaine (U. Paris I-Panthéon-Sorbonne) Anne-Gaëlle Leterrier-Gagliano (Sorbonne-Université) Adeline Lionetto (Sorbonne-Université) Alicia Viaud (U. Strasbourg) Pour tout information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.
↧
Lieux réels, lieux rêvés à la Renaissance (Séminaire Choréa 2018-2019, Paris)
↧
Re-Membering Hospitality in the Mediterranean:Essays in Anglophone Literature, Arts, and Culture
Call for Papers for Peer-Reviewed Edited Volume Re-Membering Hospitality in the Mediterranean: Essays in Anglophone Literature, Arts, and Culture Co-edited by Yasser Elhariry, Isabelle Keller-Privat, Edwige Tamalet Talbayev Hospitality is a complex, paradoxical concept whose etymology foregrounds an aporia. Derived from hostis , the foreigner and potential enemy, the hospes or host welcomes the guest, implying an intricate relationship between receiver and received, insider and outsider, as well as a compensatory relation since both hospes and hostis derive from the Latin verb hostire : “to treat as equal,” “to compensate,” “to pay back” (Grassi 35). The foreigner shifts from the position of an endangered, alienated subject to one who is included within the protective folds of the polis and the home. In welcoming the other, the host not only shares his home and power, but also entitles the guest (if only temporarily) to his own power as despot—etymologically, “the master of the house who lays down the laws of hospitality” (Derrida 149)—while reasserting his own domination. As a result, the commutative essence of the relationship between host and guest—whereby, as René Schérer argues, the host “acknowledges, through and thanks to the figure of the guest, his own exilic self” (40)—is perpetually jeopardized. In Claude Raffestin’s formulation, “hospitality is a right that warrants the transgression of limits without entailing violence” (166; qtd. Grassi 23). Indeed, hospitality in the Middle Ages was compulsory as anyone who was sedentary was likely to turn into a pilgrim: vagrants and beggars who transgressed the social order always found a protective threshold and a right of passage in medieval society. Hospitality was the ultimate gift, a gift that transcended the laws and materialized in the food or horses often bestowed upon the guest when he departed. This is what leads Schérer to posit that “hospitality has and is an economy, in the full sense of the word, because it constantly reestablishes the production and circulation of a flux that would otherwise petrify and impoverish itself” (126). In contemporary society, however, this ultimate gift of the self—whereby hospitality stands out as “more than human, always engaging the divine [since] it is a god who is welcomed, a god bought by gifts, a mysterious Other” (Schérer 129)—is ruthlessly shattered. Developing Derrida’s concept of “hospitality, hostility, hostpitality ” (45), Ana Manzanas Calvo and Jesús Benito Sánchez demonstrate that “hospitality […] can cannibalize the Other in a radical act of incorporation that apparently dissolves limits and demarcations” (84). Such is the case in the garden of evil in George Saunders’s “The Semplica-Girl Diaries” (2012), in which inanimate immigrants hanging on a line exemplify the cruel devitalization and “commodification of the Other” (Manzanas Calvo and Benito Sánchez 178). Hospitality violently, albeit surreptitiously, transforms the guest into a ghost, not unlike Oedipus who, Derrida shows, “presents himself as a spectre” (654) in the last abode where he is to be secretly buried. This process of disincarnation takes the form of fierce linguistic, economic, and political processes of dehumanization, on both personal and state-orchestrated levels. The exiled Egyptian poet Edmond Jabès imagines a dialogue between hostis and hospes in which the latter asks: “What do you come to do in my country?” He insists that “your attachment to my homeland does not justify your permanent presence amongst us […] Stranger, you will always be a foreigner to me. Your place is your home and not here.” Seeking refuge in the hospitality of language, the guest ripostes: “Your country is that of my language” (Jabès 51). Linguistic (in)hospitability harkens to another etymological derivation of the verb hostire in the Latin hostia —the victim meant to alleviate the gods’ wrath. This root gave birth to the French word hostie , whose English translation, wafer , derives from a different origin, but still conveys the same idea: the ultimate selfless gift as a compensation for death and absence through a displaced form of presence. Such is the ultimate meaning of Oedipus’s cryptic burial in a place where he does not belong and where he is not to be physically located, a place that he nevertheless keeps haunting. Though spectral and intangible, his presence is most acutely real in the very tears of Antigone. Her grief imparts visibility and reality to what is denied any visible existence: “Antigone asks something clear: that he see her at last, […] and see her weep. More specifically: she commands him to see her tears. The invisibility, the placelessness, the illocality” (Derrida 115). These preoccupations are particularly resonant in the context of the Mediterranean space, where Anglophone writers have often seen a Promised Land that was soon to be denied or corrupted “by the specter of inhospitality” (Manzanas Calvo and Benito Sánchez 55). Whether we think of what Hakim Abderrezak reads as a story of the “Mediterranean seametery and cementery ” (149), or of Cypriot artist Christoforos Savva renegotiating “his seemingly marginal positionality” as a modernist and avant-garde artist who disputes Western paradigms of modernity and tradition (Danos 78), we realize that artists and writers embedding their work in the Mediterranean always confront the dialectics of hospitality, and that the stereotyped vision of a fundamentally hospitable Mediterranean is at odds both with ancient laws and modern practices. Lawrence Durrell’s experience of hospitality in the Greek islands, for example, shows a world of “fragmentation, instability, and connectivity […] that opens up new connections” (Keller-Privat 47-48) by shattering and redefining common understandings and practices of hospitality. As “The Middle Sea” or the “Mare Nostrum” which has repeatedly been the stage of strong economic and colonial strife, the Mediterranean powerfully brings to the fore the ontological difficulty that lies at the heart of the praxis and ethics of hospitality. For, as Derrida reminds us, “what is difficult are the things that don’t let themselves be done [ faire ], and that, when the limit of difficulty has been reached, exceed even the order of the possible” (127). How does the Mediterranean invite us to rebuild new forms of artistic and literary forms of hospitality that challenge these boundaries? Antigone’s tears remind us that “there is no hospitality without memory. A memory that did not recall the dead person and mortality would be no memory. What kind of hospitality would not be ready to offer itself to the dead one, to the revenant?” (144). Hospitality, therefore, is not a given fact of social praxis, or an innate ethical urge. Rather, it is a way of being in the world that is constantly reconstructed through past narratives, voices, and art works. These reconstructions “recall the dead and the mortal” in order to foster a boundary-crossing impetus that defies the laws. The process of reconstruction takes various forms and crosses linguistic boundaries through the appropriation of the Other’s language, words, and images, forging a committed type of heteroglossy (Paddington). It is always a reconstruction that challenges political and national forms of belonging. How then can the Mediterranean be considered as the ideal locus for re-membering hospitality? How does it operate as a creative node of hospitality that links the sea and the hinterland? How does it implement a radical connectivity between lands and people? How would it corroborate Jabès’s assumption: “Abiding by the unformulated imperatives of hospitality somehow implies learning our dependence upon others” (70)? May we read Anglophone Mediterranean explorations in the poetry, fiction, and travel books it has nurtured as the place where “the boundless hospitality of the book” (67) is redefined and reasserted—remembering and transcending the memory of all those who, in the wake of Odysseus, brought nothing with them but the fluidity of time and space, and the intimate knowledge that we are all transient guests on earth? Papers may focus on the displacement and resemanticization of Mediterranean and Biblical narratives of hospitality in Anglophone literature and the arts. The Mediterranean may also be envisaged as a locus of displaced, unexpected hospitality for early modernist female writers. Anglophone writers taking shelter in the Mediterranean also experience the “limits of difficulty” in the hospitality they are granted: an indomitable sense of estrangement lies at the heart of a new belonging, notably in works that contribute to the re-membering of a hospitality that is constantly endangered. The specific locations of hospitality—pilgrims’ hospitals, hospices, convents, and, later on, hostels and hotels—also play an important role in the narratives redefining the contours of the Mediterranean, where early travelers navigated between hostility and hospitality, and where modern ones often stand out as precarious guests. The hospitality that writers and artists have sought, received, and rebuilt on Mediterranean shores, particularly in the tightly woven artist colonies that spanned the Near and Middle Easts in the twentieth century, may also be envisaged as a hermeneutic tool for the critique of our present-day “sick hospitality” (Manzanas Calvo and Benito Sánchez 107). From that perspective, the Mediterranean may be considered as the locus of a newly founded commonality whereby, as Andrew Benjamin argues, “centrality would be attributed to relationality. Being-in-common […] marks the primordiality of relationality, and thus what counts as human being needs to be incorporated within a relational ontology” (29). Historical, mythological, ethnographic, visual, literary, cinematic, and intermedial approaches are all welcome provided that they define and articulate a concept of hospitality, its relation with memory, and the confrontations and reunions that substantiate the emergence and deployment of new forms of commonality within the Mediterranean space. * Detailed abstracts (600 words) are due by January 1, 2019 to Yasser Elhariry ( yasser.elhariry@dartmouth.edu ), Isabelle Keller-Privat ( isa.kellerprivat@gmail.com ), and Edwige Tamalet Talbayev ( etamalet@tulane.edu ) Contributors will be notified of acceptance by January 26, 2019. Completed manuscripts (6,000 words) are due July 1, 2019. Manuscripts will be rigorously edited prior to submission to the press. We are also applying for funding for a symposium that will offer all contributors the opportunity to meet at the University of Toulouse Jean Jaurès in Spring 2020 ahead of publication. References Abderrezak, Hakim. “The Mediterranean Seametery and Cementery in Leïla Kilani’s and Tariq Tenguia’s Filmic Works.” Critically Mediterranean: Temporalities, Æsthetics, and Deployments of a Sea in Crisis , ed. yasser elhariry and Edwige Tamalet Talbayev. New York: Palgrave, 2018, pp. 147-161. Benjamin, Andrew. Place, Commonality and Judgment: Continental Philosophy and the Ancient Greeks . London: Continuum, 2010. Danos, Antonis. “Mediterranean Modernisms: The Case of Cypriot Artist Christoforos Savva.” Critically Mediterranean: Temporalities, Æsthetics, and Deployments of a Sea in Crisis , ed. yasser elhariry and Edwige Tamalet Talbayev. New York: Palgrave, 2018, pp. 77-110. Derrida, Jacques. Of Hospitality. Anne Dufourmantelle Invites Jacques Derrida to respond . Stanford: Stanford University Press, 2000. Eells, Emily, Christine Berthin, and Jean-Michel Déprats, eds. L’Étranger dans la langue . Paris: Presses Universitaires de Paris Ouest, 2013. Elhariry, Yasser, and Edwige Tamalet Talbayev, eds. Critically Mediterranean: Temporalities, Æsthetics, and Deployments of a Sea in Crisis . New York: Palgrave, 2018. Gifford, James. Personal Modernisms: Anarchist Networks and the Later Avant-Gardes . Alberta: The University of Alberta Press, 2014. Goethals, Helen, and Isabelle Keller-Privat, eds. Le Pays méditerranéen en profondeur/The Mediterranean and Its Hinterlands . Toulouse: Presses Universitaires du Midi, 2018. Grassi, Marie-Claire. “Passer le seuil.” Le Livre de l’hospitalité: accueil de l’étranger dans l’histoire et les cultures , ed. Alain Montandon. Paris: Bayard, 2004, pp. 21-34. Jabès, Edmond. Le Livre de l’hospitalité . Paris: Gallimard, 1991. Keller-Privat, Isabelle. “Lawrence Durrell’s Mediterranean Shores: Tropisms of a Receding Line.” Critically Mediterranean: Temporalities, Æsthetics, and Deployments of a Sea in Crisis , ed. yasser elhariry and Edwige Tamalet Talbayev. New York: Palgrave, 2018, pp. 45-64. Le Blanc, Guillaume, and Brugère Fabienne. La Fin de l’hospitalité: Lampedusa, Lesbos, Calais… jusqu’où irons-nous? Paris: Flammarion, 2017. Manzanas Calvo, Ana, and Jesús Benito Sánchez. Hospitality in American Literature and Culture. Spaces, Bodies, Borders . New York: Routledge, 2017. Montandon, Alain, ed. Le Livre de l’hospitalité: accueil de l’étranger dans l’histoire et les cultures . Paris: Bayard, 2004. Paddington, P. L. “L’hétéroglossie ponctuelle.” L’Étranger dans la langue , ed. Emily Eels, Christine Berthin, and Jean-Michel Déprats. Paris: Presses Universitaires de Paris Ouest, 2013, pp. 57-71. Raffestin, Claude. “Réinventer l’hospitalité.” Communications n°65. L’hospitalité . Paris: Seuil, 1997, pp. 165-177. Saunders, Georges. “The Semplica-Girl Diaries.” The New Yorker . 15 October 2012. https:// newyorker.com/magazine/2012/10/15/the-semplica-girl-diaries. Schérer, René. Hospitalités . Paris: Anthropos, 2004. ———— Zeus hospitalier . Paris: La Table Ronde, 2005.
↧
↧
Les écritures du Je dans la langue de l'exil (ENS Paris)
Programme du Colloque international L’Écriture du « je » dans la langue de l’exil Paris, ENS, rue d'Ulm, Vendredi 14 décembre, Samedi 15 décembre et Dimanche 16 décembre 2018 Organisé par Isabelle Grell-Borgomano (« Genèses d’autofictions » ITEM/ENS/CNRS) et Jean-Michel Devésa (EA EHIC, Université de Limoges, France) Vendredi après-midi : 14.30 – 18.00 Salle Celan « Perspectives théoriques et critiques appliquées » (Modération : Isabelle Grell-Borgomano) 14.30-14.45 Ouverture : Isabelle Grell et Jean-Michel Devésa 14.45-15.15 Alain Ausoni (ENS-Paris, France/Université de Lausanne, Suisse), « Je après d’autres : affiliations littéraires et dialogues d’exilé·e·s dans les mémoires d’outre-langue » 15.15-15.45 Faure Alexandre (Doctorant, Université de Rennes 2, France), « Les Langues de l’exil : écriture du reste » Pause 16.00-16.30 Dagtekin Seyhmus (Écrivain, Kurdistan-France), « Comme on changerait de monture en cours de route » 16.30-17.00 Sarah Chiche (Écrivain, psychanalyste, Paris), « ‘Je ne suis rien’. Exil de soi et hantises dans le livre de l’intranquilité de Fernando Pessoa » 17.00-17.30 Darina al Joundi (Écrivaine, dramaturge, actrice, Liban-Paris), « Prisonnière de l’exil » 17.30-18.00 Discussion Samedi matin : 9.30 – 12.45 Salle Cavaillès « Voix (croisées) africaines » (Modération : Lori Saint-Martin) 9.30-10.00 Beata Umubyeyi-Mairesse (Écrivaine, Rwanda-France) : « Comprendre le je, dire le nous : élaboration d’un récit singulier entre français et kinyarwanda » 10.00-10.30 Marie-Claude Hubert (Université de Lorraine, France), « Mukasonga, (se) réfléchir dans l’histoire » 10.30-11.00 Karen Ferreira-Meyers (University of Eswatini), « L’Autofiction historique de Vamba Sherif : réécriture en langue étrangère » Pause « Se perdre ou se trouver dans la langue de l’A/autre » (Modération : Jean-Michel Devésa) 11.15-11.45 Lori Saint-Martin (Écrivaine, Université du Québec à Montréal, Québec), « Ma Vie entre les langues » 11.45-12.15 Table ronde : Les Écrivains africains de la diaspora et leur(s) langues : Sami Tchak (Togo) et Théo Ananissoh (Togo) 12.15-12.45 Discussion Samedi après-midi : 14.30 – 18.15 Salle Cavaillès « Se dire en terre(s) d’islam » (Modération : Sylvain Bureau) 14.30-15.00 Arnaud Genon (Écrivain et critique, Allemagne), « De la langue du pouvoir au pouvoir de la langue : les différents ‘je’ d’Abdellah Taïa » 15.00-15.30 Abdellah Taïa (Écrivain, scénariste, Maroc-Paris), « Manger ou ne pas manger, écrire ou ne pas écrire » 15.30-16.00 Fadoua Roh (Doctorante, Université de Paris IV-Sorbonne), « L’Œuvre d’Abdellatif Laabi ou le moi ‘exilé’ marocain » Pause « La Difficulté d’être translingue » (Modération : Arnaud Genon) 16.15-16.45 Sylvain Bureau (Université fédérale du Paraná – Brésil), « L’« Écrivivance » de Conceição Evaristo ou l’autofiction contemporaine des femmes brésiliennes » 16.45-17.15 M’Raim Malika (Université Ibn Khaldoun, Tiaret, Algérie), « Écriture et mise en scène du ‘je’ chez la romancière Assia Djebar » 17.15-17.45 Houdu Lucie (Doctorante, Paris 3) : « Un Je toujours entre deux langues : Tony Harrison et l’écriture poétique de l’exil » 17.45-18.15 Discussion Dimanche matin : 9.30 – 12.45 Salle Cavaillès « Du choix de la langue du pays d’accueil » (Modération : Nurit Levy) 9.30-10.00 Claire Olivier (Doctorante, Université de Limoges, France), « Agota Kristof et les ‘langues ennemies’ » 10.00-10.30 Dirk Weissmann (Université de Toulouse - Jean Jaurès, France), « La Langue de l’Europe, c’est le plurilinguisme — Yoko Tawada et l’identité européenne » 10.30-11.00 Entretien d’Isabelle Grell avec l’auteur Anne Weber Pause 11.15-11.45 Martina Wagner-Egelhaaf (Université de Münster, Allemagne) : « Autofiction et multilinguisme chez Emine Sevgi Özdamar » « Fuir l’horreur pour la dire et l’écrire » (Modération : Dirk Weissmann) 11.45-12.15 Nurit Lévy (Université de Lille, France), « Raymond Federman dans l’entre deux langues. Étude de La Voix dans le débarras/The Voice in the Closet » 12.15-12.45 Georges-Arthur Goldschmidt (Écrivain, Allemagne-France) Dimanche après-midi : 14.30 – 17.45 Salle Cavaillès « Le Fil assumé ou dénié de l’exil » (Modération : Romuald Fonkoua) 14.30-15.00 Rania Fathy (Université du Caire, Egypte), « La Trilogie de Gulpérie Efflatoun Addalla : l’exil de la langue ? » 15.00-15.30 Nathalie Segeral (University of Hawaï, États-Unis), « Exil, langue maternelle et (non-)maternité dans Une Autobiographie allemande de Cécile Wajsbrot et Hélène Cixous » 15.30-16.00 Linda Lê (Écrivaine, Vietnam-Paris), « Hors Je. À propos de Norman Manea » Pause « De l’exil, des langues et de leurs poétiques » (Modération : Karen Ferreira-Meyers) 16.15-16.45 Romuald Fonkoua (Université de Paris IV - Sorbonne), « De la langue comme pré-texte : petite histoire d’un faux malentendu francophone » 16.45-17.15 Claire Legendre (Université de Montréal, Québec), « La Poétique de l’exil dans l’œuvre autofictionnelle de Fernando Arrabal » 17.15-17.45 Discussions Textes des communications : 1er décembre 2018, au plus tard. Communications relues et corrigées : 1er février 2019. Édition des Actes : Academia-Bruylant, Belgique. Pour tout complément d’information écrire à : Isabelle Grell-Borgomano (isabelle.grell@gmail.com) et Jean-Michel Devésa (jmdevesa@free.fr).
↧
Résistances du babillage : peut-on parler pour ne rien dire au Siècle des Lumières ? (Paris 3)
RÉSISTANCES DU BABILLAGE: PEUT-ON PARLER POUR NE RIEN DIRE AU SIÈCLE DES LUMIÈRES? Langue des oiseaux, des enfants et des femmes, expression d’une «crise intérieure» selon Roland Barthes, le babil est hors cadre, hors norme: au dix-huitième siècle, il résiste à la conversation suivie et au questionnement philosophique, il assiège de sa corrosive frivolité autant les débats féconds que le pascalien silence des «espaces infinis». Par là, il constitue un geste de subversion et de résistance vis-à-vis de la rationalité conquérante du siècle telle qu’elle s’illustre par exemple dans l’entreprise encyclopédique. N’oublions pas que selon Furetière, on applique le terme de babillard à un chien de chasse «lorsqu’il crie des matinées entières ou bien lorsqu’il est hors des voies», bref, lorsqu’il déroge aux règles. L’acte de babiller, ou de se revendiquer de cette formede parole, constitue aussi une arme souriante, lourde d’ironie latente, vivement lancée contre l’esprit de sérieux, de méthode et d’exhaustivité. Ainsi, l’objet de cette journée d’étude sera de distinguer les diverses portées, fonctions, incarnations de ce que Marivaux définit comme l’«innocente faiblesse d’aimer à parler». PROGRAMME 18 octobre 2018 - 9h30-17h30 Maison de la Recherche de Paris 3 (4 Rue des Irlandais 75005) Salle Athéna (rdc) Contact: helene_boons@hotmail.fr 9h30Accueil des participants 9h45Mot d’ouverture (Hélène Boons) LE BABIL AU FEMININ Présidence de séance: Marie-Emmanuelle Plagnol|UPEC 10h00 Florence Dujour |Université Paris-Nanterre De Marianne à Suzanne, vie et mort du babil 10h30 Chanel de Halleux |Université d’Oxford Le « babil le plus sémillant » : La Marmotte philosophe de Fanny de Beauharnais 11h00Pause ATTERRER LES BABILLARDS? PERSPECTIVES ROUSSEAUISTES Présidence de séance: Claude Habib|Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 11h30 Nicolas Fréry |Sorbonne Université Contre «l’éducationbabillarde»: babil et enfance chez Rousseau 12h00 Patrick Hochart |Université Paris Diderot Babil et babillards dans l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau 12h30Déjeuner FORMES DIALOGIQUES, FORMES BABILLARDES? Présidence de séance: Erik Leborgne|Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 14h00 Christophe Martin |Sorbonne Université “Du babil et du silence de toutes couleurs” : le babillage dans le théâtre de Marivaux 14h30 Anne-Marie Paillet |E.N.S/P.S.L Le bavardage au filtre du discours narrativisé : de la substance au bruit (approche pragmatique et stylistique) LA PRESSE BABILLARDE Présidence de séance: Alexis Lévrier|Université de Reims 15h00 Hélène Boons |Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 Les «spectateurs» babillards ou L’écriture morale en question 15h30 Jean-Alexandre Perras |I.É.A, Paris Le babil des brochures 16h00Pause TABLE RONDE: Le babil, parole hors-norme 16h30 Jeanne Chiron |Université de Rouen Stéphanie Genand |Université de Rouen Alexis Lévrier |Université de Reims
↧
Panel "Negativité narrative" (2019 International Conference on Narrative, Pampelune)
(English version below) Appel à contribution Panel « Negativité narrative » 2019 International Conference on Narrative 6-8 juin 2018 Université de Navarre, Pampelune, Espagne Depuis ses tout débuts, la narratologie classique a établi un accès analytique à l’étude du récit qui comporte un large éventail d’implications positivistes, que ce soit la déduction de règles de composition génériques à partir d’une base de données de récits déterminée positivement (V. Propp) ou la définition du récit à travers l'énumération de qualités positives (ou définissables positivement), telles que l'«assurance» (G. Prince), l'«événementialité» (W. Schmid) ou la «clôture» (M.-L. Ryan). Bien que plusieurs auteurs - tels que Roman Ingarden, Wolfgang Iser, Julia Kristeva et Maurice Blanchot - aient à plusieurs reprises défini la «négativité radicale» comme étant la véritable «infrastructure des textes littéraires» (Iser), la négativité a été jusqu'ici négligée par les narratologues, probablement dû à la difficulté d'identifier ce phénomène au moyen de méthodologies établies (classiques ou postclassiques). Notre panel propose d'orienter la discussion des artefacts narratifs et des définitions de la narrativité fondés sur la positivité vers ce que l'on pourrait appeler provisoirement le «côté négatif» des phénomènes narratifs – à savoir vers les structures narratives, les dynamiques, les fonctions et les effets dont la nature ne permettrait pas une conceptualisation positive, contredirait les qualités positives que les récits sont supposés avoir ou qui ne posséderait guère d’aspects «positivement » observables. Nous entendons inscrire ce panel dans la continuité de certaines réflexions sur la narrativité telles que, par exemple, la distinction proposée par Julia Kristeva entre «géno-» et «phéno-» texte, les thèses de Wolfgang Iser sur la «négativité radicale» qui soutiendrait tout récit, les recherches de Brian Richardson à propos des récits « non-naturels » et «anti-mimétiques», la distinction de Gerald Prince entre le «non-raconté» le «dis-raconté» et le «non-racontable», et la conception de Marie-Laure Ryan de la «virtualité». Les sujets pourraient s'inscrire dans les quatre axes qui suivent :Négativité épistémique: Quels phénomènes narratifs résistent aux tentatives de théorisation positive ? Quelles structures et dynamiques narratives remettent en cause le paradigme de la définition analytique de la narrativité ? Les approches post-structuralistes peuvent fournir un cadre théorique adapté à cet axe de recherche.Négativité linguistique: Les narratologues soulignent régulièrement la différence entre les contenus narratifs ou les structures d’un côté et les interprétations du récit de l’autre. Cependant, cette ligne de démarcation s'applique mal aux processus de formation du sens d'un texte narratif. En effet, les récits mettent en mouvement des dynamiques sémantiques complexes qui ne peuvent être directement reconduites au texte narratif tel qu'il est et à ses voix. À ce sujet, nous vous invitons à proposer des contributions qui (a) situent cette lacune linguistique au cœur de la signification narrative, (b) analysent concrètement les techniques par lesquelles certaines narrations parviennent à nous dire quelque chose sans la «raconter» ou (c) réfléchissent aux conséquences qu'une telle conception «a-linguistique» de la narrativité pourrait comporter sur la théorie du récit.Négativité littéraire: L'une des difficultés de la théorie narrative consiste à séparer l'analyse narrative de l'évaluation narrative. Comment définir des qualités narratives ou un haut degré de narration sans évaluer ce qu'est un récit «bon», «littéraire», «ennuyeux» ou «mauvais» ? Une approche normative-évaluative de la narration pose toutefois problème dans la mesure où les récits peuvent contester intentionnellement des normes littéraires et narratives positives (par exemple, principes de clôture, signification ou innovation littéraire) et des catégories (par exemple, des distinctions génériques entre la «littérature» et son équivalent «prosaïque»). Nous vous invitons à réfléchir à propos des différentes formes que peut assumer cette négativité littéraire des récits.Négativité radicale: Peut-on s'interroger sur le rôle de la négativité dans un texte narratif sans devoir obligatoirement s’appuyer sur la distinction positif/négatif ? Peut-on concevoir une méthodologie centrée sur la recherche de la négativité d’un récit qui puisse se passer de certaines distinctions (post)classiques telles que récit mimétique/non-mimétique, naturel/non-naturel ?Toute contribution qui ne correspondrait à aucun de ces quatre axes est également la bienvenue. Veuillez soumettre un résumé de 200 mots et des informations bio-bibliographiques, y compris votre affiliation institutionnelle, jusqu'au 31 octobre 2018 aux deux organisateurs du panel : Eva Sabine Wagner: es.wagner@gmx.net Antonino Sorci: antosorci@hotmail.it Veuillez indiquer "ISSN 2019 negativity: proposition" comme objet de vos propositions. * Call for contributions Panel « Narrative negativity » 2019 International Conference on Narrative June 6-8, University of Navarra, Pamplona, Spain Since its very beginnings, classical narratology has established an analytical access to the study of narrative which has a broad range of ,positivistic’ implications, be it the deduction of generic compositional rules from a positively determined data base of narratives (V. Propp) or the definition of narrative via positive (or positively definable) qualities, such as “assurance” (G. Prince), “eventfulness” (W. Schmid) or “closure” (M.-L. Ryan). Although several authors –such as Roman Ingarden, Wolfgang Iser, Julia Kristeva and Maurice Blanchot– have several times defined the “radical negativity” as being the true “infrastructure of the literary texts” (Iser), negativity has been hitherto neglected by narratologists, probably due to the difficulty of identifying this phenomenon by means of established (classical or postclassical) methodologies. Our panel proposes to shift the focus from positive narrative facts and definitions to what could provisionally be labelled the ,negative’ side of narrative phenomena – to narrative structures, dynamics, functions or effects whose very nature hardly allows for a positive conceptualisation, negates categorisation, contradicts the positive qualities which narratives are supposed to have or emphasises aspects which are not ,positively’ evident. We consider this panel to inscribe itself into an existing line of inquiry which manifests itself, for example, in Julia Kristeva distinction’s between ,geno’ and ,pheno’ text, Wolfgang Iser’s thesis about the ,radical negativity’ of a narrative, B. Richardson’s research on ,unnatural’ and ,antimimetic’ narratives, Prince’s distinction of ,the unnarratable’, ,the unnarrated’ and ,the disnarrated’ and Ryan’s conception of narrative ,virtuality’. Topics which might be explored in the panel can include (but are not restricted to) the following four fields:Epistemic negativity: Which narrative phenomena do resist attempts of ,positive’ theorisation? Which narrative structures and dynamics challenge the analytical-definitional paradigm? Poststructuralist approaches can provide a theoretical background of this field of inquiry.Linguistic negativity: Narratologists underline regularly the difference between narrative contents or structures one the one hand and the interpretations of narrative on the other. Narrative meaning, however, does not respect this line of demarcation. Indeed, narrative texts put in motion complex semantic dynamics which cannot be directly deduced from the narrative text and its voices. We call for contribution which (a)reflect on the principled nature of this ,linguistic’ defectiveness of narrative meaning, (b)analyse concretely the techniques by which particular narratives achieve to tell us something without narrating it or (c)reflect on the consequences which such a ,linguistic’ narrative negativity has for narrative theory.Literary negativity: One of the difficulties of narrative theory consists of separating narrative analysis from narrative evaluation. How can one define narrative qualities or a high degree of narrativeness without an evaluation of what is a “good”, a “literary”, a “boring” or a “bad” narrative? A normative-evaluative approach to narrative is, however, problematic to the extent to which narratives can intentionally challenge ,positive’ literary-narrative norms (e. g. principles of closure, meaningfulness or of literary innovation) and categories (e. g. generic distinctions; discrimination between high literature and its trivial counterpart). We invite scholars to reflect on the various forms which this ,literary’ negativity of narratives can take.Radical negativity : Is it possible to question the role played by negativity in the text without resorting to the positive/negative opposition? Could we conceive a methodology centered on the search for the negativity of a narrative that can do without certain (post)classical distinctions such as mimetic-unmimetic, natural-unnatural?Any contribution to negativity that does not fit into any of these four areas is also welcome. Please submit a 200 words abstract and some bio-bibliographical information including your institutional affiliation until October 31 to both of the organisers of the panel:Eva S. Wagner: es.wagner@gmx.net Antonino Sorci: antosorci@hotmail.it Please note “ISSN 2019 negativity: proposition” as the subject of your e-mail.
↧
↧
Poste de professeur-e en théâtre, création scénique interdisciplinaire (Université Laval)
PROFESSEUR-E EN THÉÂTRE (Création scénique interdisciplinaire) Le Département de littérature, théâtre et cinéma désire pourvoir un poste de professeur-e en création scénique interdisciplinaire, sous réserve du financement d’un poste stratégique par l’Université Laval. FONCTIONS La personne titulaire de ce poste devra : • Enseigner aux trois cycles dans le domaine du théâtre et des arts de la scène ; • Encadrer des étudiants aux trois cycles et diriger des mémoires de maîtrise et des thèses de doctorat ; • Mener des activités de recherche-création dans le domaine du théâtre et des arts de la scène ; • Participer au bon fonctionnement des programmes de théâtre, au premier cycle, et de littérature, arts de la scène et de l’écran, aux 2e et 3e cycles ; • Participer aux activités de recherche-création du Laboratoire des nouvelles technologies de l’image, du son et de la scène (LANTISS) et au développement de celui-ci ; • Prendre part aux activités départementales et universitaires. CRITÈRES DE SÉLECTION • Doctorat (ou l’équivalent) dans le domaine du théâtre ou des arts de la scène ; • Expérience de l’enseignement du théâtre ou des arts de la scène au niveau universitaire ; • Réalisations reconnues tant sur le plan théorique que sur le plan pratique dans le domaine de la création scénique ; • Aptitude à travailler en équipe. TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL Selon la convention collective en vigueur. ENTRÉE EN FONCTION : le 1er janvier 2019 Faire parvenir sa candidature accompagnée d’un curriculum vitæ, du nom et des coordonnées de trois répondants et d’une description des réalisations avant le 10 octobre 2018, par courriel (postetht@lit.ulaval.ca), à l'attention de : Monsieur François Dumont Directeur Département de littérature, théâtre et cinéma Université Laval Québec Valorisant la diversité, l’Université Laval invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent.
↧
Doctoriales de l'Equipe de recherche "Littérature, histoires, esthétique" (Paris 8)
 Doctoriales de l'Equipe de recherche "Littérature, histoires, esthétique" de l'Université Paris 8 dir. Martine Créac’h et Lionel Ruffel Le mardi 2 octobre 2018 auront lieu les 5 e doctoriales de l'Equipe de recherche "Littérature, histoires, esthétique" (dir. Martine Créac’h et Lionel Ruffel) associée aux départements de Littératures française et francophones et de Littérature générale et comparée de l'Université Paris 8 dans la salle du Conseil d’UFR (B 331). Cette rencontre est ouverte à tous. Programme: 10h15-11h00 :Evelina Deneyka, «Au-delà des impensés du formalisme russe : que pourrait-on appeler ‘écriture non-figurative’ ?» 11h00-11h45 : Michel Aulas, «Herméneutique et philologie : le rapport à l'autre dans la poésie de René Char.» 11h45-12h30 : Olivier Crepin, «Le roman graphique confronté à ses mutations transmédiatiques contemporaines : perspectives narratives et éditoriales». 12h30-14h30 : Déjeuner (Buffet) 1 4h30- 15h15 :Inga Velitchko Topeshko, «Régularités compositionnelles du poème lyrique: le lien entre composition et signification». 15h15-16h00 :Gregory Jouanneau-Damance Gregory, « Imago vagans . L'Art de la tache, de Protogène à l'expressionnisme abstrait». 16h00: Clôture
Doctoriales de l'Equipe de recherche "Littérature, histoires, esthétique" de l'Université Paris 8 dir. Martine Créac’h et Lionel Ruffel Le mardi 2 octobre 2018 auront lieu les 5 e doctoriales de l'Equipe de recherche "Littérature, histoires, esthétique" (dir. Martine Créac’h et Lionel Ruffel) associée aux départements de Littératures française et francophones et de Littérature générale et comparée de l'Université Paris 8 dans la salle du Conseil d’UFR (B 331). Cette rencontre est ouverte à tous. Programme: 10h15-11h00 :Evelina Deneyka, «Au-delà des impensés du formalisme russe : que pourrait-on appeler ‘écriture non-figurative’ ?» 11h00-11h45 : Michel Aulas, «Herméneutique et philologie : le rapport à l'autre dans la poésie de René Char.» 11h45-12h30 : Olivier Crepin, «Le roman graphique confronté à ses mutations transmédiatiques contemporaines : perspectives narratives et éditoriales». 12h30-14h30 : Déjeuner (Buffet) 1 4h30- 15h15 :Inga Velitchko Topeshko, «Régularités compositionnelles du poème lyrique: le lien entre composition et signification». 15h15-16h00 :Gregory Jouanneau-Damance Gregory, « Imago vagans . L'Art de la tache, de Protogène à l'expressionnisme abstrait». 16h00: Clôture
↧
Centres et centralités en sciences humaines et sociales (Le Havre)
5 e journée des doctorants et jeunes chercheurs du Pôle de recherche en Sciences Humaines et Sociales de l'Université Le Havre Normandie “Centres et centralités en sciences humaines et sociales” Le recours aux analyses de réseaux et le spatial turn ont conduit les chercheurs des différentes sciences humaines et sociales à interpréter à nouveaux frais les notions de centre et de centralité, deux termes proches qui constituent cette année le fil conducteur de la 5 e journée des doctorants et jeunes chercheurs du PRSH. Comment définir un centre ? La notion, toute relative, ne peut se comprendre que par opposition à une périphérie ; dans une acception géographique courante, elle suppose une concentration des fonctions, des pouvoirs, et des interactions sociales, ce qui ne doit pas masquer les diverses dimensions (économiques, politiques, sociales, idéologiques et symboliques) que peut recouvrir ce terme. Les variations d’échelles, les changements de focales, font ainsi apparaître de multiples centres, hiérarchisés, concurrents, complémentaires, qui se déplacent et se recomposent au gré des évolutions des sociétés rythmées par des mouvements centripètes et centrifuges, et par des processus de centralisation ou de décentralisation. Pour autant, ces centres ne trouvent pas toujours de manifestation spatiale, et il est alors plus difficile d’en déterminer des critères d’identification : une position centrale peut ainsi être occupée par des individus ou des groupes dans une société, ou encore par des concepts et des représentations au sein d’un système de pensée. La notion de centralité permet d’aller plus loin, en invitant à mettre l’accent sur les dynamiques qui régissent les relations entre un centre et sa périphérie. À ce modèle classique viennent s’ajouter aujourd’hui les analyses de réseaux, dans lesquelles la centralité d’un nœud résulte de ses connexions, plus ou moins nombreuses et importantes avec les autres nœuds du graphe. De nouveaux outils d’analyse et de modélisation permettent donc de revisiter cette problématique ancienne, dont l’intérêt est résolument pluridisciplinaire. Si ces notions soulèvent avant tout des enjeux en géographie et en aménagement, où elles constituent des outils essentiels pour comprendre l’organisation des territoires, elles posent aussi question dans les autres sciences humaines. Ainsi, il importe d’analyser, à différentes échelles temporelles, les processus historiques liés à l’émergence de centralités éphémères ou durables. Dans le monde contemporain, les enjeux sociaux et sociétaux des différents phénomènes de centralité fournissent de nombreux objets d’étude à la sociologie et aux sciences politiques. Les sciences de l’économie et de la gestion sont elles aussi amenées à tenir compte de la prééminence de nouveaux pôles qui réorientent les flux de production et de consommation. Les juristes doivent quant à eux trouver des solutions pour mieux encadrer ces situations nouvelles. Dans le domaine des lettres, enfin, des études récentes ont permis de mettre en lumière l’existence de centres plus ou moins actifs dans le système de la littérature mondiale. Dans toutes ces disciplines, des réflexions sur la portée épistémologique de la notion de centre ont également été engagées, afin d’en mieux mesurer l’intérêt et les limites. En suivant ces quelques pistes indicatives, doctorant.e.s et jeunes docteur.e.s sont invité.e.s à présenter leurs travaux de recherche le 13 décembre 2018 à l’ Université Le Havre Normandie . Les propositions de communication, qui ne devront pas dépasser 500 mots, sont à envoyer jusqu’au 21 octobre 2018 à l’adresse suivante : jdd.prsh@univ-lehavre.fr . Elles devront faire figurer en préambule une courte biographie (comprenant vos nom, prénom, adresse email, laboratoire, champ disciplinaire et université d’origine). Une réponse sera donnée début novembre. En fonction du nombre des participants et des moyens alloués par leurs établissements de rattachement, le PRSH est susceptible de prendre en charge, en totalité ou partiellement, l’hébergement et/ou le transport. Comité d’organisation : Cette journée est organisée à l’initiative des doctorants de l’Université du Havre. Responsables de l’organisation : Maxime Emion, Mohammadali Vosooghidizaji & Relwende Aristide Yameogo Contact : jdd.prsh@univ-lehavre.fr Comité scientifique : Sébastien Adalid, Professeur de Droit public, LexFEIM, Université du Havre Nada Afiouni, Maître de conférences en Langue et Littérature anglaise, GRIC, Université du Havre Sonia Anton, Maître de conférences en Littérature française , GRIC, Université du Havre Marie-Laure Baron, Maître de conférences en Sciences de Gestion, NIMEC, Université du Havre Jean Noël Castorio, Maître de conférences en Histoire ancienne, GRIC, Université du Havre Morgane Chevé, Professeur de Sciences économiques, EDEHN, Université du Havre Pascale Ezan, Professeur en Sciences de Gestion, NIMEC, Université du Havre Béatrice Galinon-Mélenec, Professeur de Sciences de l’Information, UMR Idées Le Havre, Université du Havre Arnaud Le Marchand, Maître de Conférences en Sciences économiques, UMR Idées Le Havre, Université du Havre Bruno Lecoquierre, Professeur de Géographie, UMR Idées Le Havre, Université du Havre Patricia Sajous, Maître de Conférences en Géographie Aménagement, UMR Idées Le Havre, Université du Havre Eric Saunier, Maître de Conférences en Histoire moderne, UMR Idées Le Havre Stéphane Valter, Maître de conférences en Langue et Civilisation arabes, GRIC, Université du Havre
↧
Métamorphoses et transfigurations dans la littérature pour la jeunesse (Univ. Hradec Kralové, République tchèque)
Métamorphoses et transfigurations dans la littérature pour la jeunesse Université Hradec Kralové/ Université Lille SHS 28-29 Mars 2019 Le dictionnaire CNRTL informatisé donne de la «métamorphose» la définition suivante: «Changement de forme, de nature ou de structure si importante que l’être ou la chose qui en est l’objet n’est plus reconnaissable». Il précise que la métamorphose permet d’établir un rapport de transformation et de réciprocité entre un animé et un autre animé, ou entre un animé et un inanimé. Dans la classe des /animés/ les rapports peuvent également être établis entre /humain/ et /animal/. En outre, avant la transformation, le sujet est ce qu’il paraît, après, il paraît ce qu’il n’est pas, cette modalisation est fondamentale pour définir la métamorphose. Quant à la «transfiguration», en excluant son acception religieuse, le CNRTL la définit comme: « Transformation d’une personne humaine dont la physionomie, l’expression prennent un éclat, un rayonnement inhabituels». Par conséquent, la transformation ne s’applique qu’à des sujets relevant de la classe des /animés-humains/. Le sujet reste tel quel fondamentalement, il paraît ce qu’il est avec une intensité plus forte qui le transcende. Ainsi, pour prendre un exemple simple, dans le conte de Cendrillon , la métamorphose de la citrouille en carrosse relève de la transformation d’un /inanimé/ en /animé/, celle des rats en chevaux relève de la transformation d’un /animé/ en /animé/ avec une opération de réversibilité dans un second temps pour les deux cas puisque chacun reprend sa forme originale. Les uns et les autres sont méconnaissables. Tandis que la «transfiguration» est la transformation que subit Cendrillon lorsqu’elle revêt ses robes de séduction (ou nuptiales car on peut considérer qu’elle effectue une danse nuptiale devant le prince) pour se rendre au bal: elle porte des «habits de drap d’or et d’argent tout chamarrés de pierreries» (Perrault), qui ont donc un éclat intense, si bien que dans la salle de danse tout se fige «tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cette inconnue»; elle exerce donc par sa transfiguration un pouvoir de fascination sur les autres. Il semble alors opportun d’ajouter la fascination comme caractéristique de la transfiguration. Il s’agira d’étudier les rôles de ces deux transformations subies par les sujets, les acteurs, dans les narrations quel qu’en soit le genre: roman, théâtre, cinéma, conte, etc., et quel qu’en soit le média: l’album, le numérique, le vidéoludique, etc. On portera attention à leurs rôles narratifs: renversements de situation, valorisation ou dégradation du statut de l’héroïne ou du héros,…On étudiera particulièrement leur rôle sémantique, ce qui fait leur épaisseur, leur puissance sémantiques, peut-être due à leur valeur métaphorique et symbolique. Il s’agira de dégager le sémantisme de la relation qui relie les deux formes du sujet métamorphosé, quelles relations sont établies entre les deux. Il s’agit bien d’étudier des narrations en tant que telles, et non des procédés d’écriture, ou des bouleversements sociologiques. Comité d’organisation Kvĕtuše KUNEŠOVÁ, Département de langue et littérature françaises, Faculté de Pédagogie, Université de Hradec Kralové, République tchèque. Bochra CHARNAY, UR ALITHILA, Université de Lille Sciences Humaines et Sociales Thierry CHARNAY, UR ALITHILA, Université de Lille Sciences Humaines et Sociales Comité scientifique BAKESOVA Vaclava, Université Masaryk, République tchèque CHARNAY Bochra, Université d’Artois et Université Lille sciences humaines et sociales, E.A. 1061 ALITHILA CHARNAY Thierry, Université Lille sciences humaines et sociales, E.A. 1061 ALITHILA CHEKALOV Kirill, Institut de la Littérature mondiale de l’Académie des sciences de la Russie KUNEŠOVÁ Kvĕtuše, Faculté de Pédagogie de l’Université de Hradec, République tchèque POHORSKY Ales, Université Charles, République tchèque Modalités et calendrier Les propositions (titre, résumé de 2000 caractères maximum (espaces comprises), mots clés, et références bibliographiques) seront accompagnées d’une brève biobibliographie de 1500 caractères (espaces comprises) maximum comprenant statut, établissement et unité de recherche ainsi que les principales publications récentes. Les articles (inédits) retenus par le comité scientifique feront l’objet d’une publication après expertise. Les propositions sont à adresser au plus tard le 15 décembre 2018 à l’adresse suivante : hradeclitteraturejeunesse@gmail.com Les auteurs retenus seront prévenus au plus tard le 10 janvier 2019.
↧
↧
Théories et pratiques du Care (Montpellier)
Théories et pratiques du Care Colloque international Université Paul-Valéry et Université de Montpellier 22 et 23 novembre 2018 - Site de Saint Charles Equipes de recherches LLACS et LIRDEF L’objectif du colloque est de créer un espace de débat autour de l’idée de Care . Les éthiques et philosophies du care qui se sont développées ces trois dernières décennies semblent, en effet, intéresser de nombreuses pratiques professionnelles (enseignement, travail social, aménagement du territoire, entre autres). L’apport des réflexions autour du care repose sur quelques concepts moteurs qui sont autant d’axes structurants du colloque: - la reconnaissance des relations d’ interdépendance qui relient les êtres humains entre eux ainsi qu’aux autres espèces et à l’environnement. Une interdépendance qui s’oppose à l’idée très répandue dans notre société d’une identité fixe et séparée. La compréhension des relations d’interdépendance dans lesquelles chacun est impliqué est fondamentale dans la perspective d’une coopération entre les différents êtres sensibles. - La vulnérabilité inhérente à la vie s’exprimant sous différentes formes et à différents moments de l’existence (enfance, vieillesse, maladie, crises…). La prise en compte de cette vulnérabilité constitue le fondement même d’une attitude relevant du care , comme pratique et comme éthique. - L’importance d’une sphère relationnelle sensible, non utilitariste faite de gestes et de savoirs du care , souvent discrets, spontanés. Une sphère où chacun prend conscience qu’il a besoin de soin et de prendre soin pour vivre. Ces gestes et savoirs sont intrinsèquement liés à une dimension politique, à la création des conditions d’un «vivre ensemble». Ce colloque entend ainsi approfondir les pistes ouvertes par les études pluridisciplinaires qui ont mis en évidence ces principes. Il s’agit de contribuer à mettre à jour l’intérêt, voire la nécessité du care dans nos manières d’habiter le monde ( relation à Soi, à Autrui, à l’environnement …). Quatre domaines d’études sont envisagés: - Ecologie de l’esprit : quel rôle peut jouer le care dans la perspective d’une écologie de l’esprit fondée sur la connaissance du fonctionnement de la conscience? Comment le care peut permettre de cultiver ce qui est digne de valeur pour la vie et ainsi renforcer le sens que les êtres donnent à leur expérience du monde? - L’éducation : Comment une éducation au care pourrait-elle conduire les élèves et les étudiants à prendre soin de soi-même et d’autrui? Comment le care interroge les pratiques d’enseignements et les processus d’apprentissageindividuels et collectifs ? - L’environnement: Comment les concepts moteurs du care (interdépendance, vulnérabilité) peuvent-ils transformer nos manières de percevoir les milieux naturels et d’agir au sein d’eux? Quels enrichissements peuvent émerger d’une intégration des théories du care aux pratiques d’aménagement? - Les pratiques artistiques (littérature, art, cinéma) : Comment la création artistique participe-t-elle à l’émergence d’une éthique du care? Contacts: Angela Biancofiore Professeur, équipe LLACS, Université Paul-Valéry Montpellier 3 angela.biancofiore@yahoo.fr Clément Barniaudy, Maître de conférences, équipe LIRDEF, Université de Montpellier, clement.barniaudy@umontpellier.fr Pour s'inscrire envoyer un mail à colloque.care@gmail.com Lieu: Université de Montpellier 3, site de Saint Charles, Rue du Professeur Henri Serre 34080 Montpellier Arrêt Tram: Albert 1 er Jeudi 22 novembre 2018 8h – 9h: Accueil des participants 9h - 9h30: Ouverture du colloque par les organisateurset directeurs d’équipe Directeurs d’équipe: Jean-Marc Lange (LIRDEF), Anita Gonzalez (LLACS) Organisateurs du colloque: A. Biancofiore (LLACS), C. Barniaudy (LIRDEF) Education et Care 9h30 - 10h30: Conférence de Luigina Mortari (Professeur en Sciences de l’éducation, Université de Vérone, Italie) L’éducation comme «care» pour faire fleurir l’être Discussion (modérateur: A. Biancofiore) 10h30 - 10h45 Pause 10h45 - 12h30 Session 1 «Le care dans l’éducation» (modérateur:J.-M. Lange) Hélène Hagège (Professeure en Sciences de l’éducation,FRED, Université de Limoges) Promotion de la santé et éthique du care en contextes scolaire et universitaire Roger Monjo (Maître de conférences, Sciences de l’éducation, LIRDEF, Université de Montpellier 3) Le care, entre communautarisme et cosmopolitisme Marie Gola (Professeure de Lettres - Lycée Champollion Lattes / Chargée de mission DAAC) & Frédéric Miquel (Inspecteur Académique IPR Lettres - Rectorat de Montpellier) Les gestes pédagogiques pour «panser» l’école 12h30 – 14h30: Pause Repas 14h30 -16h Session 2 «Le care dans l’éducation» Fabienne Plégat-Soutjis (Professeure de Lettres Modernes - Collège de Carbonne) & Nathalie Panissal (Professeure en Sciences de l’éducation, Université de Toulouse) Eduquer au pouvoir d’agir, favoriser une pensée attentive. L’écriture de scénarii fictifs pour éclairer les implications éthiques. Marianne Claveau (Formatrice - Clermont Ferrand/ coordinatrice du réseau Wake Up Schools France ) & Vincent Nicotri (Enseignant à l’Ecole de Journalisme – Université d’Aix-Marseille) Les enseignants heureux changent le monde . Prendre soin des enseignants grâce à la démarche de pleine conscience Pause 16h – 16h30 16h30-17h30: Conférence d’ Angela Biancofiore (Professeure en Etudes italiennes, LLACS, Université de Montpellier 3) Care, littérature et écologie de l’esprit Discussion Vendredi 23 novembre Care, conscience et émotions 9h–10h : Conférence d’ Ilios Kotsou (Maître de conférences, Université Libre de Bruxelles – Fondateur de l’association Emergences ) Méditation et care: la connaissance de soi au service de la bientraitance Discussion 10h – 10h15: Pause Care, aménagement et environnement 10h15 – 11h15 Conférence d’ Olivier Soubeyran (Professeur en Géographie, Université de Grenoble) Crise de l’environnement, éthique et aménagement Discussion (modérateur: C. Barniaudy) 11h15 – 12h45 Session 3 « Le Care au service d’une éthique de la terre et de l’action» (modérateur: D. Crozat) Claire Tollis (Chercheuse post-doctorante en Géographie, Université Lille) Du souci au geste de soin : que met en évidence une approche par le care des pratiques de gestion des espaces naturels ? Damien Deville (Doctorant en Anthropologie/Géographie à l’INRA SAD, Université de Montpellier 3) Théorie et pratique du care: un regard sur les jardins de la précarité Clément Barniaudy (Maître de conférences en Géographie, LIRDEF, Université de Montpellier) Ecologie de l’esprit et pratiques du care en aménagement 12h45 – 14h30Pause Repas Care, littérature et arts 14h30 - 17h Session 4 «Pratiques artistiques, création et care» (modérateur A. Biancofiore) Benoît Jourdheuil (Doctorant en Philosophie, Université de Montpellier 3) L’antifragilité: une fragilité positive? Maddalena Marchetti (Professeur en lycée, Doctorante en Etudes italiennes,LLACS, Université de Montpellier 3) La letteratura come educazione allo sguardo: contro il degrado per un nuovo umanesimo Romano Summa (Professeur en lycée, Docteur en Etudes italiennes, LLACS, Université de Montpellier 3) Accepter notre fragilité: autour du roman Cordiali Saluti de Andrea Bajani Jean-Claude Mirabella (Docteur en Etudes italiennes – Enseignant PRCE, LLACS, Université de Montpellier 3): Le cinéma de Gianni Amelio : une pratique du Care ? Sondes Ben Abdallah (Doctorante en Etudes italiennes, LLACS, Université de Montpellier 3) Raconter le care : les femmes, la diversité et l'expérience de l'altérité dans la littérature 17h – 17h30 Conclusions du colloque Organisé par les équipes LLACS et LIRDEF avec le soutien de l’Institut Culturel Italien de Marseille et de la Faculté d'Education de l'Université de Montpellier
↧
Théâtre de société et société(XVIII e -XIX e siècles): quelles interactions? (Lausanne)
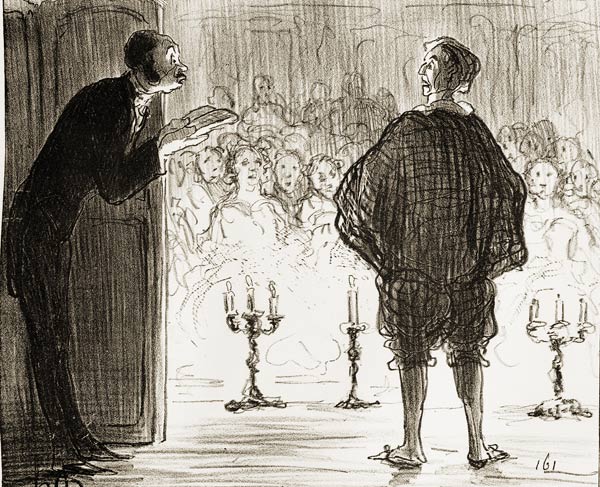 Théâtre de société et société(XVIII e -XIX e siècles): quelles interactions? Quels liens entretiennent le théâtre de société et la société civile? Ce colloque se propose de les explorer en interrogeant les fonctions de la pratique des théâtres de société (récréatives, didactiques, politiques, associatives, identitaires) et les enjeux des représentations croisées qui s'y relient: représentations des spectacles de société, de leurs acteurs et de leur public dans d'autres formes de spectacles ou de productions littéraires, et représentations de groupes, problèmes et thèmes sociaux dans les pièces "de société". Colloque internationalorganisé par la Section de français de l’UNIL, dans le cadre du projet FNS Théâtres de société. Entre Lumières et Second Empire (dir. Valentina Ponzetto) . Pour lire le texte de l'appel à contribution, cliquer ici. PROGRAMME Jeudi 22 novembre Matin 8h30: Accueil des participants 9h00: Introduction des organisatrices Réseaux (présidence: Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval) 9h30: Dominique Quéro (Université de Reims Champagne-Ardenne) – Pont-de-Veyle en société 10h00: Flora Mele (Université Paris-Sorbonne, CELLF 16 e -18 e ) – Justine Favart auteure et interprète: rôle d’une artiste polyvalente en «société» Discussion et pause 11h00: Jennifer Ruimi (FNS/Université de Lausanne) – Petits théâtres vs théâtre de société: définitions, enjeux, limites 11h30: Guy Spielmann (Georgetown University) – Théâtre «en » société ou «de » société? Pistes microsociologiques Discussion et déjeuner Après-Midi (présidence: François Rosset) 14h30: Béatrice Lovis (Université de Lausanne) – Autour de la Vaudoise Catherine de Sévery, «la Clairon de ce pais là» 15h00 : Paola Perazzolo (Université de Vérone) – «J’ai mis en manière de comédies moi-même, presque toutes mes idées sur les rangs de la société »: la société des comédies «engagées » d’Isabelle de Charrière (1793-1794) Discussion et pause Fonctions des théâtres de société 16h: Alain Sager (Amiens) – Théâtre et société: Suzanne Necker entre représentation et conscience de soi 16h30: Blandine Poirier (Université Paris-Diderot) – Le théâtre de société de Germaine de Staël: une forme d’engagement? 17h00: Veronika Studer-Kovacs(Université de Luzern) – Le plaisir de l’Autre. Identité hongroise au miroir d’une fête francophone des Habsbourg à Tyrnau . Vendredi 23 novembre Matin Ce que le théâtre de société dit de la société (présidence: Valérie Cossy) 9h30: Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval (Université Paris Est Créteil) – Du socialement correct au politiquement incorrect: pour une typologie de l’«application». 10h00: Paul Fièvre (BNF et FNS/Université de Lausanne) – Figures d'enfants dans le théâtre d'éducation de Genlis, Garnier et Moissy. 10h30: Valentina Ponzetto (FNS/ Université de Lausanne) – Le charme discret de la représentation de la société dans les proverbes de société. Discussion et pause 11h30: Piotr Olkusz (Université de Lodz) – Les théâtres de société et les réformes de la Pologne au XVIII e siècle 12h: Camilla Murgia (Université de Lausanne) – Passage de témoin : la matérialité de la pratique du théâtre de société dans la première moitié du XIX e siècle Discussion et déjeuner Après-Midi Représentations de la pratique du théâtre de société (présidence: Dominique Quéro) 14h30: Jeanne-Marie Hostiou (Université de la Sorbonne-Nouvelle - Paris 3)– Les théâtres de société «mis en pièces». 15h: Ilaria Lepore (Université de Rome-La Sapienza) – Le théâtre de société à l'épreuve de la scène officielle : « Les Trois Spectacles» de Dumas D’Aigueberre à la Comédie Française. 15h30: Valérie Cossy(Université de Lausanne) – Le théâtre de société comme mise en abyme d’une performativité sociale trompeuse dans «Mansfield Park» (1814) de Jane Austen.
Théâtre de société et société(XVIII e -XIX e siècles): quelles interactions? Quels liens entretiennent le théâtre de société et la société civile? Ce colloque se propose de les explorer en interrogeant les fonctions de la pratique des théâtres de société (récréatives, didactiques, politiques, associatives, identitaires) et les enjeux des représentations croisées qui s'y relient: représentations des spectacles de société, de leurs acteurs et de leur public dans d'autres formes de spectacles ou de productions littéraires, et représentations de groupes, problèmes et thèmes sociaux dans les pièces "de société". Colloque internationalorganisé par la Section de français de l’UNIL, dans le cadre du projet FNS Théâtres de société. Entre Lumières et Second Empire (dir. Valentina Ponzetto) . Pour lire le texte de l'appel à contribution, cliquer ici. PROGRAMME Jeudi 22 novembre Matin 8h30: Accueil des participants 9h00: Introduction des organisatrices Réseaux (présidence: Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval) 9h30: Dominique Quéro (Université de Reims Champagne-Ardenne) – Pont-de-Veyle en société 10h00: Flora Mele (Université Paris-Sorbonne, CELLF 16 e -18 e ) – Justine Favart auteure et interprète: rôle d’une artiste polyvalente en «société» Discussion et pause 11h00: Jennifer Ruimi (FNS/Université de Lausanne) – Petits théâtres vs théâtre de société: définitions, enjeux, limites 11h30: Guy Spielmann (Georgetown University) – Théâtre «en » société ou «de » société? Pistes microsociologiques Discussion et déjeuner Après-Midi (présidence: François Rosset) 14h30: Béatrice Lovis (Université de Lausanne) – Autour de la Vaudoise Catherine de Sévery, «la Clairon de ce pais là» 15h00 : Paola Perazzolo (Université de Vérone) – «J’ai mis en manière de comédies moi-même, presque toutes mes idées sur les rangs de la société »: la société des comédies «engagées » d’Isabelle de Charrière (1793-1794) Discussion et pause Fonctions des théâtres de société 16h: Alain Sager (Amiens) – Théâtre et société: Suzanne Necker entre représentation et conscience de soi 16h30: Blandine Poirier (Université Paris-Diderot) – Le théâtre de société de Germaine de Staël: une forme d’engagement? 17h00: Veronika Studer-Kovacs(Université de Luzern) – Le plaisir de l’Autre. Identité hongroise au miroir d’une fête francophone des Habsbourg à Tyrnau . Vendredi 23 novembre Matin Ce que le théâtre de société dit de la société (présidence: Valérie Cossy) 9h30: Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval (Université Paris Est Créteil) – Du socialement correct au politiquement incorrect: pour une typologie de l’«application». 10h00: Paul Fièvre (BNF et FNS/Université de Lausanne) – Figures d'enfants dans le théâtre d'éducation de Genlis, Garnier et Moissy. 10h30: Valentina Ponzetto (FNS/ Université de Lausanne) – Le charme discret de la représentation de la société dans les proverbes de société. Discussion et pause 11h30: Piotr Olkusz (Université de Lodz) – Les théâtres de société et les réformes de la Pologne au XVIII e siècle 12h: Camilla Murgia (Université de Lausanne) – Passage de témoin : la matérialité de la pratique du théâtre de société dans la première moitié du XIX e siècle Discussion et déjeuner Après-Midi Représentations de la pratique du théâtre de société (présidence: Dominique Quéro) 14h30: Jeanne-Marie Hostiou (Université de la Sorbonne-Nouvelle - Paris 3)– Les théâtres de société «mis en pièces». 15h: Ilaria Lepore (Université de Rome-La Sapienza) – Le théâtre de société à l'épreuve de la scène officielle : « Les Trois Spectacles» de Dumas D’Aigueberre à la Comédie Française. 15h30: Valérie Cossy(Université de Lausanne) – Le théâtre de société comme mise en abyme d’une performativité sociale trompeuse dans «Mansfield Park» (1814) de Jane Austen.
↧
L’isomorphisme des savoirs: projections de la science dans la littérature XXe-XXIe s. (Bucarest)
Appel à communications L’isomorphisme des savoirs : p rojections de la science dans la littérature (XXème – XXIème siècles) Colloque international - Université de Bucarest (10-11 mai 2019) L’unification des savoirs (religion, philosophie, sciences) cultivée par les penseurs de l’Antiquité dans la perspective d’une révélation ou d’une contemplation de l’essence éternelle de l’univers qui aboutirait à son tour à la purification de l’âme, a souvent été symbolisée par l’image du dieu Janus bifront, dont les visages incarneraient les deux voies de la connaissance: la première étant précise et objective, la deuxième, mythologique et intuitive (Arthur Koestler, The Sleepwalkers: A history of man´s changing visión of the Universe , 1959: 21). La séparation et la spécialisation des savoirs, qui survint ultérieurement comme étant la condition indispensable au développement de la science moderne, semble avoir connu dès le début du XXème siècle un mouvement pendulaire de retour vers l’unification transversale des domaines épistémiques, redevable en grande mesure de la centralité de l’esthétique et du discursif dans la pensée contemporaine (Christine Baron, La pensée du dehors , 2007). Depuis la dernière des grandes controverses autour des transferts épistémologiques entre les humanités et les sciences, suscitée par la dénonciation des «impostures scientifiques» donnant corps, selon Alan Sokal et Jean Bricmont ( Impostures intellectuelles , 1997), aux appareils conceptuels déployés par certains représentants de la pensée poststructuraliste française, les ponts tendus depuis l’une et l’autre rive afin de rapprocher les deux champs du savoir n’ont eu de cesse de se multiplier. Tout porte à croire que le nouveau millénaire a enterré une bonne fois pour toutes ce paradigme des deux cultures qui donna lieu à tant de débats tout au long du XXème siècle, et ceci au nom d’un nouvel humanisme, voire d’une remise en question des principes mêmes de l’humanisme. De nombreux penseurs, dont Francisco Fernández Buey ( Para la tercera cultura , 2013) s’accordent ainsi à observer dans cette reconfiguration de l’ordre épistémique l’avènement d’une troisième culture , expression rendue célèbre par l’agent littéraire John Brockman à partir des postulats de C. P. Snow et qui fait état d’un réinvestissement de la notion de réel, ainsi que des moyens mis en œuvre pour l’appréhender. La théorie littéraire a joué un rôle fondamental dans cette atténuation du partage ontologique et institutionnel —autrefois incontournable— entre les domaines du savoir à partir du moment où elle a entrepris de revendiquer la spécificité de la littérature en tant que moyen de connaissance, en même temps qu’elle proclamait l’importance de celle-ci dans la configuration des processus épistémiques. Dans ce sens, la contribution de la Literaturwissenschaft , de l’herméneutique littéraire de Hans-Georg Gadamer ou de Paul Ricoeur, des théories de la fiction de Jean-Marie Schaeffer, de l’épistémologie de Jacques Bouveresse, de la poétique cognitive ou de l’épistémocritique à la mise en place de ce que Christine Baron (2009 : 9) décrit comme une «constante négociation» entre discours littéraire et discours scientifique ne saurait être discutée. De ce point de vue, l’approche épistémocritique inaugurée dans l’espace francophone par Michel Pierssens (1990) place la littérature dans un rapport de proximité et de réciprocité vis-à-vis de l’activité épistémique, et notamment —quoique pas exclusivement— de l’activité scientifique. Le champ d’étude de l’épistémocritique englobe aussi bien les formes que les structures narratives et figuratives susceptibles d’être adoptées par le discours scientifique ; dans le cas de la littérature, elle s’intéresse, entre autres, à la présence de sous-textes et d’intertextes d’ordre scientifique ou technologique dans la construction des univers de fiction. Contrairement à une idée largement répandue, l’analogie ne constitue pas le seul recours dont dispose l’écriture lorsqu’il s’agit de recodifier en termes littéraires un certain phénomène relevant du domaine scientifique. En leur qualité de dispositifs de symbolisation lingüistique, il peut certes arriver aux figures littéraires d’opérer en tant qu’agents de transfert permettant l’inscription d’un savoir dans le texte. Or, à considérer les projections littéraires de la science uniquement comme un transfert à sens unique et dans une perspective mimétique, on risquerait de passer outre la complexité et la richesse de cette interaction entre savoirs scientifiques et savoirs littéraires. Sous ce prisme, la littérature est souvent reléguée à une position subsidiaire par rapport à des phénomènes qu’elle ne pourrait qu’aspirer à appréhender par le biais de la représentation ou auxquels elle parviendrait éventuellement à attribuer un sens. Ces phénomènes ayant été préalablement appréhendés —voire même configurés— par la science, la figuration littéraire se poserait d’emblée comme une représentation seconde, ou si l’on préfère, comme une refiguration. La frontière entre le littéraire et le scientifique constitue un espace epistémologique dont l’ampleur et la porosité restent encore à explorer; un espace habité par tout un réseau de connexions et de projectionsréciproques: projection de la littérature en tant que science, projection de la littérature dans la science, projection de la science dans la littérature, projection de la science en tant que littérature. Un espace partagé dans lequel il deviendrait possible pour l’une et l’autre d’inverser leur statut et leurs limites en tant qu’observatrices d’une réalité qui les précèderait (ne demandant de ce fait qu’à être déchiffrée), et d’être enfin prises en compte en tant qu’instances signifiantes donnant forme à notre univers empirique. Les répercussions d’une partie non négligeable des considérations précédentes se manifestent souvent dans le métadiscours employé pour justifier le besoin d’un rapprochement entre les disciplines scientifiques et humanistes. Comme l’indiquent Amelia Gamoneda et Francisco González Fernández dans l’introduction au numéro récent de la revue Épistémocritique (2017) consacré au domaine hispanique, la métaphore spatiale (figurée tantôt par le pont, tantôt par la frontière, le territoire, le nœud, etc.) revient de façon récurrente dans les problématisations des rapports entre les sciences et les humanités. De son côté, González Fernández évoque dans la préface de Esperando a Gödel: Literatura y matemáticas (2011) le Pont des Arts de Paris, construction emblématique qui, force nous est de le rappeler, relie le Musée du Louvre et l’Académie des Sciences. Il reprend ainsi à son compte la conception heideggérienne de ce type de constructions en tant que vecteurs de visualisation, symbolisation, unification et transformation, autant dire de création de l’espace. Toujours dans le sillage de la phénoménologie, le philosophe espagnol José Ortega y Gasset voyait dans l’emploi de la métaphore un instrument épistémologique de tout premier ordre qui, en rapprochant la poésie de l’exploitation scientifique («Las dos grandes metáforas», 1924), est en mesure de donner le jour à un objet nouveau, imprégné de cette subjectivité issue de la conscience du moi créateur. Le développement des disciplines cognitives à partir des années 1980 a mis en évidence non seulement que ce pont reliant les deux rives s’avère le lieu d’un échange réciproque, mais également que sa fonction ne revient pas tellement à mettre en rapport deux espaces existant d’avance, mais plutôt à configurer un lieu qui, jusqu’à ce moment-là, n’existait pas en tant que tel. De sorte que le fleurissement d’un troisième domaine épistémique pourrait être conceptualisé comme la génération d’un espace intégré à partir d’une série de projections conceptuelles entre des domaines préétablis du savoir et de l’expérience (Pilar Alonso, A Multi-dimensional Approach to Discourse Coherence , 2014: 137). Les fusions conceptuelles articulant la pensée scientifique font ainsi de toute découverte scientifique un acte créateur dont l’imagination est un facteur décisif (Laurence Dahan-Gaida, “El efecto “Eureka” en la ciencia y en la literatura (siglos XIX-XXI)”, 2018). Comme l’a bien montré Mark Turner ( The Literary Mind , 1996), il serait certes réducteur de concevoir la pensée littéraire comme une modalité de pensée séparée de la pensée scientifique, étant donné que la pensée littéraire se trouve à l’origine de toute pensée. Sur le plan discursif, la poétique et la narratologie cognitives s’occupent principalement des structures narratives à l’œuvre dans le cerveau humain, autrement dit, elles visent à expliquer la façon dont les individus engendrent et restent fidèles à un certain nombre de modèles narratifs au moment d’observer et de représenter le monde empirique. L’intentionnalité du sens et l’effet produit par ces structures mentales se situent au cœur des recherches menées au cours de ces dernières années dans plusieurs domaines allant de la philosophie de l’art (James Grant, 2011) jusqu’à la neuroesthétique (David S. Miall, 2009) et la lecture incarnée (Marielle Macé, 2011; Pierre-Louis Patoine, 2015). Le colloque L’isomorphisme des savoirs: projections de la science dans la littérature (XXème-XXIème siècles) propose une approche théorique interdisciplinaire situant au premier plan les contributions récentes de l’épistémocritique et de la théorie cognitive du langage figuratif et du discours dans la perspective d’instaurer, dans un cadre hispanique et international, un dialogue entre ces deux courants théoriques. Les communications et les échanges ayant lieu au cours du colloque fourniront matière à la publication en 2020 d’un ouvrage collectif. Le comité d’organisation invite les participants à développer leurs réflexions autour des axes suivants : 1. La figuration de théories ou de découvertes scientifiques dans les textes littéraires. Science et narrativité: le discours littéraire des sciences. Les homologies structurales entre discours littéraire et discours scientifique. Le langage figuratif et la métaphore dans le discours scientifique. 2. La problématisation dans les textes littéraires de la théorie littéraire en tant que science de la littérature. La littérature en tant que moyen d’expression de la cognition et des savoirs. Littérature et neurosciences. Neuroesthétique et lecture incarnée. 3. Littérature et philosophie de la culture. Actualité des études épistémocritiques et de poétique cognitive. Conférences plénières: Christine Baron (Université de Poitiers), Pilar Alonso (Universidad de Salamanca), Amelia Gamoneda (Universidad de Salamanca), Francisco González Fernández (Universidad de Oviedo). Langues de communication: espagnol, français, anglais. Site web du colloque: https://literaturaysaberes2019.wordpress.com/ Contact et envoi des propositions: literaturaysaberes2019@gmail.com Les propositions de communication pourront être envoyées jusqu’au 31 janvier 2019 . Elles seront assorties des informations suivantes: nom de l’auteur, université ou centre de rattachement, titre de la communication, résumé (250-300 mots), 5 mots-clés et une brève notice bio-bibliographique. Le comité scientifique tiendra compte de la concordance des propositions envoyées avec les axes du colloque, de la méthodologie employée, ainsi que de l’actualité des problématiques envisagées. Réponse du comité scientifique: 15 février 2019 Frais d’inscription : Intervenants – 80 €; Doctorants – 50 € Comité scientifique Sanda Reinheimer Ripeanu (Universitatea din Bucureşti) Mianda Cioba (Universitatea din Bucureşti) Christine Baron (Université de Poitiers) Antonio Barcelona (Universidad de Córdoba) Laurence Dahan-Gaida (Université de Franche-Comté) Amelia Gamoneda (Universidad de Salamanca) Pilar Alonso (Universidad de Salamanca) Francisco González Fernández (Universidad de Oviedo) María Luisa Guerrerro Alonso (Universidad Complutense de Madrid) Esther Sánchez-Pardo (Universidad Complutense de Madrid) Vicente Luis Mora (EADE, Málaga) Mihai Iacob (Universitatea din Bucureşti) Ion Manolescu (Universitatea din Bucureşti) Anne-Cécile Guilbard (Université de Poitiers) Germán Labrador Méndez (Princeton University) Melania Stancu (Universitatea din Bucureşti) Borja Mozo Martín (Universitatea din Bucureşti) Comité d’organisation Melania Stancu Borja Mozo Martín
↧
Dans les marges du pouvoir: le roman des femmes en France entre 1900 et 1945 (33e Congrès du CIEF, Ottawa)
Appel à communications Dans les marges du pouvoir: le roman des femmes en France entre 1900 et 1945. Session du 33e Congrès du Conseil Internationaldes Études Francophones (CIEF) Ottawa du 17 au 23 juin 2019. Le principal objectif de cette session est de mettre en lumière le roman des femmes entre 1900 et 1945 en France. Mises à part Colette, Rachilde et une poignée d’autres écrivaines, des centaines de romancières de l’époque sont tombées dans l’oubli, si tant est qu’elles aient bénéficié en leur temps d’une véritable réception critique. Ces femmes ont écrit dans les marges du pouvoir institutionnel. Parfois, elles se sont mobilisées pour prendre leur place, par exemple lors la création du prix Fémina afin de protester contre l’attitude dite misogyne du prix Goncourt. Souvent leurs œuvres eurent peu d’échos ; fréquemment, elles utilisaient un pseudonyme masculin. Inutile de dire que dans l’histoire littéraire, il n’en reste guère de trace: Colette est la seule de la première moitié du 20 e siècle à être systématiquement citée. Tout ce corpus semble pourtant commencer tranquillement à émerger à la faveur de nouvelles éditions: par exemple les romans de Renée Dunan (éd. Les Moutons électriques) et de Germaine Beaumont (éd. Omnibus), ou très récemment ceux de Maria Borrély (éd. Paroles), de Simone Téry (éd. L’Harmattan) ou de Yanette Délétang-Tardif (éd. L’Arbre vengeur),etc. C’est à ce corpus oublié ou méconnu (réédité ou pas)que sera consacrée cette session, où il s’agira d’interroger les relations (d’ordre romanesque, institutionnel, générique, etc.) de la marge et du pouvoir. Cette session se tient dans le cadre du 33e Congrès du Conseil Internationaldes Études Francophones (CIEF) qui aura lieuà Ottawa du 17 au 23 juin 2019. Veuillez envoyer vos propositions de communication à François Ouellet, responsable de cette session, au plus tard le 10 octobre 2018 : francois_ouellet@uqac.ca
↧
↧
Assistant Professor of French and Francophone Studies and Arabic Studies ((Lexington, Kentucky)
The Department of Modern and Classical Languages, Literatures & Cultures at the University of Kentucky (Lexington, Kentucky, USA) invites applications for a tenure-track position as assistant professor of French and Francophone Studies and Arabic Studies to begin Fall 2019. We encourage candidates with a focus on Francophone North Africa, but candidates with other regional specializations are also encouraged to apply. The successful applicant’s tenure home will be in the Department of Modern and Classical Languages, Literatures & Cultures, a dynamic academic unit committed to interdisciplinary collaboration among faculty with diverse geographical interests, theoretical concerns, and methodological approaches. Applicants must have a PhD in hand by August 2019 in French and Francophone Studies, Near Eastern Studies, or a related field. Responsibilities of the position include pursuing an active research program in some aspect of the humanities or cultural studies broadly understood. A demonstrated record of excellence in teaching language is expected. The successful candidate will, like all department faculty members, be expected to regularly contribute to the department’s core and cross-disciplinary curriculum; the teaching load is 2/2 (typically 3 courses in French and Francophone Studies, 1 course in Arabic Studies; cross-listing is possible). Other expectations include native or near-native fluency in English, French, and Arabic. Applicants must submit the following: 1) letter of application, 2) CV, 3) research statement (upload under Specific Request 1), 4) writing sample, 5) teaching portfolio that must include a teaching statement that discusses philosophy, successes, experiments, etc., sample course syllabi, and representative teaching/course evaluations (upload under Specific Request 2), and 6) a statement on inclusivity (upload under Specific Request 3): As a department and university, we are strongly committed to creating an inclusive and effective teaching, learning, research, and working environment for all. In one to two pages, applicants should reflect on their commitments, approaches, and insights related to inclusion, diversity, and equity. Also provide the names and contact information for three references when prompted in the academic profile. This information will be utilized to solicit recommendation letters from your references within the employment system. Applications will be acknowledged. Application deadline is 19 November 2018. See on line…
↧
Espaces de collaboration dans les littératures autochtones de l’île de la Tortue/ Spaces of Collaboration in Indigenous Literatures of Turtle Island (Vancouver)
(english version below) Atelier conjoint entre l'Association des professeur.e.s de français des universités et collèges canadiens (APFUCC) et la Indigenous Literary Studies Association(ILSA) au Congrès des sciences humaines 2019, The University of British Columbia, Vancouver,1 er - 4 juin 2019 Espaces de collaboration dans les littératures autochtones de l’île de la Tortue Pour répondre au grand thème du Congrès 2019, «Cercles de conversation», se voulant une invitation au dialogue, cet atelier propose de mettre l’accent sur les possibilités offertes par la collaboration comme mode d’engagement littéraire dans le champ des littératures autochtones, autant pour les auteur·e·s que pour les critiques. L’écriture collaborative se révèle comme un vecteur important dans l’élaboration des discours anticoloniaux en circulation aujourd’hui en transformant les espaces littéraires et critiques existants et en mettant en place des espaces littéraires souverains. La collaboration est aussi un espace de tensions et de projets qui ne marchent pas. Par conséquent, nous souhaitons interroger ce qui est entendu par «cercles de conversations» pour en cerner les limites. Cet atelier invite à réfléchir au rôle des ouvrages collectifs comme les anthologies Without Reservation: Indigenous Erotica (2003), Love Beyond Body, Space, and Time: An Indigenous LGBT Sci-Fi Anthology (2016); Amun (2016) et Tracer un chemin/ Meshkanatsheu: écrits des Premiers Peuples (2017) ; les collections critiques comme A Gathering of Spirit.A Collection by North American Indian Women (1984), Reasoning Together: The Native Critics Collective (2008) et Learn, Teach, Challenge: Approaching Indigenous Literatures (2016) ; et les échanges épistolaires comme Aimititau!Parlons-nous! (2008) et Kuei! Je te salue: Conversations sur le racisme (2016). Nous considérons aussi la collaboration au sens large comme les relations qui rendent possibles les discours, les publications et les évènements. Des textes d’un.e seul.e auteur.e peuvent être collaboratif comme c’est la cas du dernier recueil de poésie de Roseanna Deerchild, Calling Down the Sky , écrit à travers une collaboration mère-fille. Réfléchir aux collaborations qui rendent possibles des créations pousse à examiner la matérialité des paroles. Quels sont les rôles de la famille, des communautés, des cercles d’auteur·e·s et d’artistes, des maisons d’édition et des programmateurs et programmatrices d’événements dans les œuvres littéraires et artistiques? Comment est-ce que les projets collaboratifs encouragent à penser avec les autres et à penser aux autres ? Quels sont les enjeux éthiques des pratiques créative et critique qui doivent être pensées en relation avec la communauté et/ou les communautés ? Dans un effort de décloisonner le champ de recherche, l’atelier «Espaces de la collaboration dans les littératures autochtones de l’Île de la Tortue » encourage les participant·e·s à considérer des œuvres autochtones en langue autochtone, en français ou en anglais. Nous encourageons fortement les communications qui réfléchissent à la position occupée par le ou la chercheur·e. Voici quelques pistes de réflexion:la traduction des langues autochtones et/ou entre les langues coloniales (L. Moyes; I. St-Amand);les déplacements entre les genres, les médiums (texte et image) et les espaces culturels;analyses comparatives des contextes francophones et anglophones au Canada;la collaboration entre les disciplines (les liens avec le féminisme, les études queer , l’afrofuturisme, l’écopolitique);les genres collaboratifs: les anthologies, les échanges épistolaires, le théâtre, le cinéma et autres créations à plusieurs mains;l’histoire de la critique littéraire autochtone et méthodologie de recherche (D.Reder ; S. McKegney);perspectives historiques sur la collaboration et les récits de vie co-écrits (S. McCall);tensions éditoriales (par exemple dans les écrits de M. Campbell, M. Aodla Freeman, L. Maracle);la recherche collaborative, les événements littéraires et militants, les rencontres entre les communautés autochtones et l’université;protocoles de recherche et recherche collaborative en études littéraires: les pratiques de«coconstruction» et du «double regard»(Protocole de Recherche des Premières Nations au Québec et au Labrador, 2014). Responsables de l’atelier: Élise Couture-Grondin,University of Toronto elise.couture.grondin@mail.utoronto.ca Isabella Huberman,University of Toronto isabella.huberman@mail.utoronto.ca Date limite pour l’envoi des propositions (250-300 mots) : le 5 janvier 2019. Les communications peuvent être présentées en français, en anglais ou les deux. Les personnes ayant soumis une proposition de communication recevront un message des organisateurs de l’atelier avant le 20 janvier 2019 les informant de leur décision. L’adhésion à l’APFUCCou à ILSAest requise pour participer à cet atelier. Il est également d’usage de régler les frais de participation au Congrès des Sciences humaines ainsi que les frais de conférence de l’APFUCCou de ILSA. Ils doivent être réglés avant le 31 mars 2019 pour bénéficier des tarifs préférentiels. La date limite pour régler les frais de conférence et l’adhésion est le 15 avril 2019 .Passé cette date, le titre de votre communication sera retiré du programme de l’APFUCC. Vous ne pouvez soumettre qu’une seule proposition de communication pour le colloque de 2019. Toutes les communications doivent être présentées en personne, même dans le cas d’une collaboration. * Spaces of Collaboration in Indigenous Literatures of Turtle Island In response to Congress 2019’s theme, “Circles of Conversation,” which proposes to “open up spaces for dialogue, debate and dissent,” this panel seeks to question the possibilities offered by collaboration as a mode of literary engagement in the field of Indigenous literatures, for both writers and researchers. Collaborative writing plays an important role in the production of anticolonial discourses in circulation today: it transforms existing literary and critical spaces and establishes sovereign literary spaces. Yet collaborations are also places of tensions and yield conflicting projects. Thus, we are asking what, in fact, is understood by “Circles of Conversation,” and wish to consider its limitations. This panel aims to explore the role of collective works like creative anthologies such as Without Reservation: Indigenous Erotica (2003), Love Beyond Body, Space, and Time: An Indigenous LGBT Sci-Fi Anthology (2016); Amun (2016) and Tracer un chemin: Meshkanatsheu: écrits des Premiers Peuples (2017); critical anthologies such as A Gathering of Spirit: A Collection by North American Indian Women (1983), Reasoning Together: The Native Critics Collective (2008) and Learn, Teach, Challenge: Approaching Indigenous Literatures (2016); as well as epistolary exchanges such as Aimititau! Parlons-nous! (2008) and Kuei! Je te salue: Conversations sur le racisme (2016). We will also consider collaboration more broadly, referring to the relationships that make talks, publications and events possible. Works by a single author can be collaborative, such as Roseanna Deerchild’s Calling Down the Sky, which is the result of a mother-daughter collaboration. In thinking about the multifaceted collaborations that make creative work possible, we are forced to consider the materiality of expression. What are the roles played by family, community, authors’ and artists’ circles, publishing houses and event programmers in literary and artistic productions? How do collaborative projects encourage one to think with others as well as think about others? What are the ethical considerations for creative and critical practices that must be undertaken in relation to communities? In an attempt to break down barriers in Indigenous literary studies, this panel encourages participants to consider Indigenous works in an Indigenous language, in French or in English. We strongly encourage presenters to reflect on their own subject position in their papers. Severalpossible topics include:the translation of Indigenous languages and/or between colonial languages (L. Moyes; I. St-Amand);shifts between genres, mediums (text and image) and cultural spaces;comparative analyses of the Francophone and Anglophone contexts in Canada;collaboration among disciplines (feminism, queer studies, afrofuturism, ecopolitics, etc.);collaborative genres: anthologies, epistolary exchanges, theatre, cinema and other creations done alongside others;the history of Indigenous literary studies and research methodologies (D. Reder; S. McKegney);historical perspectives on collaboration and “as-told-to” narratives (S. McCall);editorial tensions (for example in the work of M. Campbell, M. Aodla Freeman, L. Maracle);collaborative research, literary and activist events, encounters between Indigenous communities and the academy;research protocols and collaborative research in literary studies: “co-building” and “two-eyed seeing” (First Nations in Quebec and Labrador’s Research Protocol, 2014). Organizers: Élise Couture-Grondin,University of Toronto elise.couture.grondin@mail.utoronto.ca Isabella Huberman,University of Toronto isabella.huberman@mail.utoronto.ca The deadline to submit an abstract (250-300 words) is January 5 th , 2019. Papers can be presented in French, in English or in both languages. Those who submit an abstract will receive a notification from the panel organizers regarding their decision before January 20 th , 2019. If you wish to present at this panel, you must have registered as a member of either ILSA or APFUCC. Participants must also pay the SSHRC Congress registration fee. Please note that APFCUC offers reduced rates on the membership and conference fees until March 31 st , 2019. In order to appear in the program of APFUCC, participants must pay all fees by April 15 th , 2019. You can only submit one paper proposal for Congress 2019. All papers must be presented in person, even in the case of collaborations.
↧
J. Brown,B. Lipton, M. Morisy (éd.), Writers Under Surveillance. The FBI Files
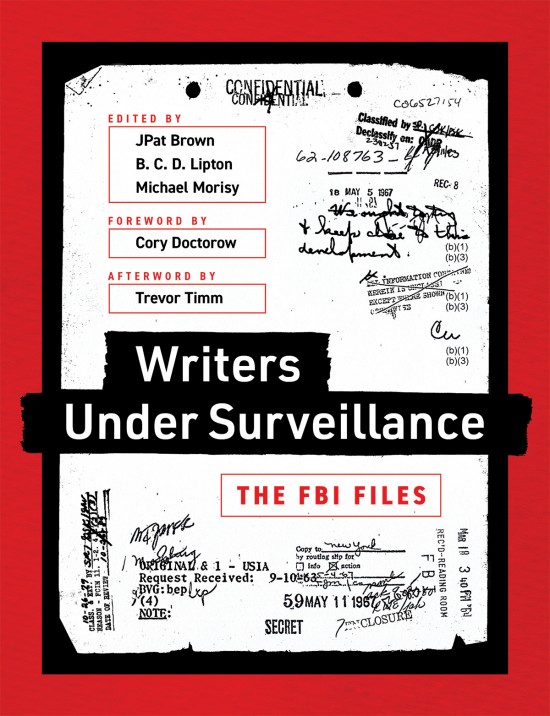 Writers Under Surveillance. The FBI Files Edited by JPat Brown , B. C. D. Lipton and Michael Morisy Foreword by Cory Doctorow Afterword by Trevor Timm MIT Press, Cambridge $24.95 ISBN:9780262536387 400p. PRESENTATION FBI files on writers with dangerous ideas, including Hannah Arendt, Allen Ginsberg, Ernest Hemingway, Susan Sontag, and James Baldwin. Writers are dangerous. They have ideas. The proclivity of writers for ideas drove the FBI to investigate many of them—to watch them, follow them, start files on them. Writers under Surveillance gathers some of these files, giving readers a surveillance-state perspective on writers including Hannah Arendt, Allen Ginsberg, Ernest Hemingway, Susan Sontag, and Hunter S. Thompson. Obtained with Freedom of Information Act requests by MuckRock, a nonprofit dedicated to freeing American history from the locked filing cabinets of government agencies, the files on these authors are surprisingly wide ranging; the investigations were as broad and varied as the authors' own works. James Baldwin, for example, was so openly antagonistic to the state's security apparatus that investigators followed his every move. Ray Bradbury, on the other hand, was likely unaware that the Bureau had any interest in his work. (Bradbury was a target because an informant warned that science fiction was a Soviet plot to weaken American resolve.) Ernest Hemingway, true to form, drunkenly called the FBI Nazis and sissies. The files have been edited for length and clarity, but beyond that everything in the book is pulled directly from investigatory files. Some investigations lasted for years, others just a few days. Some are thrilling narratives. Others never really go anywhere. Some are funny, others quite harrowing. Despite the federal government's periodic admission of past wrongdoing, investigations like these will probably continue to happen. Like all that seems best forgotten, the Bureau's investigation of writers should be remembered. We owe it to ourselves. WritersHannah Arendt, James Baldwin, Ray Bradbury, Truman Capote, Tom Clancy, W. E. B. Du Bois, Allen Ginsberg, Ernest Hemingway, Aldous Huxley, Ken Kesey, Norman Mailer, Ayn Rand, Susan Sontag, Terry Southern, Hunter S. Thompson, Gore Vidal REVIEWS …in Writers Under Surveillance: The FBI Files , we get a look at some of the facts and hearsay that was gathered on 16 prominent authors. It's a fascinating and at times hilarious book. You could argue that it's an important one, too. - Daily Beast The only surprise missing from this important book is that the FBI failed to investigate Santa Claus for wearing red. Read this book and be overwhelmed by the FBI's invasion of our lives. - Leslie H. Gelb, President Emeritus of the Council on Foreign Relations Writers Under Surveillance is a reminder that ideas are the foundation of power and that it is often those who influence the ideas of others that the government attempts to watch, harass, or silence. It is an indispensable collection showing us, page by page, that freedom is fragile. - DeRay Mckesson, host, Pod Save the People; and cofounder, Campaign Zero The leaks, lies, and ill-gotten confessions documented inWriters Under Surveillancedouble as a lively and revealing alternative history of twentieth-century U.S. literature. The collection proves that the national security state chased and anthologized the cutting edge of American writing all the way from Ernest Hemingway to Susan Sontag, modernism to postmodernism, libertarianism to communism, and back again. - William J. Maxwell, Professor of English, Washington University in St. Louis, author of F.B. Eyes: How J. Edgar Hoover's Ghostreaders Framed African American Literature, and editor of James Baldwin: The FBI File.
Writers Under Surveillance. The FBI Files Edited by JPat Brown , B. C. D. Lipton and Michael Morisy Foreword by Cory Doctorow Afterword by Trevor Timm MIT Press, Cambridge $24.95 ISBN:9780262536387 400p. PRESENTATION FBI files on writers with dangerous ideas, including Hannah Arendt, Allen Ginsberg, Ernest Hemingway, Susan Sontag, and James Baldwin. Writers are dangerous. They have ideas. The proclivity of writers for ideas drove the FBI to investigate many of them—to watch them, follow them, start files on them. Writers under Surveillance gathers some of these files, giving readers a surveillance-state perspective on writers including Hannah Arendt, Allen Ginsberg, Ernest Hemingway, Susan Sontag, and Hunter S. Thompson. Obtained with Freedom of Information Act requests by MuckRock, a nonprofit dedicated to freeing American history from the locked filing cabinets of government agencies, the files on these authors are surprisingly wide ranging; the investigations were as broad and varied as the authors' own works. James Baldwin, for example, was so openly antagonistic to the state's security apparatus that investigators followed his every move. Ray Bradbury, on the other hand, was likely unaware that the Bureau had any interest in his work. (Bradbury was a target because an informant warned that science fiction was a Soviet plot to weaken American resolve.) Ernest Hemingway, true to form, drunkenly called the FBI Nazis and sissies. The files have been edited for length and clarity, but beyond that everything in the book is pulled directly from investigatory files. Some investigations lasted for years, others just a few days. Some are thrilling narratives. Others never really go anywhere. Some are funny, others quite harrowing. Despite the federal government's periodic admission of past wrongdoing, investigations like these will probably continue to happen. Like all that seems best forgotten, the Bureau's investigation of writers should be remembered. We owe it to ourselves. WritersHannah Arendt, James Baldwin, Ray Bradbury, Truman Capote, Tom Clancy, W. E. B. Du Bois, Allen Ginsberg, Ernest Hemingway, Aldous Huxley, Ken Kesey, Norman Mailer, Ayn Rand, Susan Sontag, Terry Southern, Hunter S. Thompson, Gore Vidal REVIEWS …in Writers Under Surveillance: The FBI Files , we get a look at some of the facts and hearsay that was gathered on 16 prominent authors. It's a fascinating and at times hilarious book. You could argue that it's an important one, too. - Daily Beast The only surprise missing from this important book is that the FBI failed to investigate Santa Claus for wearing red. Read this book and be overwhelmed by the FBI's invasion of our lives. - Leslie H. Gelb, President Emeritus of the Council on Foreign Relations Writers Under Surveillance is a reminder that ideas are the foundation of power and that it is often those who influence the ideas of others that the government attempts to watch, harass, or silence. It is an indispensable collection showing us, page by page, that freedom is fragile. - DeRay Mckesson, host, Pod Save the People; and cofounder, Campaign Zero The leaks, lies, and ill-gotten confessions documented inWriters Under Surveillancedouble as a lively and revealing alternative history of twentieth-century U.S. literature. The collection proves that the national security state chased and anthologized the cutting edge of American writing all the way from Ernest Hemingway to Susan Sontag, modernism to postmodernism, libertarianism to communism, and back again. - William J. Maxwell, Professor of English, Washington University in St. Louis, author of F.B. Eyes: How J. Edgar Hoover's Ghostreaders Framed African American Literature, and editor of James Baldwin: The FBI File.
↧
D. Jernigan,W. Wadiak,M. Wang, Narrating Death. The Limit of Literature
 Narrating Death. The Limit of Literature Edited byDaniel K. Jernigan,Walter Wadiak,Michelle Wang Routledge ISBN : 9781138360365 212 p. 115 £ PRESENTATION Drawing on literary and visual texts spanning from the twelfth century to the present, this volume of essays explores what happens when narratives try to push the boundaries of what can be said about death. TABLE OF CONTENTS Introduction, DANIEL K. JERNIGAN PART I : The Uncrossable Border 1 Photography and First-Person Death: Derrida, Barthes, Poe, KEVIN RIORDAN 2 "This memoryall men may have in mynd": Everyman and the Work of Mourning, WALTER WADIAK 3 From Nothing to Never? Facing Death in King Lear , MICHAEL NEILL 4 "Is there no danger in counterfeiting death?": Molière’s The Imaginary Invalid, DANIEL K. JERNIGAN PART II : Trajectories 5 "She is the God of Calvin, she sees the beginning and the end": Narrating Life and Death in the Fiction of Muriel Spark, JOSEPH H. O’MEALY 6 Talking to the Dead: Narrative Closure and the Political Unconscious in Neil Jordan’s Fiction, KEITH HOPPER 7 Samuel Johnson and the Grammar of Death, LAURA DAVIES 8 Death and Romance in Sir Orfeo , ELIZABETH ALLEN PART III : Aesthetic Crossings 9 Death and the Maidens: John Banville’s Ekphrastic Storyworlds, NEIL MURPHY 10 Blood Meridian , the Sublime, and Aesthetic Narrativizations of Death, W. MICHELLE WANG 11 Murder Amidst the Chocolates: Martin McDonagh’s Multifaceted Uses of Death in In Bruges , WILLIAM C. BOLES 12 The Ruined Voice in Tom Murphy’s Bailegangaire, CHERYL JULIA LEE Index REVIEWS "The editors offer a valuable, singular study probing strategies for negotiating the unknowable passage from life to death as depicted in a diverse range of international literary classics. Emphasizing aesthetic devices and philosophical underpinings used by authors of each literary classic chosen, the conception of death as a passage exposes the limits and transformative qualities of death, that ‘uncrossable border.’ This is a major study certain to inspire scholars to pursue further examinations of this most universal of journeys." -- James Fisher, The University of North Carolina at Greensboro EDITORS Daniel K. Jernigan is Associate Professor of English Literature at Nanyang Technological University (NTU), Singapore. He has written extensively on Tom Stoppard, including his monograph, Tom Stoppard: Bucking the Postmodern (2013). He also edited Flann O’Brien: Plays and Teleplays (2013), and Aidan Higgins’s collection of radio plays, Darkling Plain: Texts for the Air (2010). Walter Wadiak is Assistant Professor of English at Lafayette College. He specializes in Middle English literature and has written for Exemplaria , Philological Quarterly , and Glossator . His book, Savage Economy: The Returns of Middle English Romance (Notre Dame, 2016), examines the afterlives of chivalric culture in late-medieval English romances. W. Michelle Wang is Assistant Professor at Nanyang Technological University’s School of Humanities, English. She received her Ph.D from The Ohio State University, specializing in postmodern and contemporary fiction. She has published articles in the journal Narrative , Review of Contemporary Fiction , and Journal of Narrative Theory .
Narrating Death. The Limit of Literature Edited byDaniel K. Jernigan,Walter Wadiak,Michelle Wang Routledge ISBN : 9781138360365 212 p. 115 £ PRESENTATION Drawing on literary and visual texts spanning from the twelfth century to the present, this volume of essays explores what happens when narratives try to push the boundaries of what can be said about death. TABLE OF CONTENTS Introduction, DANIEL K. JERNIGAN PART I : The Uncrossable Border 1 Photography and First-Person Death: Derrida, Barthes, Poe, KEVIN RIORDAN 2 "This memoryall men may have in mynd": Everyman and the Work of Mourning, WALTER WADIAK 3 From Nothing to Never? Facing Death in King Lear , MICHAEL NEILL 4 "Is there no danger in counterfeiting death?": Molière’s The Imaginary Invalid, DANIEL K. JERNIGAN PART II : Trajectories 5 "She is the God of Calvin, she sees the beginning and the end": Narrating Life and Death in the Fiction of Muriel Spark, JOSEPH H. O’MEALY 6 Talking to the Dead: Narrative Closure and the Political Unconscious in Neil Jordan’s Fiction, KEITH HOPPER 7 Samuel Johnson and the Grammar of Death, LAURA DAVIES 8 Death and Romance in Sir Orfeo , ELIZABETH ALLEN PART III : Aesthetic Crossings 9 Death and the Maidens: John Banville’s Ekphrastic Storyworlds, NEIL MURPHY 10 Blood Meridian , the Sublime, and Aesthetic Narrativizations of Death, W. MICHELLE WANG 11 Murder Amidst the Chocolates: Martin McDonagh’s Multifaceted Uses of Death in In Bruges , WILLIAM C. BOLES 12 The Ruined Voice in Tom Murphy’s Bailegangaire, CHERYL JULIA LEE Index REVIEWS "The editors offer a valuable, singular study probing strategies for negotiating the unknowable passage from life to death as depicted in a diverse range of international literary classics. Emphasizing aesthetic devices and philosophical underpinings used by authors of each literary classic chosen, the conception of death as a passage exposes the limits and transformative qualities of death, that ‘uncrossable border.’ This is a major study certain to inspire scholars to pursue further examinations of this most universal of journeys." -- James Fisher, The University of North Carolina at Greensboro EDITORS Daniel K. Jernigan is Associate Professor of English Literature at Nanyang Technological University (NTU), Singapore. He has written extensively on Tom Stoppard, including his monograph, Tom Stoppard: Bucking the Postmodern (2013). He also edited Flann O’Brien: Plays and Teleplays (2013), and Aidan Higgins’s collection of radio plays, Darkling Plain: Texts for the Air (2010). Walter Wadiak is Assistant Professor of English at Lafayette College. He specializes in Middle English literature and has written for Exemplaria , Philological Quarterly , and Glossator . His book, Savage Economy: The Returns of Middle English Romance (Notre Dame, 2016), examines the afterlives of chivalric culture in late-medieval English romances. W. Michelle Wang is Assistant Professor at Nanyang Technological University’s School of Humanities, English. She received her Ph.D from The Ohio State University, specializing in postmodern and contemporary fiction. She has published articles in the journal Narrative , Review of Contemporary Fiction , and Journal of Narrative Theory .
↧
↧
Colloque : "Federal Theatre Project, 1935-1939 : contexte & enjeux" (Toulouse)
Federal Theatre Project (1935-39): contexte & enjeux 17-18 -19 octobre 2019, Toulouse (France) Histoire des Arts et des Représentations (HAR, EA 4414, Paris Nanterre), Cultures Anglo-Saxonnes (CAS, EA 820, Toulouse Jean Jaurès) Partenaires: *CPRS, Université Toulouse Jean Jaurès *INU Champollion *Dickinson College, Toulouse *American Theatre and Drama Society *International Susan Glaspell Society PRESENTATION Le Federal Theatre Project (FTP) constitue une aventure singulière dans l’histoire du théâtre américain, inédite à l’époque et jamais réitérée sous cette forme. Dirigé pendant ses quatre années d’existence, de 1935 à 1939, par l’auteure, dramaturge et metteure en scène Hallie Flanagan, il s’inscrit dans l’ensemble des mesures mises en place par l’administration Roosevelt dans le cadre du programme du New Deal , et plus particulièrement au sein de la Work Progress Administration (WPA) dirigée par Harry Hopkins. Sur le plan économique et social, la crise de 1929 a durement touché les secteurs de la création artistique et nombre d’acteurs se retrouvent sans emploi. La crise que traverse la société américaine est telle qu’en 1932, plusieurs écrivains s’associent pour soutenir le ticket communiste aux élections nationales, incarné par les candidats William Z. Foster et James W. Ford, et ce malgré la méfiance du gouvernement américain à l’égard du communisme, dont pâtira également le projet de Théâtre Fédéral. Dans ce cadre, ce groupe de plus de cinquante écrivains rédige un pamphlet intitulé Culture and the Crisis, sous la forme d’une lettre ouverte, qui fait état des dysfonctionnements culturels et sociaux, qui appelle à des renouvellements profonds, et reste comme un marqueur des tensions de la société américaine de l’époque [1] . La toute première phrase de la préface de cette lettre est exemplaire de la charnière culturelle incarnée par le début des années 1930 pour toute une génération : Notre génération se tient à la croisée de deux ères. Lorsque nous regardons en arrière, nous voyons le passé de l’Amérique, le nôtre, comme un raz-de-marée qui maintenant se retire, mais qui fut réellement grandiose pour son balayage d’un pouvoir sans fondement social. Lorsque l’on regarde vers l’avenir, nous voyons quelque chose de nouveau et d’étrange, que la philosophie américaine n’a pas encore rêvé. Ce que nous voyons, c’est la menace d’une dissolution culturelle. La grande marée a laissé trop de débris – des débris naturels, des institutions et des schémas sociaux obsolètes, des restes de sang et de nerfs humains [2] . À l’orée des années 1930, l’Amérique fait face à des «débris», et le projet de théâtre fédéral mis en place par l’administration Roosevelt doit avant tout se penser dans la perspective d’une reconstruction d’un tissu social et culturel défait. C’est ainsi paradoxalement l’élection du candidat démocrate auquel les écrivains communistes s’opposent dans ce texte, qui permet l’expérimentation de formes culturelles soutenues et initiées par le pouvoir fédéral. Entre la crise de 1929 et le traumatisme de Pearl Harbour en 1941, l’État Fédéral américain trouve ainsi les ressources pour penser et mettre en pratique une séquence théâtrale inédite, où il s’agit à plusieurs égards de faire aboutir les réflexions et expérimentations théâtrales des années 1920, et qui constitue un laboratoire où esquisser les renouvellements qui s’opèrent après la Seconde guerre mondiale. En cela, le FTP est bien à l’image de cette génération de l’entre-deux-temps décrite par les écrivains de 1932. C’est aussi ce que signale Malcolm Goldstein, en faisant de la fin de la saison 1934-1935 et du début de la saison 1935-1936 un moment-charnière dans la structuration du champ théâtral américain [3] . C’est précisément à ce moment-là que germe le projet du Théâtre Fédéral [4] . Ce colloque international vise à remettre en lumière un épisode fondamental, pourtant largement passé sous silence, de l’histoire théâtrale et culturelle américaine. Volontiers ouvert aux spécialistes issu.e.s des études théâtrales, cet appel s’adresse également aux historiens, sociologues, artistes dans la perspective d’un événement marqué par les approches transdisciplinaires. THÈMES ENVISAGÉS Les pistes de réflexion suivantes sont données à titre indicatif. 1. Axes socio-politiques et culturels :Contexte social, politique et économique du New Deal et de la WPA . Le FTP constitue l’un des cinq projets liés aux arts mis en place dans le cadre du New Deal par l’administration Roosevelt, avec le Federal Writers Project consacré aux écrivains, le Federal Arts Project dédié aux arts plastiques, le Federal Music Project, qui interagit fortement avec le FTP puisque les orchestres financés jouent très fréquemment dans les pièces mises en scène dans le cadre du FTP, et le Federal Dance Project. Tous ces projets se mettent en place sous les auspices de la Work Progress Administration (WPA), créée en mai 1935, et dirigée par Arthur Hopkins de 1935 à 1938. On pourra ainsi envisager les liens entre ces différents projets, leur inscription dans la politique de Roosevelt, et analyser leur efficacité par rapport aux ambitions de départ.Conditions de production . Plusieurs communications pourront s'arrêter sur les conditions de production des spectacles du FTP, en proposant des approches différenciées rendant compte des variables d'une région à l'autre, d'un metteur en scène à l'autre, d'une période à l'autre du FTP.Approche spatiale : les différentes antennes régionales, les questions des "lieux" et "non-lieux" dereprésentation, les tournées de spectacle, la "caravan unit" et l'idée d'un théâtre itinérant, ...Approche économique : question de la gratuité, investissement de l’État Fédéral, manque éventuel de subvention, ...Enjeux de la question du communisme, dans le contexte politique américain de l'époque . Cette question pourra à elle seule susciter plusieurs communications, qu'elle soit entendue au prisme de la personnalité et du parcours politique et artistique d'Hallie Flanagan (et du procès qui lui a été intenté à l'égard de ses positions supposément communistes), ou étudiée à travers ses aspects pratiques et artistiques. Une communication revenant sur les accusations de censure envers le gouvernement et faisant le point sur sur cette question serait bienvenue.Communauté et identité américaines . La structuration du FTP en différentes unités invite à questionner le caractère "fédéral" du project, sa nature supposément "nationale" et son ambition de construire un théâtre populaire spécifiquement américain. Chacune de ces unités pourra susciter des communications précises (Théâtre yiddish, théâtre afro-américain…), et/ou questionner de manière transversale les ambiguïtés entre théâtre fédéral, théâtre national, et théâtre communautaire, en confrontant les volontés affichées et les réalités historiques 2. Axes esthétiques: Dans cette deuxième perspective, il s’agira de se demander, grâce à différentes études de cas, si l’on peut identifier une esthétique d’ensemble du Federal Theatre Project. Les communications devront ainsi mettre en valeur les caractéristiques esthétiques des spectacles étudiés, mais surtout comment ces caractéristiques sont ou non induites par le cadre du FTP. La consultation des archives du FTP et l'étude de spectacles précis sera ainsi favorisée.Approche monographique de certains spectacles phares : The Cradle Will Rock, Macbeth, One-Third of a Nation, It Can't Happen Here, par exemple.Etude de figures clés : Hallie Flanagan évidemment mais aussi Orson Welles ou John Houseman par exemple.Approche littéraire . La recherche de nouveaux auteurs américains était également une ambition revendiquée par le FTP : le projet a-t-il atteint son but ? Quelles pièces peut-on identifier comme des pièces du FTP ? Le FTP a-t-il fait émerger une écriture dramatique spécifiquement américaine ?Approche biographique sur Hallie Flanagan . Souvent qualifiée par les critiques d'idéaliste pragmatique, elle a souvent parlé de sa conception du théâtre, qu'il conviendrait d'expliciter et d'analyser au cours d'une communication. Son parcours, son enseignement à Vassar College, son rôle dans le FTP, ses voyages en Europe , son texte-témoignage sur le FTP ( Arena) pourront également constituer des pistes d'étude.Approche interdisciplinaire (liens avec le cinéma) : certaines figures essentielles du cinéma américain semblent avoir fait leurs armes au théâtre, dans le cadre du FTP, on pourra envisager les influences de l'époque du FTP sur les productions cinématographiques ultérieures, à partir de cas précis. 3. Axe historiographique et épistémologique Dans ce troisième axe, il s'agira de mettre en lumière les questions posées par les archives du FTP, par l'histoire de leur formation, et par leur traitement scientifique aujourd'hui. Le FTP, malgré une relative méconnaissance en France et en Europe, est en effet assez bien documenté par les études anglo-saxonnes, même si certains s’attachent à déplorer la sous-représentation de cette séquence théâtrale par rapport à son importance. Nombre de sources primaires sont toutefois accessibles et classées. Les archives nationales, via la bibliothèque du Congrès, comprennent un fonds consacré au FTP, dont une grande partie est disponible en ligne [5] , et les archives Hallie Flanagan du Vassar College de Poughkeepsie [6] , associé aux fonds Hallie Flanagan de la New York Public Library for the Performing Arts et du Smith College où elle a également enseigné, constituent une matière extrêmement riche. Par-delà l'état des archives sur le FTP et sur Hallie Flanagan, et leur exploration, ce colloque vise aussi à en questionner la constitution et les éventuels manquements, au regard de la nature parfois conflictuel du FTP. Y a-t-il eu une forme de censure gouvernementale ? Si oui, dans quelle mesure ? Y a-t-il des documents disparus ? 4. Prolongements Les héritagesimmédiats et à long terme ?Héritages immédiats Des personnalitésmajeures ont été 'révélées" par leFTP, comme Orson Welles ou Arthur Miller. On pourra discuter ce constat, remettre en perspective le rôle effectif du FTP, et tenter d'identifier ses traces dans la suite de ces parcours individuels.Héritages à long terme * AuxUSA :Que reste-t-il duFTP ?Quelles traces cette expérience éphémère de théâtre fédéral subventionné a-t-elle laissées dans la culture américaine, dans les formes théâtrales contemporaines, dans les politiques culturelles au sens large ? * EnEurope : peut-on identifier des influences directes du FTP dans les années qui ont suivi le projet, ou étudier d'autres aventures théâtrales qui pourraient entrer en écho avec lui ?Échos àl'internationale? En quoi le FTP est-il comparable aux entreprises de reconstructions nationales par la culture (en se basant sur des exemples d'entreprises plus particulièrement théâtrales) telles qu'elles ont été pensées dans d'autrespays ? On peut penser aux tentatives de reconstruire l'économie et l'unité nationale aprèsla Seconde guerre mondiale en France (et, ensuite, à la figure de Jeanne Laurent), mais aussi aux ambitions culturelles du Front Populaire qui sont presque exactement concomitantes avec celles du FTP… Quelles sont les passerelles internationales pouvant être construites avec le projet du Théâtre Fédéral ? Les propositions portant sur le Federal Theatre Project seront privilégiées mais nous pourrons accueillir quelques communications sur les autres projets artistiques de la WPA, dans la mesure où celles-ci viendraient éclairer le contexte du FTP. BIBLIOGRAPHIE AARON Daniel, Writers on the Left : Episodes in American Literary Communism , New York, Columbia University Press, 1992 [1961]. ARTAUD Denise, Le New Deal , Paris, Armand Colin, 1969. BENTLEY Joanne, Hallie Flanagan: a Life in the American Theatre , New York, Alfred A. Knopf, 1988. BIGSBY C.W.E. et WILMETH Don. B., The Cambridge History of American Theatre, vol. II, 1870-1945, Cambridge, Cambridhe University Press, 1999. COLLECTIF, The Federal Theatre Project. A Catalog-Calendar of Productions (coll.) , Westport, Greenwood Press, 1986 (introduction de Lorraine A. Brown). COSGROVE Stuart, The Living Newspaper : History, Production and Form , Hull, University of Hull, 1982. CRAIG Quitta E., Black Drama of the Federal Theatre Era, Amherst, MA, Amherst University Press, 1980. ENGLE Ron et MILLER Tice L., The American Stage, Cambridge, Cambridge University Press, 1993. FRADEN Rena, Blueprints for a Black Federal Theatre, Cambridge, Cambridge University Press, 1994. FRIED A. (dir.), Communism in America : A History in Documents , New York, Columbia University Press, 1997. KEMPF Jean, Histoire culturelle des États-Unis, Paris, Armand Colin, 2015. KOURILSKY Françoise, Le Théâtre aux États-Unis, Waterloo, Renaissance du Livre, 1967. LEVINE Ira Alan, Left-wing Dramatic Theory in the American Theatre , An Arbor, Umi Research Press, 1985 [1947]. MACGOWAN Kenneth, Footlights Across America : Towards a National Theatre, New York, Harcourt, Brace and Co., 1929. MATHEWS DE HART Jane, Federal Theatre, 1935-39: Plays, Relief and Politics, Princeton University Press, 1967. O’CONNOR J. et BROWN Lorraine A. (dir.), Free, Adult, Uncensored : the Living History Of the Federal Theatre Project , New York, New Republic Books, 1978. OSBORNE Elizabeth A., Staging the People : Community and Identity in the Federal Theatre Project, New York, Palgrave Macmillan, 2011 PASQUIER Marie-Claire, Le Théâtre américain d’aujourd’hui, Paris, Presses Universitaires de France, 1978. QUINN Susan, Furious iImprovisation : How the WPA and a Cast Of Thousands Made High Art Out Of Desperate Times, New York, Walker and company, 2008. REINELT Janelle G. et ROACH Joseph R., Critical Theory and Performance , University of Michigan Press, 2007 [1992]. WITHAM Barry, The Federal Theatre Project : A Case Study , Cambridge, Cambridge University Press, 2003. WITHAM Barry, chapitre 19 consacré au FTP dans Jeffrey H. Richards et Heather S. Nathans, The Oxford Handbook on American Drama, New York Oxford University Press, 2014, pp. 295-306. WHITMAN Wilson, Bread and Circuses : A sStudy of Federal Theatre, New York, Oxford University Press, 1937. PROPOSITIONS Les propositions devront être envoyées au plus tard le 25 janvier 2019 à Émeline Jouve ( emeline.jouve@gmail.com ) et Géraldine Prévot ( geraldine.prevot@gmail.com ).Elles comprendront: a) un résumé (4 000 caractères maximum); b) une notice biographique . Langues officielles : français et anglais. Le colloque sera accompagné d’événements artistiques. Comité scientifique : Zachary Bacqué (Université Toulouse Jean-Jaurès), John Bak (Université de Lorraine), Christian Biet (Université Paris Nanterre), Marguerite Chabrol (Université Paris 8), Françoise Coste (Université Toulouse Jean-Jaurès), Émeline Jouve (Université Toulouse Jean-Jaurès et Institut Champollion, Albi), Sophie Maruejouls (Université Toulouse Jean-Jaurès), Géraldine Prévot (Université Paris Nanterre), Matthew Roudané (Georgia State University), Annette J. Saddik (City University of New York) Comité d’organisation : Émeline Jouve, Géraldine Prévot ************* International trans-disciplinary conference : " Federal Theatre Project (1935-39): context & issues" 17th-18th – 19th October 2019, Toulouse (France) History of Arts and Performance (HAR, EA 4414, Paris Nanterre), Anglo-saxon Cultures (CAS, EA 820, Toulouse Jean Jaurès) Sponsors: *CPRS, Université Toulouse Jean Jaurès *INU Champollion *Dickinson College, Toulouse *American Theatre and Drama Society *International Susan Glaspell Society PRESENTATION The Federal Theatre Project (FTP) represented an outstanding adventure in the history of American theatre, totally innovative in its time and never to be repeated in quite the same way. Directed for its four years of existence, from 1935 to 1939, by the author, playwright and stage director Hallie Flanagan, it formed part of the measures set up by the Roosevelt administration in the wider framework of the New Deal, and more specifically that of the Work Progress Administration (WPA) directed by Harry Hopkins. On the socio-economic level, the crash of 1929 severely affected the world of artistic creation and many actors found themselves without work. The crisis affecting American Society was such that in 1932, several writers got together to support communist candidates William Z. Foster and James W. Ford in the national elections, despite American government opposition to communism, of which the Federal Theatre Project was also a victim. It was in this context that a group of more than 50 writers brought out a pamphlet in the form of an open letter entitled Culture and the Crisis, which enumerated the cultural and social failings, and called for in-depth reforms; it stands out as an emblem of the tensions in American society at the time [7] . The very first sentence of the preface to the letter exemplifies the cultural turning point that was the early 1930s for a whole generation: We of this generation stand midway between two eras. When we look backward, we see our American past like a great tidal wave that is now receding, but that was magnificent indeed in the sweep of its socially purposeless power. When we look ahead, we see something new and strange, undreamed of in the American philosophy. What we see ahead is the threat of cultural dissolution. The great wave piled up too much wreckage – of nature, of obsolete social patterns and institutions, of human blood and nerve. [8] At the beginning of the 1930s, with America confronting this “wreckage”, the Federal Theatre Project set up by the Roosevelt administration had to think through its project in the context of a disintegrating social and cultural fabric. This is how, paradoxically, the election of a Democratic candidate whom the communist writers opposed in this text, allowed them to experiment with these new cultural forms initiated and supported by the federal government. Between the 1929 crisis and the Pearl Harbour trauma of 1941, the US Federal government found the resources needed to devise and set up an innovative theatrical strategy allowing the ideas and theatrical experiments of the 1920s to be put in to practice in different ways, and which would be a laboratory for developing the regeneration taking place after World War II. In this, the FTP is indeed the image of this in-between phase described by the writers in 1932. This is also what Malcolm Goldstein suggested when he defined the pivotal moment in the structuring of American theatre as that when the 1934-1935 season was ending and the 1935-1936 one beginning [9] . It is precisely at this moment that the Federal Theatre Project began take shape [10] . This international conference aims to shed light on a key episode – albeit one that has been largely ignored – in the history of theatre and culture in America. We are happy to open it to specialists in theatre studies, but also to historians, sociologists and artists, with the ambition of creating an event characterized by a trans-disciplinary approach. POSSIBLE TOPICS The following topics are only meant as general guidelines any approaches will be considered: 1. Sociopolitical and cultural approach:Social, political and economic context of the New Deal and the WPA . The FTP was one of five projects linked to the Arts to be set up in the framework of the New Deal by the Roosevelt administration; the others were the Federal Writers Project devoted to writers, the Federal Arts Project for the plastic and visual arts, the Federal Music Project (which had close connections with the FTP as the orchestras financed under the scheme were often called upon the play in the productions staged in the framework of the FTP), and the Federal Dance Project. All these projects were set up under the auspices of the Work Progress Administration (WPA) created in May 1935 and directed by Arthur Hopkins from 1935 to 1938. Using this approach, the links between the different projects, and their relevance to Roosevelt’s policy could be explored, and their success or otherwise compared to the initial ambitions could be analyzed.Production conditions . The conditions surrounding the production of the FTP performances provide a number of interesting themes to explore: for example how the implementation differed from one region to another, from one director to another, from one period to another.Spatial approach : the different regional branches, questions around accepted performance venues and others which were “no-go”, show tours, the "caravan unit" and the “travelling theatre” project ,...Economic approach : issues concerning free entry, federal State investment, possible shortfalls in funding ....Issues around the Communist question in the American political context of the time . This question alone could generate several papers: for example, through the prism of Hallie Flanagan’s personality and political and artistic career (and the case brought against her for her supposedly communist stance), or studied through practical and artistic aspects. A paper dealing with the censorship accusations against the government, shedding light on this question would be most welcome.Community and American identity . The way the FTP was structured leads us to question the “federal” character of the project, its purportedly “national” scope and its ambition to construct a specifically American theatre of the people. Each of these facets could inspire specific papers (Yiddish Theatre, Afro-American theatre…) and/or broader studies of the ambiguities arising between Federal theatre, National theatre and Community theatre, addressing the contradictions between the declared intentions and historical reality. 2. The aesthetic approach: This second angle, making use of case studies, will focus on the question of whether it is possible to identify an overall aesthetic for the Federal Theatre Project. Papers should highlight the aesthetic features of the studied productions, but more importantly, they could examine to what extent these features were – or were not – instigated by the FTP framework. This should encourage consultation of the FTP archives and studies of specific productions.Monographic studies of landmark productions : The Cradle Will Rock, Macbeth, One-Third of a Nation, It Can't Happen Here, for example.Study of key figures : Hallie Flanagan obviously, but also Orson Welles or John Houseman, for example.Literary approach . The search for new American authors was also one of the purported aims of the FTP: did the project achieve its goal? Which plays can be identified as FTP pieces? Did the FTP succeed in stimulating the emergence of dramatic writing that was specifically American?Biographical approach focused on Hallie Flanagan . Frequently described by critics as a pragmatic idealist, she often spoke of her conception of the theatre: this could be usefully explained and analyzed in a paper. Her career, her period spent teaching at Vassar College, her role in the FTP, her trips to Europe or her portrayal of the FTP in Arena, could also form the basis of a study.Interdisciplinary approach (links with the cinema). Some key figures of American cinema appear to have begun their careers in the theatre, in the framework of the FTP: drawing on specific cases, it could be worth considering how the FTP era influenced later cinematographic productions. 3. Epistemological and historiographical approach This third approach will involve bringing to light questions arising from the FTP archives, concerning the different phases of their development and their scientific processing today. Although relatively unknown in France and Europe, the FTP is well-documented in Anglo-Saxon studies, even if there is some dissatisfaction with the under-representation of this theatrical phenomenon with regard to its importance. Nevertheless, a number of primary sources are available and classified. The National Archives, available via the Library of Congress, include a collection dedicated to the FTP, most of which is accessible online [11] , and the Hallie Flanagan archives held at Vassar College in Poughkeepsie [12] , in association with the Hallie Flanagan collection in the New York Public Library for the Performing Arts and the Smith College where she also taught, provide an extremely rich source of research material. Over and above the state of archives on the FTP, Hallie Flanagan, and the study thereof, and in view of the sometimes conflictual nature of the FTP, this conference also aims at investigating the configuration and possible shortcomings of the project. Was there some sort of government censorship? If so, how far did it go? Are there any missing documents? 4. LEGACIES AND ECHOES The immediate and long-term legacies?The immediate legacy : Some outstanding figures were ‘revealed’ by the FTP, among them, Orson Welles or Arthur Miller. This observation could be discussed, putting the role played by the FTP into perspective, and endeavouring to discover what effects it had on the future careers of those mentioned.Long-term legacy : * In the USA: What remains of the FTP? What traces did this ephemeral experience of a federally funded theatre leave in American culture, in contemporary theatrical forms and, in the widest sense, in cultural policies generally? * In Europe: is it possible to identify any direct influence exerted by the FTP in the years following the project? Another lead could be a study of other theatrical adventures that were in some way inspired by the project.International echoes? To what extent can the FTP be compared to other attempts at national reconstruction through culture (based on examples of specifically theatrical initiatives) drawn up in other countries? The attempt to reconstruct the economy and bring national unity after World War II in France (and the figure of Jeanne Laurent) could be one example, but also the cultural ambitions of the Front Populaire which were almost simultaneous with those of the FTP… Were any international links created with the Federal Theatre Project? Proposals for papers on the Federal Theatre Project will be given priority, but papers on other WPA artistic projects would also be welcome some insofar as they elucidate the FTP context. Selective Bibliography AARON Daniel, Writers on the Left : Episodes in American Literary Communism , New York, Columbia University Press, 1992 [1961]. ARTAUD Denise, Le New Deal , Paris, Armand Colin, 1969. BENTLEY Joanne, Hallie Flanagan: A Life in the American Theatre , New York, Alfred A. Knopf, 1988. BIGSBY C.W.E. et WILMETH Don. B., The Cambridge History of American Theatre, vol. II, 1870-1945, Cambridge, Cambridge University Press, 1999. COLLECTIF, The Federal Theatre Project. A Catalog-Calendar of Productions (coll.) , Westport, Greenwood Press, 1986 (introduction de Lorraine A. Brown). COSGROVE Stuart, The Living Newspaper: History, Production and Form , Hull, University of Hull, 1982. CRAIG Quitta E., Black Drama of the Federal Theatre Era, Amherst, MA, Amherst University Press, 1980. ENGLE Ron et MILLER Tice L., The American Stage, Cambridge, Cambridge University Press, 1993. FRADEN Rena, Blueprints for a Black Federal Theatre, Cambridge, Cambridge University Press, 1994. FRIED A. (dir.), Communism in America: A History in Documents , New York, Columbia University Press, 1997. KEMPF Jean, Histoire culturelle des États-Unis, Paris, Armand Colin, 2015. KOURILSKY Françoise, Le Théâtre aux États-Unis, Waterloo, Renaissance du Livre, 1967. LEVINE Ira Alan, Left-wing Dramatic Theory in the American Theatre , An Arbor, Umi Research Press, 1985 [1947]. MACGOWAN Kenneth, Footlights Across America: Towards a National Theatre, New York, Harcourt, Brace and Co., 1929. MATHEWS DE HART Jane, Federal Theatre, 1935-39: Plays, Relief and Politics, Princeton University Press, 1967. O’CONNOR J. et BROWN Lorraine A. (dir.), Free, Adult, Uncensored: the Living History of the Federal Theatre Project , New York, New Republic Books, 1978. OSBORNE Elizabeth A., Staging the People: Community and Identity in the Federal Theatre Project, New York, Palgrave Macmillan, 2011 PASQUIER Marie-Claire, Le Théâtre américain d’aujourd’hui, Paris, Presses Universitaires de France, 1978. QUINN Susan, Furious Improvisation: How the WPA and a Cast Of Thousands Made High Art out of Desperate Times, New York, Walker and company, 2008. REINELT Janelle G. et ROACH Joseph R., Critical Theory and Performance , University of Michigan Press, 2007 [1992]. WITHAM Barry, The Federal Theatre Project: A Case Study , Cambridge, Cambridge University Press, 2003. WITHAM Barry, Chapter 19 is dedicated to the FTP in Jeffrey H. Richards and Heather S. Nathans, The Oxford Handbook of American Drama, New York Oxford University Press, 2014, pp. 295-306. WHITMAN Wilson, Bread and Circuses: A Study of Federal Theatre, New York, Oxford University Press, 1937. PROPOSITIONS Conference paper proposals should be sent by January 25, 2019 at the latest, to Émeline Jouve ( emeline.jouve@gmail.com ) and Géraldine Prévot ( geraldine.prevot@gmail.com ). à They should include: a) an abstract (4,000 characters maximum); b) a short biographical sketch Official languages : French and English. Artistic events are being organized to coincide with the conference. Advisory board: Zachary Bacqué (Université Toulouse Jean-Jaurès), John Bak (Université de Lorraine), Christian Biet (Université Paris Nanterre), Marguerite Chabrol (Université Paris 8), Françoise Coste (Université Toulouse Jean-Jaurès), Émeline Jouve (Université Toulouse Jean-Jaurès et Institut Champollion, Albi), Sophie Maruejouls (Université Toulouse Jean-Jaurès), Géraldine Prévot (Université Paris Nanterre), Matthew Roudané (Georgia State University), Annette J. Saddik (City University of New York) Organization Committee : Émeline Jouve, Géraldine Prévot NOTES [1] Ces écrivains s’organisent en un groupe nommé la «League of Professionnal Groups for Foster and Ford». Voir Culture and the crisis : an open letter to the writers, artists, teachers, physicians, engineers, scientists and other professional workers of America, New York, Workers Library Publishers, 1932 [En ligne] URL: https://archive.org/details/CultureAndTheCrisisAnOpenLetterToTheWritersArtistsTeachers (consulté le 4 avril 2017). Cette lettre est également reproduite dans A. Fried (dir.), Communism in America: A History in documents, New York, Columbia University Press, 1997, p. 11. [2] Nous traduisons] Culture and the crisis, op.cit., préface. Citation originale : « We of this generation stand midway between two eras. When we look backward, we see our American past like a great tidal wave that is now receding, but that was magnificent indeed in the sweep of its socially purposeless power. When we look ahead, we see something new and strange, undreamed of in the American philosophy. What we see ahead is the threat of cultural dissolution. The great wave piled up too much wreckage – of nature, of obsolete social patterns and institutions, of human blood and nerve. » [3] Malcolm Goldstein, The political stage, American drama and theater of the great depression , New York, Oxford university press, 1974, préface. [4] La première représentation recensée dans le catalogue établi par l’université George Mason, où sont conservées en partie les collections du FTP, date du 3 février 1935. Toutefois, Hallie Flanagan ne prend la tête du FTP qu’en août 1935. [5] Federal Theatre Project Collection, Library of Congress, conservé à l’ununiversitéGeorge Mason. Citons ici également ouvrage qui recense l’ensemble des productions du FTP, classées d’abord selon un critère géographique, et ensuite chronologiquement : The Federal Theatre Project. A Catalog-Calendar of Productions (coll.) , Westport, Greenwood Press, 1986. [6] Hallie Flanagan Papers (1904-1987), Archives and Special Collections Library, Vassar College, Poughkeepsie, Etat de New York, 91 boîtes réparties en 9 séries. [7] These writers were gathered together in a group called the “League of Professionnal Groups for Foster and Ford”. See Culture and the crisis: an open letter to the writers, artists, teachers, physicians, engineers, scientists and other professional workers of America, New York, Workers Library Publishers, 1932 [Online] [8] URL: https://archive.org/details/CultureAndTheCrisisAnOpenLetterToTheWritersArtistsTeachers (consulted April 4, 2017). This letter can also be found in A. Fried (dir.), Communism in America: A History in documents, New York, Columbia University Press, 1997, p. 11. [9] Malcolm Goldstein, The Political Stage, American Drama and Theatre of the Great Depression. New York: Oxford University Press. 1974, Preface. [10] The first performance listed in the catalog prepared by George Mason University where some of the FTP collections are kept is dated February 3, 1935. However Hallie Flanagan only took charge of the FTP in August 1935. [11] Federal Theatre Project Collection, Library of Congress, held at George Mason University. Another example of a work which lists all FTP productions, classified first according to geographic criteria, and second, chronologically: The Federal Theatre Project. A Catalog-Calendar of Productions (coll.) , Westport, Greenwood Press, 1986. [12] Hallie Flanagan Papers (1904-1987), Archives and Special Collections Library, Vassar College, Poughkeepsie, New York State: 91 boxes divided into 9 series.
↧
J. Spencer-Bennett, Moral Talk, Stance and Evaluation in Political Discourse
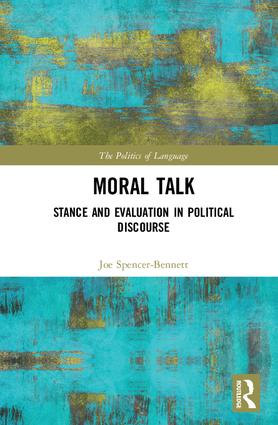 Moral Talk. Stance and Evaluation in Political Discourse Joe Spencer-Bennett Routledge ISBN : 9781138298156 eBook 17,50 £ / harback 115,00 £ 216 p. PRESENTATION This book is about moral talk in contemporary British political discourse, drawing on speeches, debates and radio phone-ins. Using a critical sociolinguistic approach, Spencer-Bennett explores the language people use to communicate moral judgement and highlights the relations between the things that people say, the contexts in which they are said and the circulating ideologies about meaning and morality. This is key reading for students and scholars studying language, politics and critical discourse analysis, within linguistics and anthropology. TABLE OF CONTENTS 1. Introduction : Moral talk: forms, functions and value Emotivism Moral philosophy and moral talk Post-crisis Britain, the moral economy and moral panic Outline of the book 2. The social, ethical and political lives of language Introduction Social life of language Michael Meacher’s speech Ethical life of language Political life of language Conclusion 3. Form: what counts as moral talk? Introduction Stance, evaluation and moral talk Quotability Specificity Determinacy Checklist Conclusion 4. Function: what does moral talk do? Introduction Evaluative language, stance, fact and value Hobart and the multifunctionality of moral talk Cotext Situations and ideologies Cameron’s speech Eric’s call Conclusion 5. Moral systems and ethical life Introduction Moral systems and ethical life The linguistic distinction Moral systems, ethical life and radio phone-ins Modest moralising Conclusion 6. Critiquing moral talk Introduction What is critique? Bias Power Illegitimate power Immanent critique Moral realism Veracity Explanatory critique Lay normativity Conclusion 7.Critiquing interpretation Introduction Interpretative agency Language ideologies Hymes’ ethical sociolinguistics Emotivism as a corporate technology Emotivism in political communications Linguistic expertise and arguments for emotivism Conclusion 8. Conclusion Introduction What is moral talk? What does moral talk do? What is moral talk good for? Methodology: the field, the meta-field, and the armchair Theory: linguistic interpretivism and moral realism AUTHOR Joe Spencer-Bennett is Lecturer in Applied Linguistics at the University of Birmingham. He has published articles in the journals Discourse & Society , Journal of Sociolinguistics , Language & Communication and Social Semiotics . His research concerns the ethical and political life of communication.
Moral Talk. Stance and Evaluation in Political Discourse Joe Spencer-Bennett Routledge ISBN : 9781138298156 eBook 17,50 £ / harback 115,00 £ 216 p. PRESENTATION This book is about moral talk in contemporary British political discourse, drawing on speeches, debates and radio phone-ins. Using a critical sociolinguistic approach, Spencer-Bennett explores the language people use to communicate moral judgement and highlights the relations between the things that people say, the contexts in which they are said and the circulating ideologies about meaning and morality. This is key reading for students and scholars studying language, politics and critical discourse analysis, within linguistics and anthropology. TABLE OF CONTENTS 1. Introduction : Moral talk: forms, functions and value Emotivism Moral philosophy and moral talk Post-crisis Britain, the moral economy and moral panic Outline of the book 2. The social, ethical and political lives of language Introduction Social life of language Michael Meacher’s speech Ethical life of language Political life of language Conclusion 3. Form: what counts as moral talk? Introduction Stance, evaluation and moral talk Quotability Specificity Determinacy Checklist Conclusion 4. Function: what does moral talk do? Introduction Evaluative language, stance, fact and value Hobart and the multifunctionality of moral talk Cotext Situations and ideologies Cameron’s speech Eric’s call Conclusion 5. Moral systems and ethical life Introduction Moral systems and ethical life The linguistic distinction Moral systems, ethical life and radio phone-ins Modest moralising Conclusion 6. Critiquing moral talk Introduction What is critique? Bias Power Illegitimate power Immanent critique Moral realism Veracity Explanatory critique Lay normativity Conclusion 7.Critiquing interpretation Introduction Interpretative agency Language ideologies Hymes’ ethical sociolinguistics Emotivism as a corporate technology Emotivism in political communications Linguistic expertise and arguments for emotivism Conclusion 8. Conclusion Introduction What is moral talk? What does moral talk do? What is moral talk good for? Methodology: the field, the meta-field, and the armchair Theory: linguistic interpretivism and moral realism AUTHOR Joe Spencer-Bennett is Lecturer in Applied Linguistics at the University of Birmingham. He has published articles in the journals Discourse & Society , Journal of Sociolinguistics , Language & Communication and Social Semiotics . His research concerns the ethical and political life of communication.
↧
Mandiargues 2020 : Écrire entre les arts (Cerisy-la-Salle)
Centre international de Cerisy-la-Salle 20-27 juillet 2020 Colloque : «Mandiargues 2020 - Écrire entre les arts » Appel à communications : date limite de réception 1er mai 2019 Le colloque de Cerisy Mandiargues 2020 – Écrire entre les arts étudiera l’œuvre littéraire (romans et nouvelles, poésie, théâtre), mais aussi esthétique (écrits sur l’art) d’André Pieyre de Mandiargues (1909-1991), dans sa relation à la modernité, aux avant-gardes historiques puis à l’époque contemporaine et actuelle. Dès lors, ce colloque souhaite proposer une approche transversale des études mandiarguiennes, évidemment liées à la littérature mais aussi aux autres arts (peinture, photographie, cinéma, théâtre, musique, radiophonie…), en développant, pour cela, des perspectives et des points de vue originaux et novateurs. Ainsi la semaine d’étude Mandiargues 2020 – Écrire entre les arts sera d’abord consacrée à l’œuvre d’André Pieyre de Mandiargues en liaison avec les avant-gardes ou les mouvements littéraires qu’elle revisite, traverse ou annonce (baroque, fantastique, surréalisme, nouveau roman…) en véhiculant pour cela des notions qui restent d’une particulière acuité moderne et contemporaine dans le récit, la poétique, le langage (intertextualité, visualité, images mentales, spécularité…), et, en analysant, également, les rencontres avec de nombreux écrivains et poètes dont cette œuvre est contemporaine. Toutefois, le projet du colloque est aussi de dépasser les «fondations» surréalistes de Mandiargues pour étudier, aussi bien ses références classiques, par exemple élisabéthaines, romantiques ou impressionnistes, que, symétriquement, se projeter dans le futur pour penser son actualité poétique et fictionnelle. Dès lors, toute étude de l’œuvre, poétique et esthétique, de Mandiargues, qui fut également critique d’art, en liaison avec la peinture (de l’École métaphysique italienne au surréalisme, de l’art brut au matiérisme) mais aussi avec la photographie, le cinéma ou le théâtre (à travers les adaptations cinématographiques de ses récits ou les mises en scène de ses pièces) est encouragée. En outre, toute analyse en relation avec l’art le plus actuel, qui développera des points de vue novateurs sur des sujets ou des thématiques, reconnus comme procédant de la poétique mandiarguienne, ou, inversement, résolument originaux, est la bienvenue. Enfin, un soin pourra être apporté à l’étude de son cosmopolitisme (l’Italie, le Mexique, Barcelone, le Japon…) et à la traduction qu’il a pratiquée à de nombreuses reprises (Octavio Paz, W.B. Yeats, Filippo De Pisis, Yukio Mishima…). Ce petit inventaire n’est évidemment qu’une proposition, et invite à être complété, à son tour, par de nouveaux champs d’études… Alexandre Castant, Pierre Taminiaux, Iwona Tokarska-Castant
↧